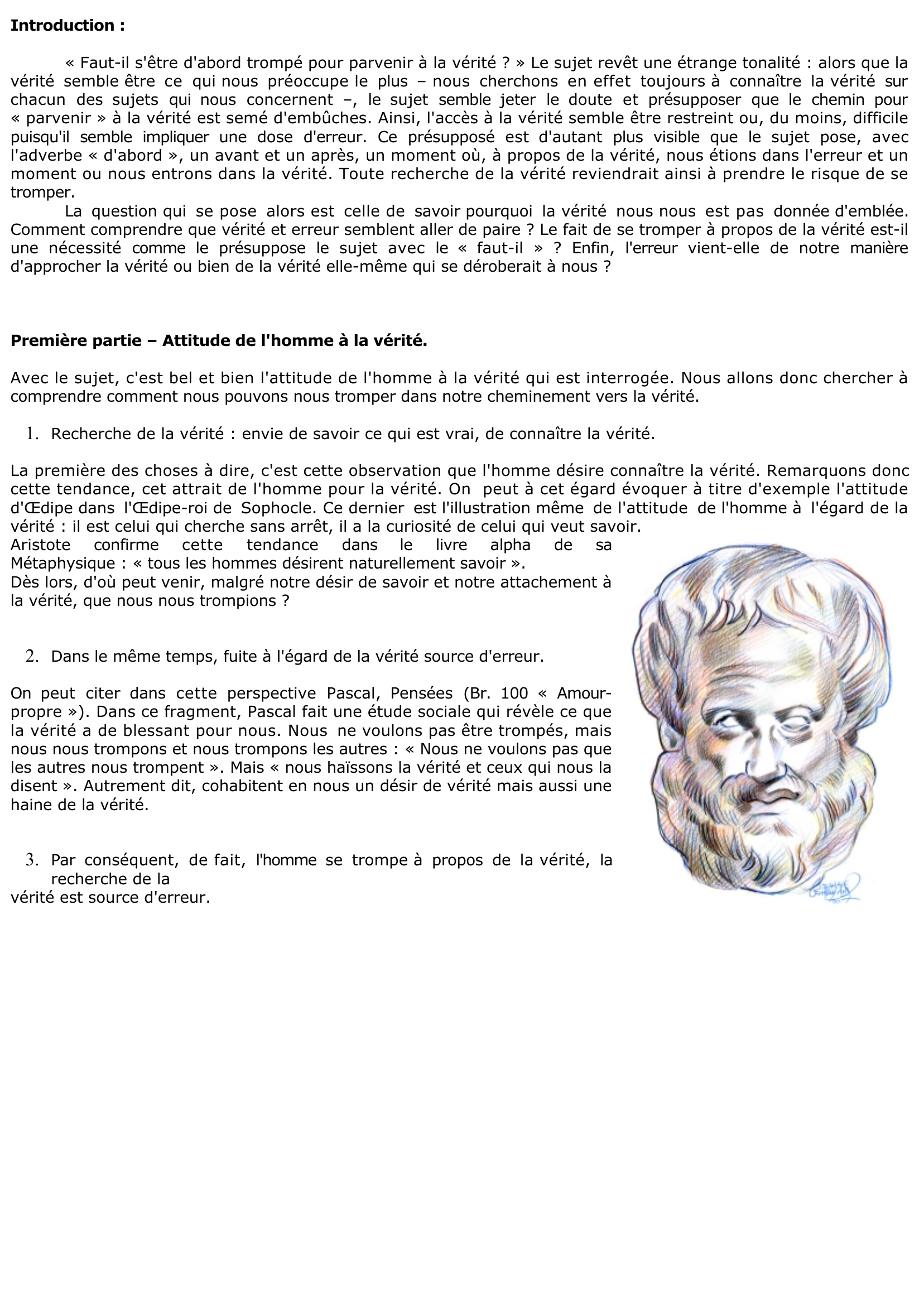Faut-il s'être d'abord trompé pour parvenir a la vérité?
Extrait du document
«
Introduction :
« Faut-il s'être d'abord trompé pour parvenir à la vérité ? » Le sujet revêt une étrange tonalité : alors que la
vérité semble être ce qui nous préoccupe le plus – nous cherchons en effet toujours à connaître la vérité sur
chacun des sujets qui nous concernent –, le sujet semble jeter le doute et présupposer que le chemin pour
« parvenir » à la vérité est semé d'embûches.
Ainsi, l'accès à la vérité semble être restreint ou, du moins, difficile
puisqu'il semble impliquer une dose d'erreur.
Ce présupposé est d'autant plus visible que le sujet pose, avec
l'adverbe « d'abord », un avant et un après, un moment où, à propos de la vérité, nous étions dans l'erreur et un
moment ou nous entrons dans la vérité.
Toute recherche de la vérité reviendrait ainsi à prendre le risque de se
tromper.
La question qui se pose alors est celle de savoir pourquoi la vérité nous nous est pas donnée d'emblée.
Comment comprendre que vérité et erreur semblent aller de paire ? Le fait de se tromper à propos de la vérité est-il
une nécessité comme le présuppose le sujet avec le « faut-il » ? Enfin, l'erreur vient-elle de notre manière
d'approcher la vérité ou bien de la vérité elle-même qui se déroberait à nous ?
Première partie – Attitude de l'homme à la vérité.
Avec le sujet, c'est bel et bien l'attitude de l'homme à la vérité qui est interrogée.
Nous allons donc chercher à
comprendre comment nous pouvons nous tromper dans notre cheminement vers la vérité.
1.
Recherche de la vérité : envie de savoir ce qui est vrai, de connaître la vérité.
La première des choses à dire, c'est cette observation que l'homme désire connaître la vérité.
Remarquons donc
cette tendance, cet attrait de l'homme pour la vérité.
On peut à cet égard évoquer à titre d'exemple l'attitude
d'Œdipe dans l'Œdipe-roi de Sophocle.
Ce dernier est l'illustration même de l'attitude de l'homme à l'égard de la
vérité : il est celui qui cherche sans arrêt, il a la curiosité de celui qui veut savoir.
Aristote
confirme cette
tendance
dans le livre alpha de sa
Métaphysique : « tous les hommes désirent naturellement savoir ».
Dès lors, d'où peut venir, malgré notre désir de savoir et notre attachement à
la vérité, que nous nous trompions ?
2.
Dans le même temps, fuite à l'égard de la vérité source d'erreur.
On peut citer dans cette perspective Pascal, Pensées (Br.
100 « Amourpropre »).
Dans ce fragment, Pascal fait une étude sociale qui révèle ce que
la vérité a de blessant pour nous.
Nous ne voulons pas être trompés, mais
nous nous trompons et nous trompons les autres : « Nous ne voulons pas que
les autres nous trompent ».
Mais « nous haïssons la vérité et ceux qui nous la
disent ».
Autrement dit, cohabitent en nous un désir de vérité mais aussi une
haine de la vérité.
3.
Par conséquent, de fait, l'homme se trompe à propos de la vérité, la
recherche de la
vérité est source d'erreur.
1..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il s'être d'abord trompé pour pouvoir parvenir à la vérité ?
- Faut-il s'être d'abord trompé pour pouvoir parvenir à la vérité ?
- Faut-il préférer la vérité au bonheur ?
- Diderot: La vérité existe-t-elle ou faut-il l'inventer ?
- Commenter ce texte de Poincaré : « La foi du savant ne ressemble pas à celle que les orthodoxes puisent dans le besoin de certitude. Il ne faut pas croire que l'amour de la vérité se confonde avec l'amour de la certitude [...]; non, la foi du savant ress