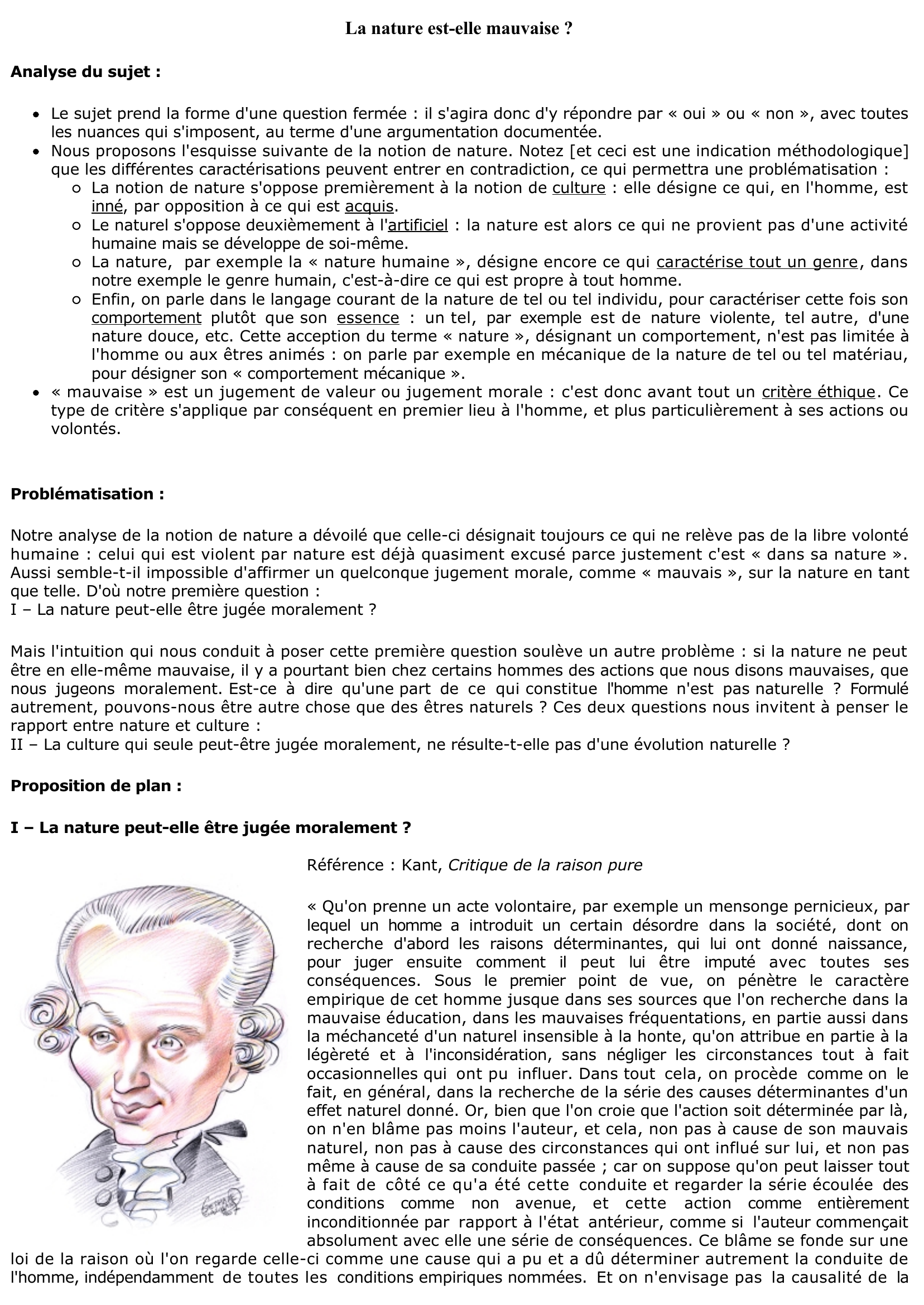La nature est-elle mauvaise ?
Extrait du document
«
La nature est-elle mauvaise ?
Analyse du sujet :
Le sujet prend la forme d'une question fermée : il s'agira donc d'y répondre par « oui » ou « non », avec toutes
les nuances qui s'imposent, au terme d'une argumentation documentée.
Nous proposons l'esquisse suivante de la notion de nature.
Notez [et ceci est une indication méthodologique]
que les différentes caractérisations peuvent entrer en contradiction, ce qui permettra une problématisation :
La notion de nature s'oppose premièrement à la notion de culture : elle désigne ce qui, en l'homme, est
inné, par opposition à ce qui est acquis.
Le naturel s'oppose deuxièmement à l'artificiel : la nature est alors ce qui ne provient pas d'une activité
humaine mais se développe de soi-même.
La nature, par exemple la « nature humaine », désigne encore ce qui caractérise tout un genre, dans
notre exemple le genre humain, c'est-à-dire ce qui est propre à tout homme.
Enfin, on parle dans le langage courant de la nature de tel ou tel individu, pour caractériser cette fois son
comportement plutôt que son essence : un tel, par exemple est de nature violente, tel autre, d'une
nature douce, etc.
Cette acception du terme « nature », désignant un comportement, n'est pas limitée à
l'homme ou aux êtres animés : on parle par exemple en mécanique de la nature de tel ou tel matériau,
pour désigner son « comportement mécanique ».
« mauvaise » est un jugement de valeur ou jugement morale : c'est donc avant tout un critère éthique.
Ce
type de critère s'applique par conséquent en premier lieu à l'homme, et plus particulièrement à ses actions ou
volontés.
Problématisation :
Notre analyse de la notion de nature a dévoilé que celle-ci désignait toujours ce qui ne relève pas de la libre volonté
humaine : celui qui est violent par nature est déjà quasiment excusé parce justement c'est « dans sa nature ».
Aussi semble-t-il impossible d'affirmer un quelconque jugement morale, comme « mauvais », sur la nature en tant
que telle.
D'où notre première question :
I – La nature peut-elle être jugée moralement ?
Mais l'intuition qui nous conduit à poser cette première question soulève un autre problème : si la nature ne peut
être en elle-même mauvaise, il y a pourtant bien chez certains hommes des actions que nous disons mauvaises, que
nous jugeons moralement.
Est-ce à dire qu'une part de ce qui constitue l'homme n'est pas naturelle ? Formulé
autrement, pouvons-nous être autre chose que des êtres naturels ? Ces deux questions nous invitent à penser le
rapport entre nature et culture :
II – La culture qui seule peut-être jugée moralement, ne résulte-t-elle pas d'une évolution naturelle ?
Proposition de plan :
I – La nature peut-elle être jugée moralement ?
Référence : Kant, Critique de la raison pure
« Qu'on prenne un acte volontaire, par exemple un mensonge pernicieux, par
lequel un homme a introduit un certain désordre dans la société, dont on
recherche d'abord les raisons déterminantes, qui lui ont donné naissance,
pour juger ensuite comment il peut lui être imputé avec toutes ses
conséquences.
Sous le premier point de vue, on pénètre le caractère
empirique de cet homme jusque dans ses sources que l'on recherche dans la
mauvaise éducation, dans les mauvaises fréquentations, en partie aussi dans
la méchanceté d'un naturel insensible à la honte, qu'on attribue en partie à la
légèreté et à l'inconsidération, sans négliger les circonstances tout à fait
occasionnelles qui ont pu influer.
Dans tout cela, on procède comme on le
fait, en général, dans la recherche de la série des causes déterminantes d'un
effet naturel donné.
Or, bien que l'on croie que l'action soit déterminée par là,
on n'en blâme pas moins l'auteur, et cela, non pas à cause de son mauvais
naturel, non pas à cause des circonstances qui ont influé sur lui, et non pas
même à cause de sa conduite passée ; car on suppose qu'on peut laisser tout
à fait de côté ce qu'a été cette conduite et regarder la série écoulée des
conditions comme non avenue, et cette action comme entièrement
inconditionnée par rapport à l'état antérieur, comme si l'auteur commençait
absolument avec elle une série de conséquences.
Ce blâme se fonde sur une
loi de la raison où l'on regarde celle-ci comme une cause qui a pu et a dû déterminer autrement la conduite de
l'homme, indépendamment de toutes les conditions empiriques nommées.
Et on n'envisage pas la causalité de la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « L’art imite la nature » ARISTOTE
- L'art n'est-il qu'une imitation de la nature? (corrigé)
- Richard Feynman: La Nature de la physique
- PHILO - TERMINALES GENERALES ET TECHNOLOGIQUES - 2022 PARTIE I : NATURE ET TECHNIQUE.
- Faut il proteger la nature de Christine cost