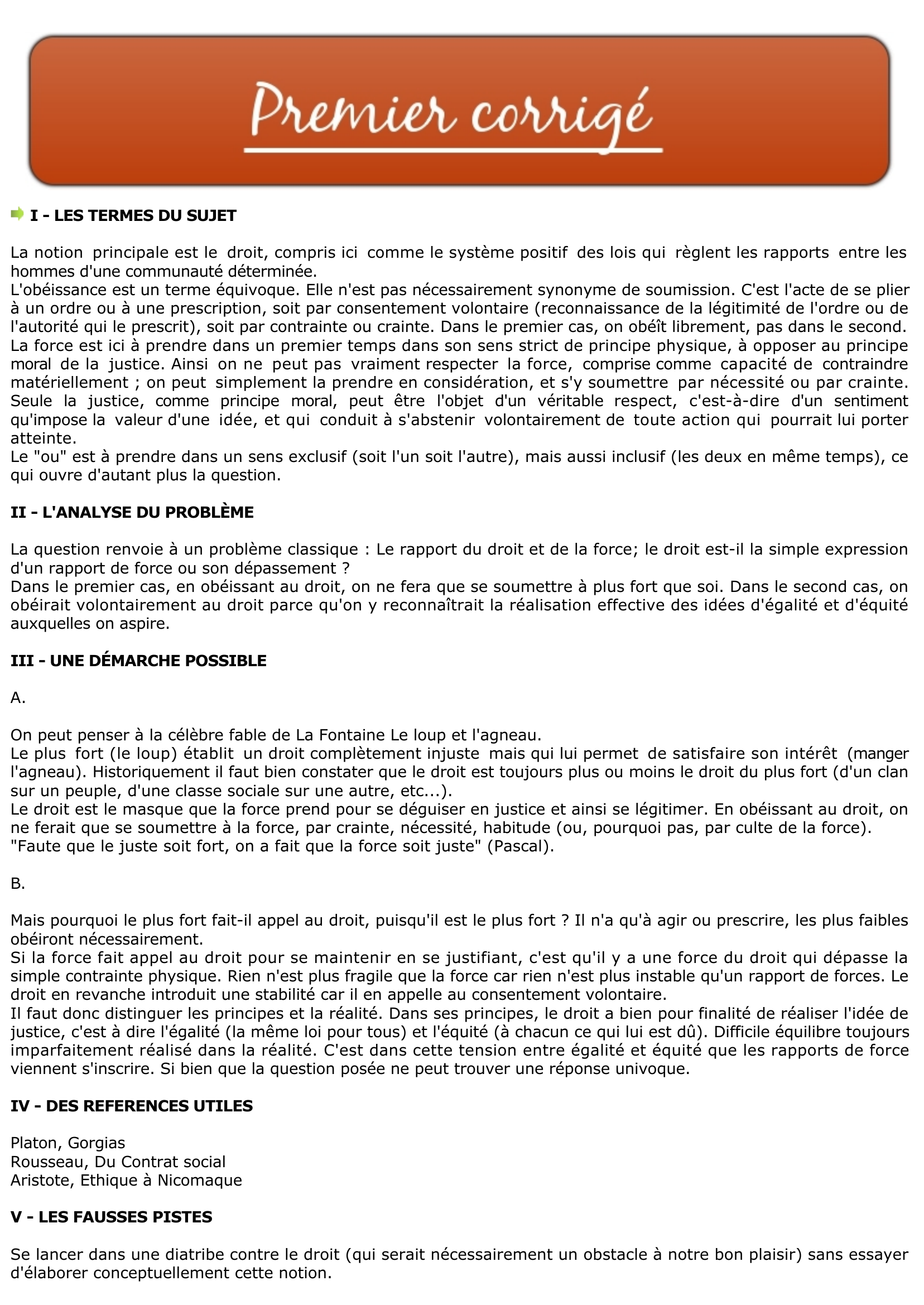Que respecte-t-on en obéissant au droit : la force ou la justice ?
Extrait du document
«
I - LES TERMES DU SUJET
La notion principale est le droit, compris ici comme le système positif des lois qui règlent les rapports entre les
hommes d'une communauté déterminée.
L'obéissance est un terme équivoque.
Elle n'est pas nécessairement synonyme de soumission.
C'est l'acte de se plier
à un ordre ou à une prescription, soit par consentement volontaire (reconnaissance de la légitimité de l'ordre ou de
l'autorité qui le prescrit), soit par contrainte ou crainte.
Dans le premier cas, on obéît librement, pas dans le second.
La force est ici à prendre dans un premier temps dans son sens strict de principe physique, à opposer au principe
moral de la justice.
Ainsi on ne peut pas vraiment respecter la force, comprise comme capacité de contraindre
matériellement ; on peut simplement la prendre en considération, et s'y soumettre par nécessité ou par crainte.
Seule la justice, comme principe moral, peut être l'objet d'un véritable respect, c'est-à-dire d'un sentiment
qu'impose la valeur d'une idée, et qui conduit à s'abstenir volontairement de toute action qui pourrait lui porter
atteinte.
Le "ou" est à prendre dans un sens exclusif (soit l'un soit l'autre), mais aussi inclusif (les deux en même temps), ce
qui ouvre d'autant plus la question.
II - L'ANALYSE DU PROBLÈME
La question renvoie à un problème classique : Le rapport du droit et de la force; le droit est-il la simple expression
d'un rapport de force ou son dépassement ?
Dans le premier cas, en obéissant au droit, on ne fera que se soumettre à plus fort que soi.
Dans le second cas, on
obéirait volontairement au droit parce qu'on y reconnaîtrait la réalisation effective des idées d'égalité et d'équité
auxquelles on aspire.
III - UNE DÉMARCHE POSSIBLE
A.
On peut penser à la célèbre fable de La Fontaine Le loup et l'agneau.
Le plus fort (le loup) établit un droit complètement injuste mais qui lui permet de satisfaire son intérêt (manger
l'agneau).
Historiquement il faut bien constater que le droit est toujours plus ou moins le droit du plus fort (d'un clan
sur un peuple, d'une classe sociale sur une autre, etc...).
Le droit est le masque que la force prend pour se déguiser en justice et ainsi se légitimer.
En obéissant au droit, on
ne ferait que se soumettre à la force, par crainte, nécessité, habitude (ou, pourquoi pas, par culte de la force).
"Faute que le juste soit fort, on a fait que la force soit juste" (Pascal).
B.
Mais pourquoi le plus fort fait-il appel au droit, puisqu'il est le plus fort ? Il n'a qu'à agir ou prescrire, les plus faibles
obéiront nécessairement.
Si la force fait appel au droit pour se maintenir en se justifiant, c'est qu'il y a une force du droit qui dépasse la
simple contrainte physique.
Rien n'est plus fragile que la force car rien n'est plus instable qu'un rapport de forces.
Le
droit en revanche introduit une stabilité car il en appelle au consentement volontaire.
Il faut donc distinguer les principes et la réalité.
Dans ses principes, le droit a bien pour finalité de réaliser l'idée de
justice, c'est à dire l'égalité (la même loi pour tous) et l'équité (à chacun ce qui lui est dû).
Difficile équilibre toujours
imparfaitement réalisé dans la réalité.
C'est dans cette tension entre égalité et équité que les rapports de force
viennent s'inscrire.
Si bien que la question posée ne peut trouver une réponse univoque.
IV - DES REFERENCES UTILES
Platon, Gorgias
Rousseau, Du Contrat social
Aristote, Ethique à Nicomaque
V - LES FAUSSES PISTES
Se lancer dans une diatribe contre le droit (qui serait nécessairement un obstacle à notre bon plaisir) sans essayer
d'élaborer conceptuellement cette notion..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- KELSEN: «Une théorie positiviste, et cela veut dire réaliste, du droit ne prétend pas qu'il n'y a pas de justice, mais qu'en fait, un grand nombre de normes de justice différentes et contradictoires sont présupposées.»
- Rousseau: justice, égalité et droit
- Freud: droit, justice, nature
- Peut-on discerner dans les changements du droit un progrès vers la justice?
- Réclamer justice, est-ce défendre seulement ses intérêts ou vouloir faire respecter le droit ?