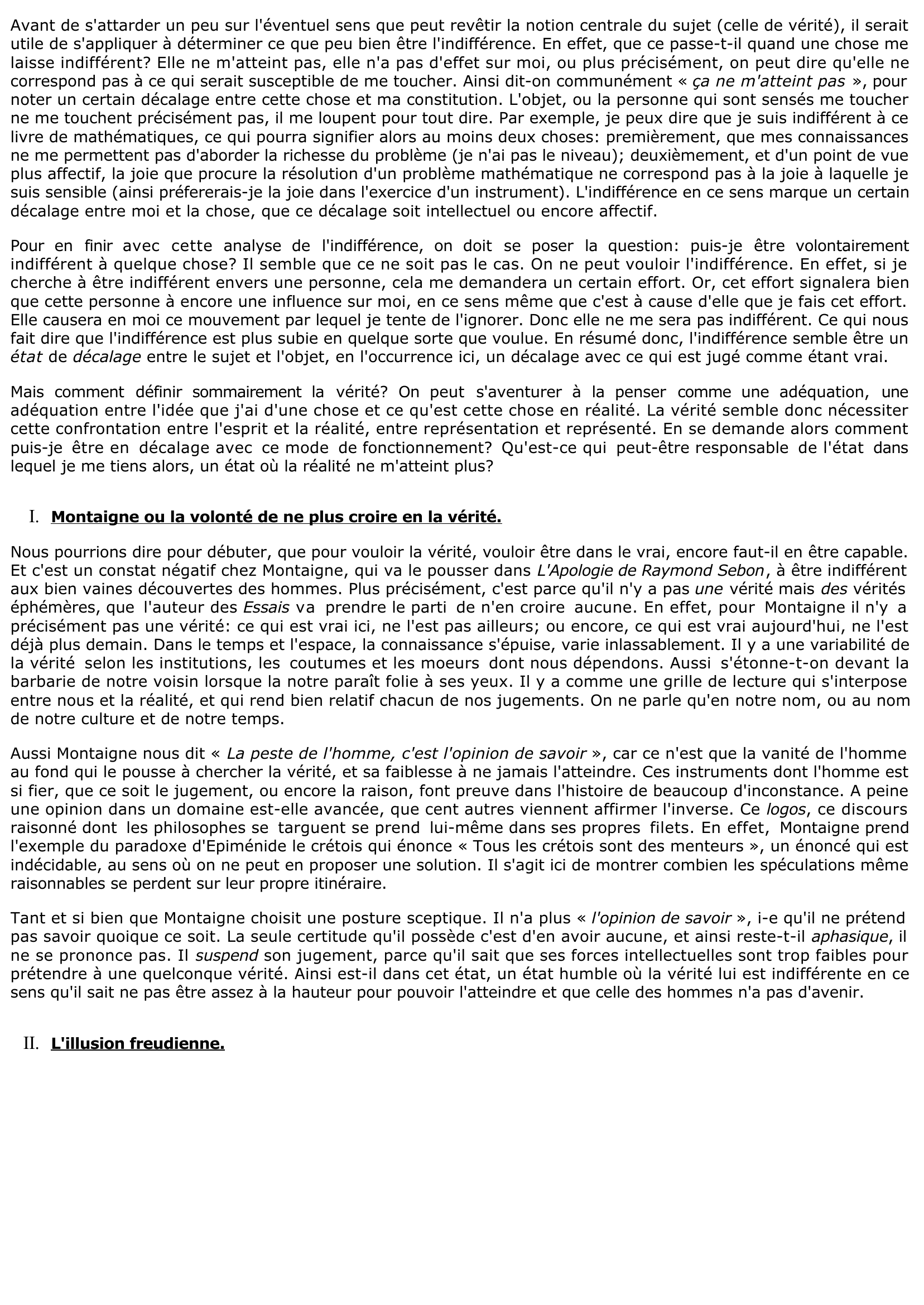La vérité peut-elle laisser indifférent ?
Extrait du document
«
Avant de s'attarder un peu sur l'éventuel sens que peut revêtir la notion centrale du sujet (celle de vérité), il serait
utile de s'appliquer à déterminer ce que peu bien être l'indifférence.
En effet, que ce passe-t-il quand une chose me
laisse indifférent? Elle ne m'atteint pas, elle n'a pas d'effet sur moi, ou plus précisément, on peut dire qu'elle ne
correspond pas à ce qui serait susceptible de me toucher.
Ainsi dit-on communément « ça ne m'atteint pas », pour
noter un certain décalage entre cette chose et ma constitution.
L'objet, ou la personne qui sont sensés me toucher
ne me touchent précisément pas, il me loupent pour tout dire.
Par exemple, je peux dire que je suis indifférent à ce
livre de mathématiques, ce qui pourra signifier alors au moins deux choses: premièrement, que mes connaissances
ne me permettent pas d'aborder la richesse du problème (je n'ai pas le niveau); deuxièmement, et d'un point de vue
plus affectif, la joie que procure la résolution d'un problème mathématique ne correspond pas à la joie à laquelle je
suis sensible (ainsi préfererais-je la joie dans l'exercice d'un instrument).
L'indifférence en ce sens marque un certain
décalage entre moi et la chose, que ce décalage soit intellectuel ou encore affectif.
Pour en finir avec cette analyse de l'indifférence, on doit se poser la question: puis-je être volontairement
indifférent à quelque chose? Il semble que ce ne soit pas le cas.
On ne peut vouloir l'indifférence.
En effet, si je
cherche à être indifférent envers une personne, cela me demandera un certain effort.
Or, cet effort signalera bien
que cette personne à encore une influence sur moi, en ce sens même que c'est à cause d'elle que je fais cet effort.
Elle causera en moi ce mouvement par lequel je tente de l'ignorer.
Donc elle ne me sera pas indifférent.
Ce qui nous
fait dire que l'indifférence est plus subie en quelque sorte que voulue.
En résumé donc, l'indifférence semble être un
état de décalage entre le sujet et l'objet, en l'occurrence ici, un décalage avec ce qui est jugé comme étant vrai.
Mais comment définir sommairement la vérité? On peut s'aventurer à la penser comme une adéquation, une
adéquation entre l'idée que j'ai d'une chose et ce qu'est cette chose en réalité.
La vérité semble donc nécessiter
cette confrontation entre l'esprit et la réalité, entre représentation et représenté.
En se demande alors comment
puis-je être en décalage avec ce mode de fonctionnement? Qu'est-ce qui peut-être responsable de l'état dans
lequel je me tiens alors, un état où la réalité ne m'atteint plus?
I.
Montaigne ou la volonté de ne plus croire en la vérité.
Nous pourrions dire pour débuter, que pour vouloir la vérité, vouloir être dans le vrai, encore faut-il en être capable.
Et c'est un constat négatif chez Montaigne, qui va le pousser dans L'Apologie de Raymond Sebon, à être indifférent
aux bien vaines découvertes des hommes.
Plus précisément, c'est parce qu'il n'y a pas une vérité mais des vérités
éphémères, que l'auteur des Essais va prendre le parti de n'en croire aucune.
En effet, pour Montaigne il n'y a
précisément pas une vérité: ce qui est vrai ici, ne l'est pas ailleurs; ou encore, ce qui est vrai aujourd'hui, ne l'est
déjà plus demain.
Dans le temps et l'espace, la connaissance s'épuise, varie inlassablement.
Il y a une variabilité de
la vérité selon les institutions, les coutumes et les moeurs dont nous dépendons.
Aussi s'étonne-t-on devant la
barbarie de notre voisin lorsque la notre paraît folie à ses yeux.
Il y a comme une grille de lecture qui s'interpose
entre nous et la réalité, et qui rend bien relatif chacun de nos jugements.
On ne parle qu'en notre nom, ou au nom
de notre culture et de notre temps.
Aussi Montaigne nous dit « La peste de l'homme, c'est l'opinion de savoir », car ce n'est que la vanité de l'homme
au fond qui le pousse à chercher la vérité, et sa faiblesse à ne jamais l'atteindre.
Ces instruments dont l'homme est
si fier, que ce soit le jugement, ou encore la raison, font preuve dans l'histoire de beaucoup d'inconstance.
A peine
une opinion dans un domaine est-elle avancée, que cent autres viennent affirmer l'inverse.
Ce logos, ce discours
raisonné dont les philosophes se targuent se prend lui-même dans ses propres filets.
En effet, Montaigne prend
l'exemple du paradoxe d'Epiménide le crétois qui énonce « Tous les crétois sont des menteurs », un énoncé qui est
indécidable, au sens où on ne peut en proposer une solution.
Il s'agit ici de montrer combien les spéculations même
raisonnables se perdent sur leur propre itinéraire.
Tant et si bien que Montaigne choisit une posture sceptique.
Il n'a plus « l'opinion de savoir », i-e qu'il ne prétend
pas savoir quoique ce soit.
La seule certitude qu'il possède c'est d'en avoir aucune, et ainsi reste-t-il aphasique, il
ne se prononce pas.
Il suspend son jugement, parce qu'il sait que ses forces intellectuelles sont trop faibles pour
prétendre à une quelconque vérité.
Ainsi est-il dans cet état, un état humble où la vérité lui est indifférente en ce
sens qu'il sait ne pas être assez à la hauteur pour pouvoir l'atteindre et que celle des hommes n'a pas d'avenir.
II.
L'illusion freudienne..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on être indifférent à la vérité ?
- Peut-on être indifférent à la vérité ?
- « C’est la folie qui détient la vérité de la psychologie » MICHEL FOUCAULT
- vérité cours
- Philosophie: croyance, certitude et vérité