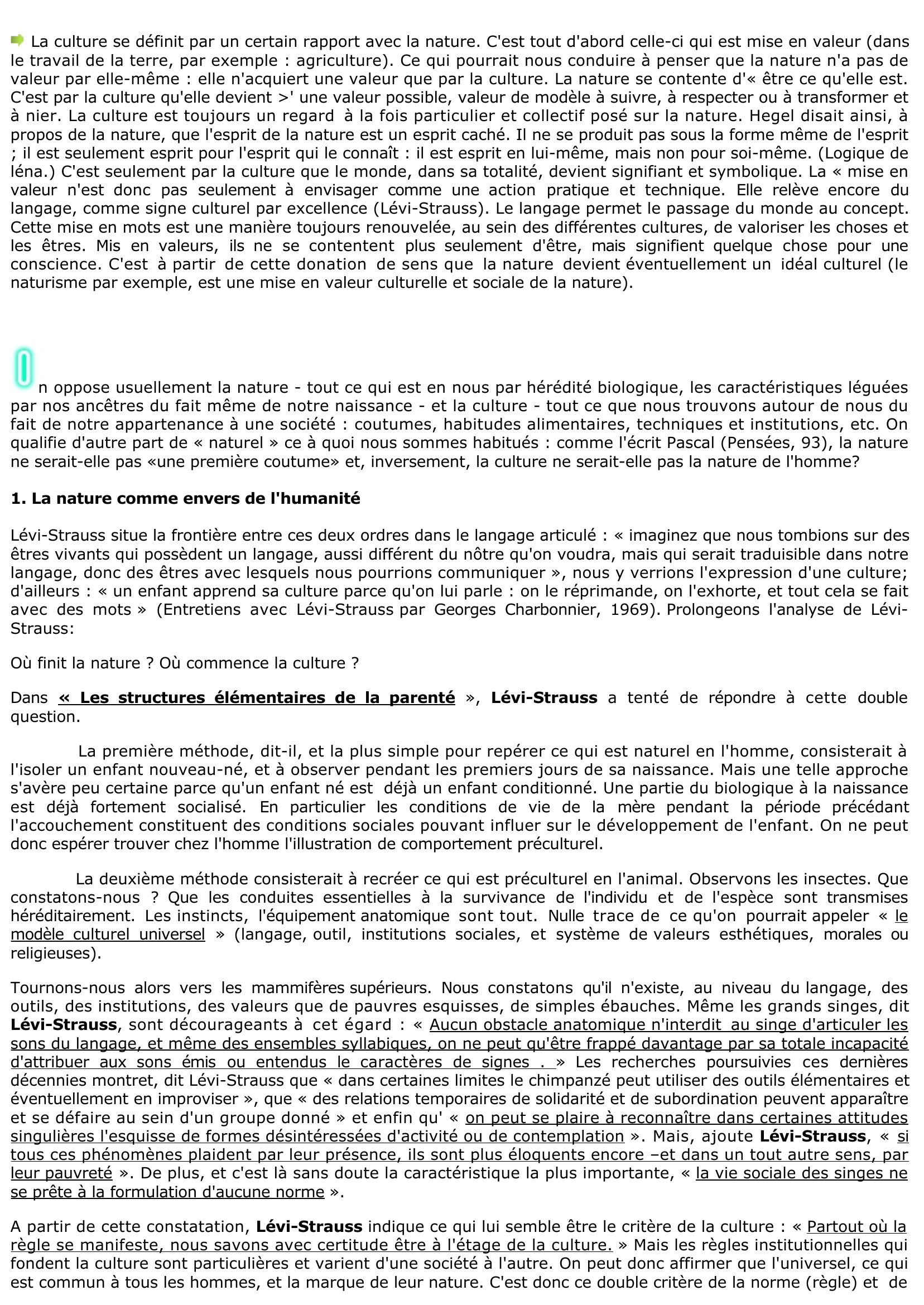La culture est-elle une "mise en valeur" de la nature ?
Extrait du document
«
La culture se définit par un certain rapport avec la nature.
C'est tout d'abord celle-ci qui est mise en valeur (dans
le travail de la terre, par exemple : agriculture).
Ce qui pourrait nous conduire à penser que la nature n'a pas de
valeur par elle-même : elle n'acquiert une valeur que par la culture.
La nature se contente d'« être ce qu'elle est.
C'est par la culture qu'elle devient >' une valeur possible, valeur de modèle à suivre, à respecter ou à transformer et
à nier.
La culture est toujours un regard à la fois particulier et collectif posé sur la nature.
Hegel disait ainsi, à
propos de la nature, que l'esprit de la nature est un esprit caché.
Il ne se produit pas sous la forme même de l'esprit
; il est seulement esprit pour l'esprit qui le connaît : il est esprit en lui-même, mais non pour soi-même.
(Logique de
léna.) C'est seulement par la culture que le monde, dans sa totalité, devient signifiant et symbolique.
La « mise en
valeur n'est donc pas seulement à envisager comme une action pratique et technique.
Elle relève encore du
langage, comme signe culturel par excellence (Lévi-Strauss).
Le langage permet le passage du monde au concept.
Cette mise en mots est une manière toujours renouvelée, au sein des différentes cultures, de valoriser les choses et
les êtres.
Mis en valeurs, ils ne se contentent plus seulement d'être, mais signifient quelque chose pour une
conscience.
C'est à partir de cette donation de sens que la nature devient éventuellement un idéal culturel (le
naturisme par exemple, est une mise en valeur culturelle et sociale de la nature).
n oppose usuellement la nature - tout ce qui est en nous par hérédité biologique, les caractéristiques léguées
par nos ancêtres du fait même de notre naissance - et la culture - tout ce que nous trouvons autour de nous du
fait de notre appartenance à une société : coutumes, habitudes alimentaires, techniques et institutions, etc.
On
qualifie d'autre part de « naturel » ce à quoi nous sommes habitués : comme l'écrit Pascal (Pensées, 93), la nature
ne serait-elle pas «une première coutume» et, inversement, la culture ne serait-elle pas la nature de l'homme?
1.
La nature comme envers de l'humanité
Lévi-Strauss situe la frontière entre ces deux ordres dans le langage articulé : « imaginez que nous tombions sur des
êtres vivants qui possèdent un langage, aussi différent du nôtre qu'on voudra, mais qui serait traduisible dans notre
langage, donc des êtres avec lesquels nous pourrions communiquer », nous y verrions l'expression d'une culture;
d'ailleurs : « un enfant apprend sa culture parce qu'on lui parle : on le réprimande, on l'exhorte, et tout cela se fait
avec des mots » (Entretiens avec Lévi-Strauss par Georges Charbonnier, 1969).
Prolongeons l'analyse de LéviStrauss:
Où finit la nature ? Où commence la culture ?
Dans « Les structures élémentaires de la parenté », Lévi-Strauss a tenté de répondre à cette double
question.
La première méthode, dit-il, et la plus simple pour repérer ce qui est naturel en l'homme, consisterait à
l'isoler un enfant nouveau-né, et à observer pendant les premiers jours de sa naissance.
Mais une telle approche
s'avère peu certaine parce qu'un enfant né est déjà un enfant conditionné.
Une partie du biologique à la naissance
est déjà fortement socialisé.
En particulier les conditions de vie de la mère pendant la période précédant
l'accouchement constituent des conditions sociales pouvant influer sur le développement de l'enfant.
On ne peut
donc espérer trouver chez l'homme l'illustration de comportement préculturel.
La deuxième méthode consisterait à recréer ce qui est préculturel en l'animal.
Observons les insectes.
Que
constatons-nous ? Que les conduites essentielles à la survivance de l'individu et de l'espèce sont transmises
héréditairement.
Les instincts, l'équipement anatomique sont tout.
Nulle trace de ce qu'on pourrait appeler « le
modèle culturel universel » (langage, outil, institutions sociales, et système de valeurs esthétiques, morales ou
religieuses).
Tournons-nous alors vers les mammifères supérieurs.
Nous constatons qu'il n'existe, au niveau du langage, des
outils, des institutions, des valeurs que de pauvres esquisses, de simples ébauches.
Même les grands singes, dit
Lévi-Strauss, sont décourageants à cet égard : « Aucun obstacle anatomique n'interdit au singe d'articuler les
sons du langage, et même des ensembles syllabiques, on ne peut qu'être frappé davantage par sa totale incapacité
d'attribuer aux sons émis ou entendus le caractères de signes .
» Les recherches poursuivies ces dernières
décennies montret, dit Lévi-Strauss que « dans certaines limites le chimpanzé peut utiliser des outils élémentaires et
éventuellement en improviser », que « des relations temporaires de solidarité et de subordination peuvent apparaître
et se défaire au sein d'un groupe donné » et enfin qu' « on peut se plaire à reconnaître dans certaines attitudes
singulières l'esquisse de formes désintéressées d'activité ou de contemplation ».
Mais, ajoute Lévi-Strauss, « si
tous ces phénomènes plaident par leur présence, ils sont plus éloquents encore –et dans un tout autre sens, par
leur pauvreté ».
De plus, et c'est là sans doute la caractéristique la plus importante, « la vie sociale des singes ne
se prête à la formulation d'aucune norme ».
A partir de cette constatation, Lévi-Strauss indique ce qui lui semble être le critère de la culture : « Partout où la
règle se manifeste, nous savons avec certitude être à l'étage de la culture.
» Mais les règles institutionnelles qui
fondent la culture sont particulières et varient d'une société à l'autre.
On peut donc affirmer que l'universel, ce qui
est commun à tous les hommes, et la marque de leur nature.
C'est donc ce double critère de la norme (règle) et de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La culture s'oppose-t-elle nécessairement à la nature ?
- nature et culture
- La culture éloigne-t-elle l’homme de la nature ?
- FICHE: NATURE ET CULTURE
- Nature et culture