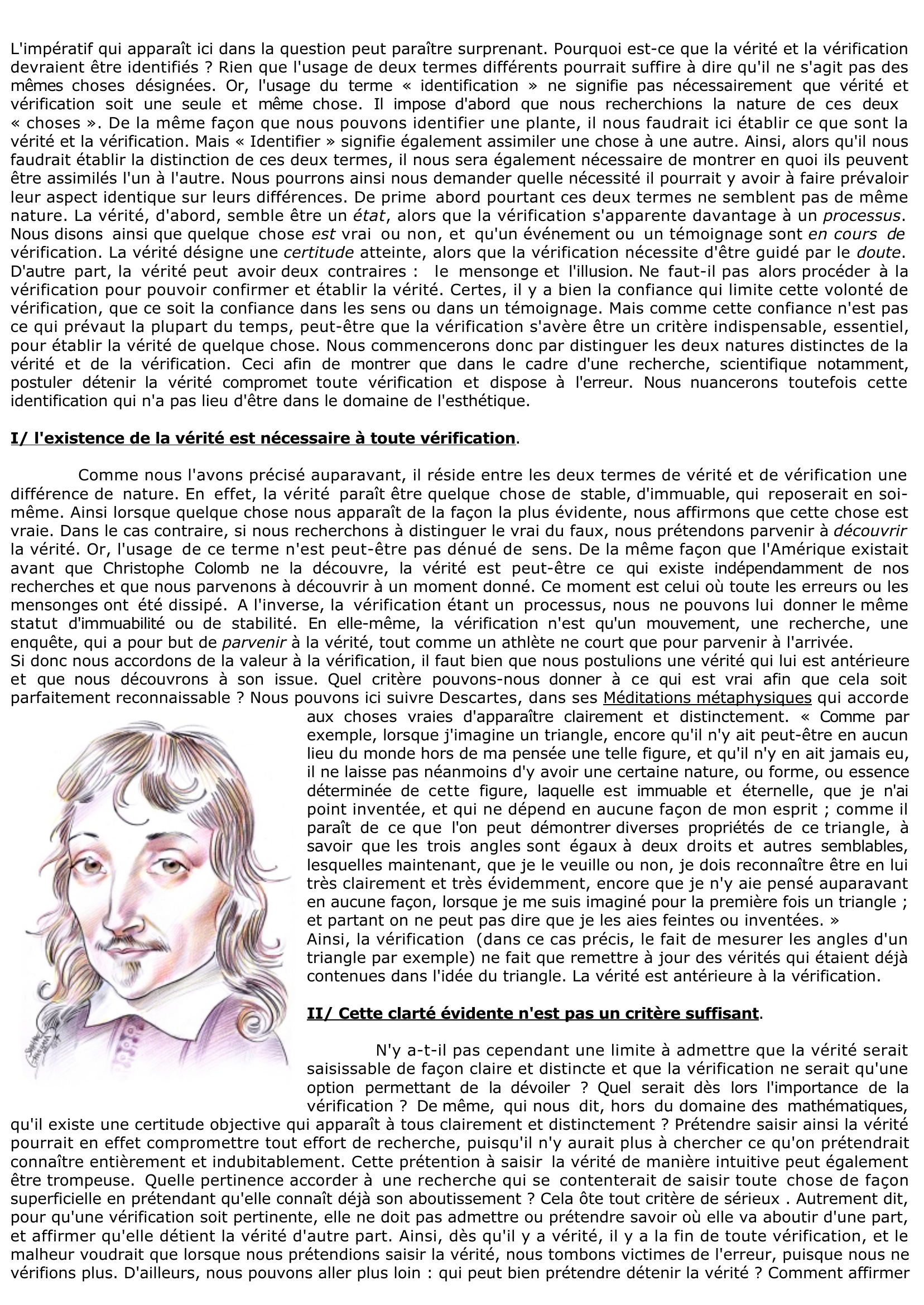Faut-il identifier vérité et vérification ?
Extrait du document
«
L'impératif qui apparaît ici dans la question peut paraître surprenant.
Pourquoi est-ce que la vérité et la vérification
devraient être identifiés ? Rien que l'usage de deux termes différents pourrait suffire à dire qu'il ne s'agit pas des
mêmes choses désignées.
Or, l'usage du terme « identification » ne signifie pas nécessairement que vérité et
vérification soit une seule et même chose.
Il impose d'abord que nous recherchions la nature de ces deux
« choses ».
De la même façon que nous pouvons identifier une plante, il nous faudrait ici établir ce que sont la
vérité et la vérification.
Mais « Identifier » signifie également assimiler une chose à une autre.
Ainsi, alors qu'il nous
faudrait établir la distinction de ces deux termes, il nous sera également nécessaire de montrer en quoi ils peuvent
être assimilés l'un à l'autre.
Nous pourrons ainsi nous demander quelle nécessité il pourrait y avoir à faire prévaloir
leur aspect identique sur leurs différences.
De prime abord pourtant ces deux termes ne semblent pas de même
nature.
La vérité, d'abord, semble être un état, alors que la vérification s'apparente davantage à un processus.
Nous disons ainsi que quelque chose est vrai ou non, et qu'un événement ou un témoignage sont en cours de
vérification.
La vérité désigne une certitude atteinte, alors que la vérification nécessite d'être guidé par le doute.
D'autre part, la vérité peut avoir deux contraires : le mensonge et l'illusion.
Ne faut-il pas alors procéder à la
vérification pour pouvoir confirmer et établir la vérité.
Certes, il y a bien la confiance qui limite cette volonté de
vérification, que ce soit la confiance dans les sens ou dans un témoignage.
Mais comme cette confiance n'est pas
ce qui prévaut la plupart du temps, peut-être que la vérification s'avère être un critère indispensable, essentiel,
pour établir la vérité de quelque chose.
Nous commencerons donc par distinguer les deux natures distinctes de la
vérité et de la vérification.
Ceci afin de montrer que dans le cadre d'une recherche, scientifique notamment,
postuler détenir la vérité compromet toute vérification et dispose à l'erreur.
Nous nuancerons toutefois cette
identification qui n'a pas lieu d'être dans le domaine de l'esthétique.
I/ l'existence de la vérité est nécessaire à toute vérification.
Comme nous l'avons précisé auparavant, il réside entre les deux termes de vérité et de vérification une
différence de nature.
En effet, la vérité paraît être quelque chose de stable, d'immuable, qui reposerait en soimême.
Ainsi lorsque quelque chose nous apparaît de la façon la plus évidente, nous affirmons que cette chose est
vraie.
Dans le cas contraire, si nous recherchons à distinguer le vrai du faux, nous prétendons parvenir à découvrir
la vérité.
Or, l'usage de ce terme n'est peut-être pas dénué de sens.
De la même façon que l'Amérique existait
avant que Christophe Colomb ne la découvre, la vérité est peut-être ce qui existe indépendamment de nos
recherches et que nous parvenons à découvrir à un moment donné.
Ce moment est celui où toute les erreurs ou les
mensonges ont été dissipé.
A l'inverse, la vérification étant un processus, nous ne pouvons lui donner le même
statut d'immuabilité ou de stabilité.
En elle-même, la vérification n'est qu'un mouvement, une recherche, une
enquête, qui a pour but de parvenir à la vérité, tout comme un athlète ne court que pour parvenir à l'arrivée.
Si donc nous accordons de la valeur à la vérification, il faut bien que nous postulions une vérité qui lui est antérieure
et que nous découvrons à son issue.
Quel critère pouvons-nous donner à ce qui est vrai afin que cela soit
parfaitement reconnaissable ? Nous pouvons ici suivre Descartes, dans ses Méditations métaphysiques qui accorde
aux choses vraies d'apparaître clairement et distinctement.
« Comme par
exemple, lorsque j'imagine un triangle, encore qu'il n'y ait peut-être en aucun
lieu du monde hors de ma pensée une telle figure, et qu'il n'y en ait jamais eu,
il ne laisse pas néanmoins d'y avoir une certaine nature, ou forme, ou essence
déterminée de cette figure, laquelle est immuable et éternelle, que je n'ai
point inventée, et qui ne dépend en aucune façon de mon esprit ; comme il
paraît de ce que l'on peut démontrer diverses propriétés de ce triangle, à
savoir que les trois angles sont égaux à deux droits et autres semblables,
lesquelles maintenant, que je le veuille ou non, je dois reconnaître être en lui
très clairement et très évidemment, encore que je n'y aie pensé auparavant
en aucune façon, lorsque je me suis imaginé pour la première fois un triangle ;
et partant on ne peut pas dire que je les aies feintes ou inventées.
»
Ainsi, la vérification (dans ce cas précis, le fait de mesurer les angles d'un
triangle par exemple) ne fait que remettre à jour des vérités qui étaient déjà
contenues dans l'idée du triangle.
La vérité est antérieure à la vérification.
II/ Cette clarté évidente n'est pas un critère suffisant.
N'y a-t-il pas cependant une limite à admettre que la vérité serait
saisissable de façon claire et distincte et que la vérification ne serait qu'une
option permettant de la dévoiler ? Quel serait dès lors l'importance de la
vérification ? De même, qui nous dit, hors du domaine des mathématiques,
qu'il existe une certitude objective qui apparaît à tous clairement et distinctement ? Prétendre saisir ainsi la vérité
pourrait en effet compromettre tout effort de recherche, puisqu'il n'y aurait plus à chercher ce qu'on prétendrait
connaître entièrement et indubitablement.
Cette prétention à saisir la vérité de manière intuitive peut également
être trompeuse.
Quelle pertinence accorder à une recherche qui se contenterait de saisir toute chose de façon
superficielle en prétendant qu'elle connaît déjà son aboutissement ? Cela ôte tout critère de sérieux .
Autrement dit,
pour qu'une vérification soit pertinente, elle ne doit pas admettre ou prétendre savoir où elle va aboutir d'une part,
et affirmer qu'elle détient la vérité d'autre part.
Ainsi, dès qu'il y a vérité, il y a la fin de toute vérification, et le
malheur voudrait que lorsque nous prétendions saisir la vérité, nous tombons victimes de l'erreur, puisque nous ne
vérifions plus.
D'ailleurs, nous pouvons aller plus loin : qui peut bien prétendre détenir la vérité ? Comment affirmer.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il préférer la vérité au bonheur ?
- Diderot: La vérité existe-t-elle ou faut-il l'inventer ?
- Commenter ce texte de Poincaré : « La foi du savant ne ressemble pas à celle que les orthodoxes puisent dans le besoin de certitude. Il ne faut pas croire que l'amour de la vérité se confonde avec l'amour de la certitude [...]; non, la foi du savant ress
- Faut-il avoir peur de la vérité ?
- Pour chercher la vérité, faut-il renoncer à croire ?