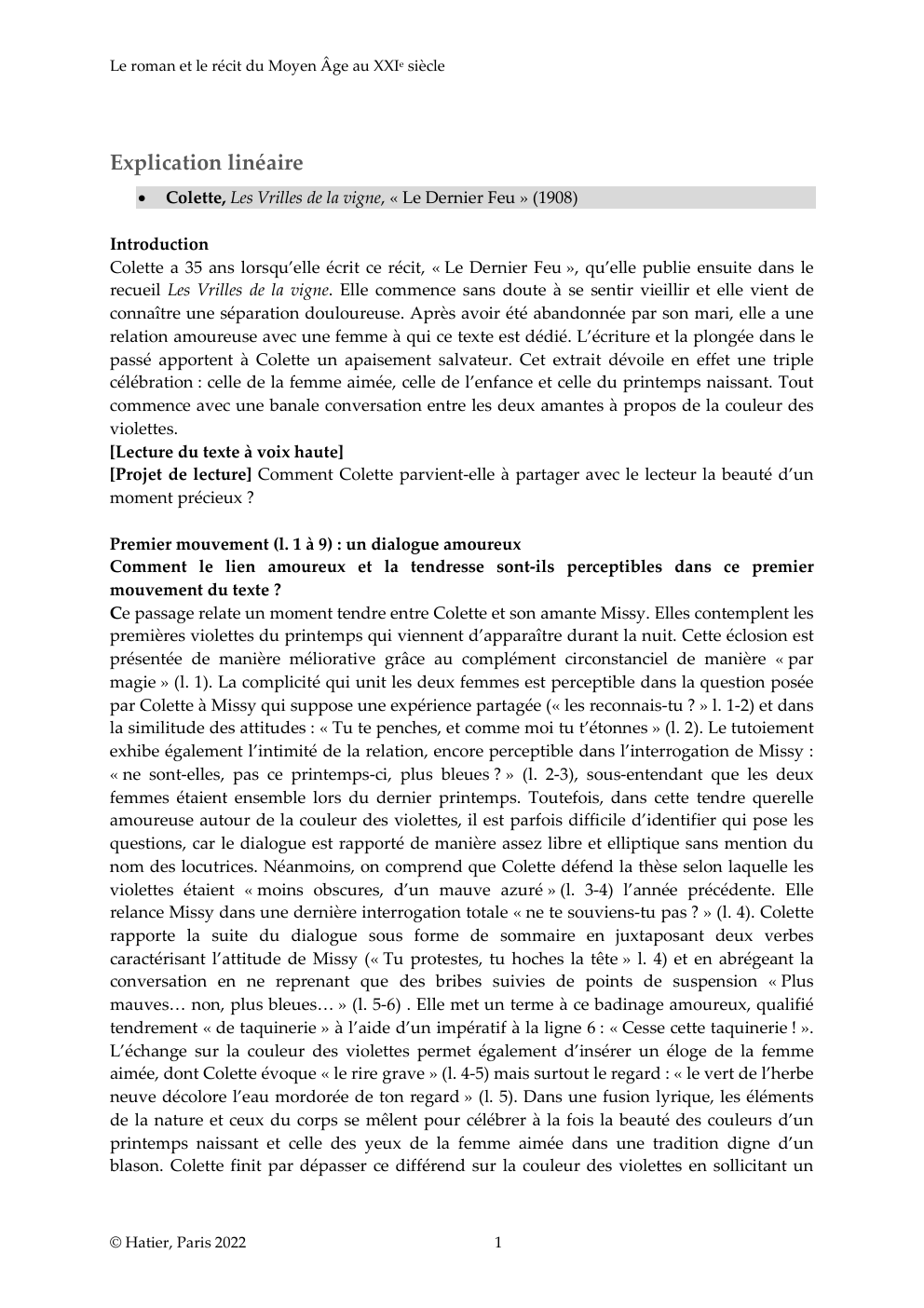Explication linéaire • Colette, Les Vrilles de la vigne, « Le Dernier Feu » (1908)
Publié le 27/06/2023
Extrait du document
«
Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Explication linéaire
•
Colette, Les Vrilles de la vigne, « Le Dernier Feu » (1908)
Introduction
Colette a 35 ans lorsqu’elle écrit ce récit, « Le Dernier Feu », qu’elle publie ensuite dans le
recueil Les Vrilles de la vigne.
Elle commence sans doute à se sentir vieillir et elle vient de
connaître une séparation douloureuse.
Après avoir été abandonnée par son mari, elle a une
relation amoureuse avec une femme à qui ce texte est dédié.
L’écriture et la plongée dans le
passé apportent à Colette un apaisement salvateur.
Cet extrait dévoile en effet une triple
célébration : celle de la femme aimée, celle de l’enfance et celle du printemps naissant.
Tout
commence avec une banale conversation entre les deux amantes à propos de la couleur des
violettes.
[Lecture du texte à voix haute]
[Projet de lecture] Comment Colette parvient-elle à partager avec le lecteur la beauté d’un
moment précieux ?
Premier mouvement (l.
1 à 9) : un dialogue amoureux
Comment le lien amoureux et la tendresse sont-ils perceptibles dans ce premier
mouvement du texte ?
Ce passage relate un moment tendre entre Colette et son amante Missy.
Elles contemplent les
premières violettes du printemps qui viennent d’apparaître durant la nuit.
Cette éclosion est
présentée de manière méliorative grâce au complément circonstanciel de manière « par
magie » (l.
1).
La complicité qui unit les deux femmes est perceptible dans la question posée
par Colette à Missy qui suppose une expérience partagée (« les reconnais-tu ? » l.
1-2) et dans
la similitude des attitudes : « Tu te penches, et comme moi tu t’étonnes » (l.
2).
Le tutoiement
exhibe également l’intimité de la relation, encore perceptible dans l’interrogation de Missy :
« ne sont-elles, pas ce printemps-ci, plus bleues ? » (l.
2-3), sous-entendant que les deux
femmes étaient ensemble lors du dernier printemps.
Toutefois, dans cette tendre querelle
amoureuse autour de la couleur des violettes, il est parfois difficile d’identifier qui pose les
questions, car le dialogue est rapporté de manière assez libre et elliptique sans mention du
nom des locutrices.
Néanmoins, on comprend que Colette défend la thèse selon laquelle les
violettes étaient « moins obscures, d’un mauve azuré » (l.
3-4) l’année précédente.
Elle
relance Missy dans une dernière interrogation totale « ne te souviens-tu pas ? » (l.
4).
Colette
rapporte la suite du dialogue sous forme de sommaire en juxtaposant deux verbes
caractérisant l’attitude de Missy (« Tu protestes, tu hoches la tête » l.
4) et en abrégeant la
conversation en ne reprenant que des bribes suivies de points de suspension « Plus
mauves… non, plus bleues… » (l.
5-6) .
Elle met un terme à ce badinage amoureux, qualifié
tendrement « de taquinerie » à l’aide d’un impératif à la ligne 6 : « Cesse cette taquinerie ! ».
L’échange sur la couleur des violettes permet également d’insérer un éloge de la femme
aimée, dont Colette évoque « le rire grave » (l.
4-5) mais surtout le regard : « le vert de l’herbe
neuve décolore l’eau mordorée de ton regard » (l.
5).
Dans une fusion lyrique, les éléments
de la nature et ceux du corps se mêlent pour célébrer à la fois la beauté des couleurs d’un
printemps naissant et celle des yeux de la femme aimée dans une tradition digne d’un
blason.
Colette finit par dépasser ce différend sur la couleur des violettes en sollicitant un
© Hatier, Paris 2022
1
Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
autre sens, l’odorat : « narines » (l.
6), « parfum » (l.
6), « respirant » (l.
7).
En effet, si les
couleurs des violettes sont changeantes d’une année sur l’autre, le parfum lui reste le même,
« invariable » (l.
7).
Cette antithèse permet de mettre en œuvre le processus de la mémoire
affective.
En effet, ce parfum identique, qui ne change pas, ramène Colette à l’année
précédente, et même encore plus loin.
Elle retrouve son enfance en respirant le parfum des
violettes.
Le bonheur éprouvé est perceptible dans la métaphore qui transforme les violettes
en « philtre qui abolit les années » (l.
7-8) et l’on comprend mieux l’emploi du nom « magie »
à la première ligne du texte.
L’impératif du verbe « regarde », en anaphore aux lignes 7 et 8,
est une invitation à partager ce voyage dans le passé.
Cette réminiscence est si vive qu’elle
emploie deux verbes hyperboliques, « ressusciter et grandir » (l.
8), pour la qualifier et une
tournure exclamative pour évoquer au pluriel tous les printemps de l’enfance.
Les points de
suspension confirment cette invitation à contempler les printemps de l’enfance qui s’adresse
aussi au lecteur.
Deuxième mouvement (l.
10 à 18) : le tableau de l’enfance retrouvée
Comment la narratrice nous fait-elle découvrir son enfance ?
Dans ce deuxième mouvement, le dialogue cesse pour laisser place à une introspection
solitaire.
C’est comme si l’évocation des couleurs des violettes avait fait renaître tous les
printemps de l’enfance.
C’est ce que semble suggérer la reprise des bribes de la conversation
précédente (« Plus mauves…non, plus bleues… » l.
10).
À partir de là, on a la reprise en
anaphore du verbe « je revois » aux lignes 10 et 14.
Le préfixe itératif « re » souligne qu’il
s’agit d’un retour en arrière.
La narratrice, dans une belle hypotypose, décrit les paysages de
son enfance.
Le champ lexical de la nature printanière se déploie dans une ample phrase au
rythme accumulatif : l’énumération commence par évoquer les grands ensembles que sont
les prés et les bois en s’attachant aux hauteurs (« les bourgeons » l.
11) pour finir sur les
minuscules violettes qui tapissent les sous-bois.
Cette évocation rassemble tous les éléments
du locus amoenus (ombre, humidité, lieu protégé) en convoquant différents éléments :
végétation, eau, sable, bois, fleurs.
La présence du tiret à la ligne 11 est comme une invitation
à suspendre véritablement la lecture pour se laisser envahir par ce paysage de mots.
La
diversité des couleurs contribue à la beauté des lieux décrits : « le vert insaisissable » (l.
11)
« les jeannettes jaunes au cœur safrané » (l.
13).
L’image très belle également des « sources
perdues, bues par le sable aussitôt que nées » (l.
13) donne l’impression d’un paysage
protégé et oublié du monde.
L’énumération se termine par un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse linéaire : le dernier feu Les vrilles de la vigne
- Manon Lescaut extrait 1 étude linéaire: Explication linéaire, extrait 1 : « J'avais marqué le temps de mon départ … ses malheurs et les miens. »
- explication linéaire Prologue de "juste la fin du monde"
- explication linéaire Wajdi Mouawad, Incendies , Première partie, « Incendie de Nawal », 2009, Léméac
- La Princesse de Clèves, explications linéaires Explication linéaire I : de « Madame de Chartres, qui avait eu tant d’application […] » à « […] quand on était jeune. » (Première partie)