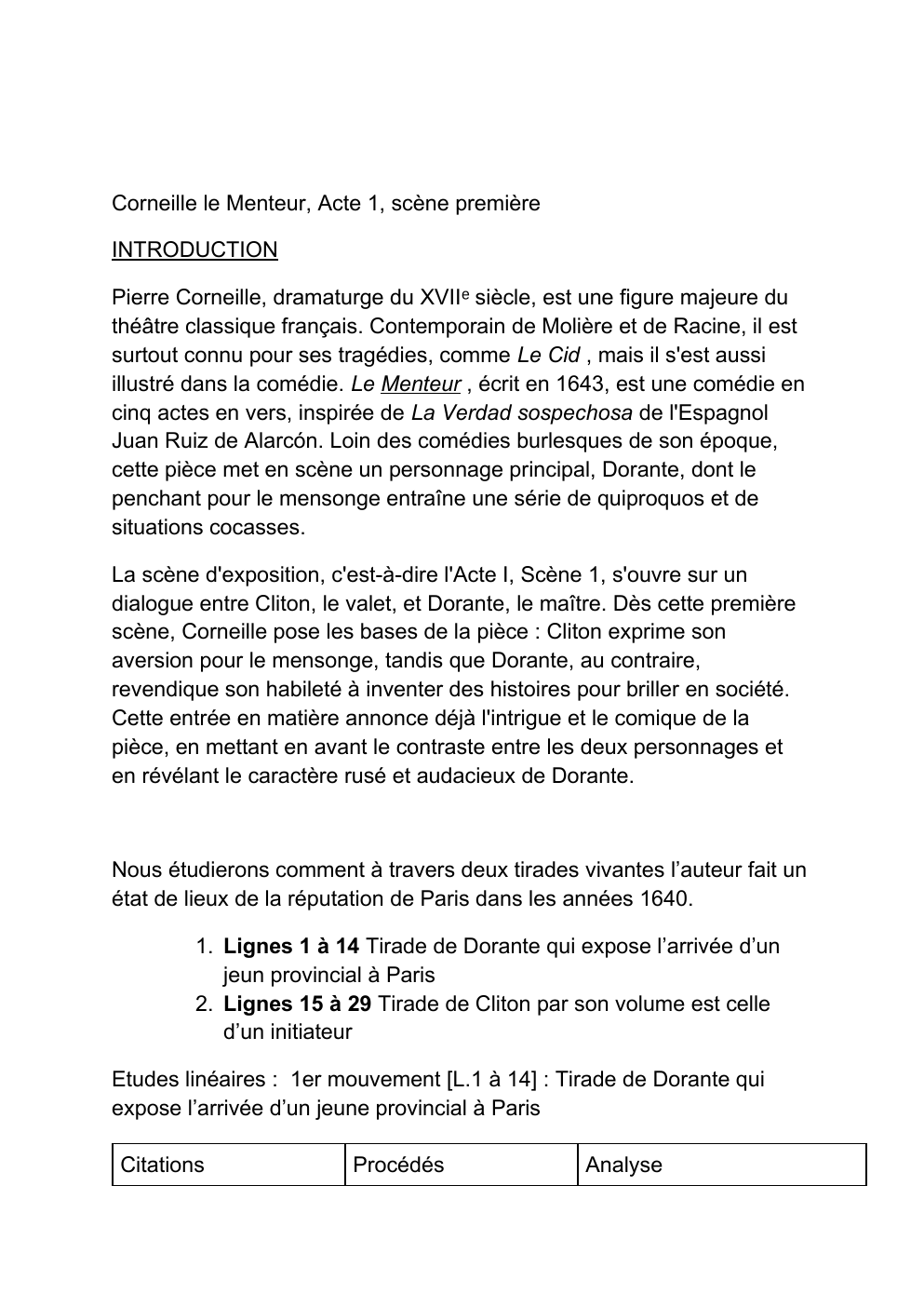Analyse linéaire Le Menteur, Acte I, scène 1
Publié le 23/06/2025
Extrait du document
«
Corneille le Menteur, Acte 1, scène première
INTRODUCTION
Pierre Corneille, dramaturge du XVIIᵉ siècle, est une figure majeure du
théâtre classique français.
Contemporain de Molière et de Racine, il est
surtout connu pour ses tragédies, comme Le Cid , mais il s'est aussi
illustré dans la comédie.
Le Menteur , écrit en 1643, est une comédie en
cinq actes en vers, inspirée de La Verdad sospechosa de l'Espagnol
Juan Ruiz de Alarcón.
Loin des comédies burlesques de son époque,
cette pièce met en scène un personnage principal, Dorante, dont le
penchant pour le mensonge entraîne une série de quiproquos et de
situations cocasses.
La scène d'exposition, c'est-à-dire l'Acte I, Scène 1, s'ouvre sur un
dialogue entre Cliton, le valet, et Dorante, le maître.
Dès cette première
scène, Corneille pose les bases de la pièce : Cliton exprime son
aversion pour le mensonge, tandis que Dorante, au contraire,
revendique son habileté à inventer des histoires pour briller en société.
Cette entrée en matière annonce déjà l'intrigue et le comique de la
pièce, en mettant en avant le contraste entre les deux personnages et
en révélant le caractère rusé et audacieux de Dorante.
Nous étudierons comment à travers deux tirades vivantes l’auteur fait un
état de lieux de la réputation de Paris dans les années 1640.
1.
Lignes 1 à 14 Tirade de Dorante qui expose l’arrivée d’un
jeun provincial à Paris
2.
Lignes 15 à 29 Tirade de Cliton par son volume est celle
d’un initiateur
Etudes linéaires : 1er mouvement [L.1 à 14] : Tirade de Dorante qui
expose l’arrivée d’un jeune provincial à Paris
Citations
Procédés
Analyse
L1 “_______”
2 antiphrases
> ironie : voc vs acte
mythomane
=> 1ere contradiction
(> connotation spirituelle
contre 8e commandement)
(parjure)
(C.
+ religieux car jésuites)
L2 “vivre”
usage intransitif
=> formule ciselée
comparaison
> phrase sommaire, résume
qlq années de vie
d’une jeunesse privilégiée
(// C.)
L4 “Mais” “loin”
adversatif : seuil
quantitatif devient
qualitatif
>distance géo
=> symbolique
L5 “___________”
associé à “méthode”
théorie des climats de
Montesquieu
Sud nonchalant vs Nord
discipliné
=>justifie changement
=> sent l’Université
L8 “rougir”
typologie linguistique
pragmatique (de la
phrase) associé à la
connotation juvénile
terme “rougir”
mélange intellectuel et
affectueux
⇒ juvénile et
péremptoire
L9 “Provinciaux”;
pronom indef “on”
diérèse
=> distance ironique
reprise anaphorique et ⇒ s’impose comme
présent gnomique
moraliste + cacher
inexpérience de la vie
L11 “Mais”....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Séquence 3 : Le Malade imaginaire de Molière. Analyse linéaire n°12 scène 10 acte III
- Analyse linéaire Cyrano de Bergerac - La scène du balcon
- Analyse linéaire : le dernier feu Les vrilles de la vigne
- Argument lecture linéaire sur la princesse de clèves - scène d'aveu et caractère exceptionnel des personnages
- Analyse linéaire la princesse de Clèves - Analyse linéaire L’apparition à la cour