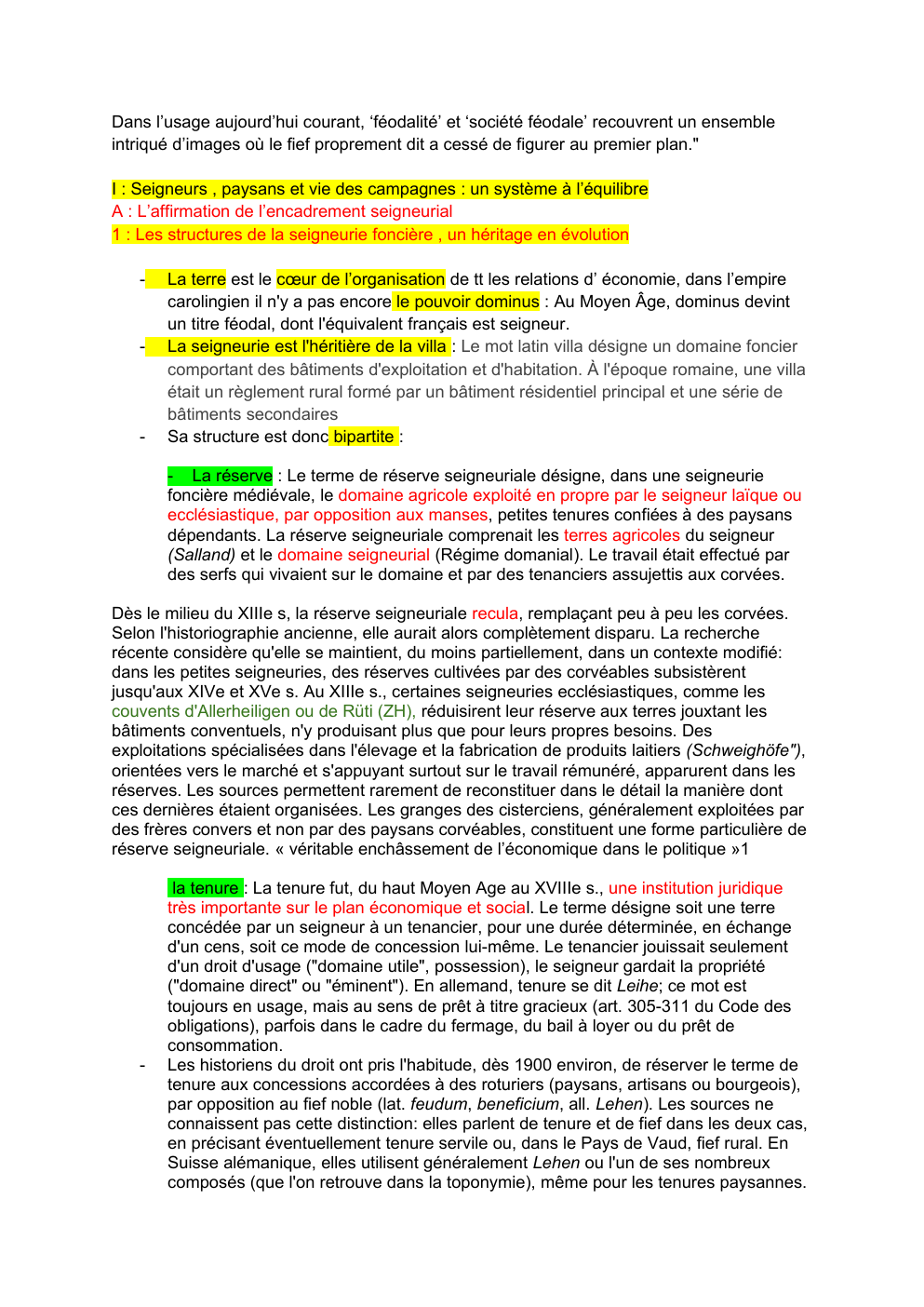Cours d’histoire de prépa: ‘féodalité’ et ‘société féodale’
Publié le 06/05/2025
Extrait du document
«
Dans l’usage aujourd’hui courant, ‘féodalité’ et ‘société féodale’ recouvrent un ensemble
intriqué d’images où le fief proprement dit a cessé de figurer au premier plan."
I : Seigneurs , paysans et vie des campagnes : un système à l’équilibre
A : L’affirmation de l’encadrement seigneurial
1 : Les structures de la seigneurie foncière , un héritage en évolution
-
-
-
La terre est le cœur de l’organisation de tt les relations d’ économie, dans l’empire
carolingien il n'y a pas encore le pouvoir dominus : Au Moyen Âge, dominus devint
un titre féodal, dont l'équivalent français est seigneur.
La seigneurie est l'héritière de la villa : Le mot latin villa désigne un domaine foncier
comportant des bâtiments d'exploitation et d'habitation.
À l'époque romaine, une villa
était un règlement rural formé par un bâtiment résidentiel principal et une série de
bâtiments secondaires
Sa structure est donc bipartite :
- La réserve : Le terme de réserve seigneuriale désigne, dans une seigneurie
foncière médiévale, le domaine agricole exploité en propre par le seigneur laïque ou
ecclésiastique, par opposition aux manses, petites tenures confiées à des paysans
dépendants.
La réserve seigneuriale comprenait les terres agricoles du seigneur
(Salland) et le domaine seigneurial (Régime domanial).
Le travail était effectué par
des serfs qui vivaient sur le domaine et par des tenanciers assujettis aux corvées.
Dès le milieu du XIIIe s, la réserve seigneuriale recula, remplaçant peu à peu les corvées.
Selon l'historiographie ancienne, elle aurait alors complètement disparu.
La recherche
récente considère qu'elle se maintient, du moins partiellement, dans un contexte modifié:
dans les petites seigneuries, des réserves cultivées par des corvéables subsistèrent
jusqu'aux XIVe et XVe s.
Au XIIIe s., certaines seigneuries ecclésiastiques, comme les
couvents d'Allerheiligen ou de Rüti (ZH), réduisirent leur réserve aux terres jouxtant les
bâtiments conventuels, n'y produisant plus que pour leurs propres besoins.
Des
exploitations spécialisées dans l'élevage et la fabrication de produits laitiers (Schweighöfe"),
orientées vers le marché et s'appuyant surtout sur le travail rémunéré, apparurent dans les
réserves.
Les sources permettent rarement de reconstituer dans le détail la manière dont
ces dernières étaient organisées.
Les granges des cisterciens, généralement exploitées par
des frères convers et non par des paysans corvéables, constituent une forme particulière de
réserve seigneuriale.
« véritable enchâssement de l’économique dans le politique »1
-
la tenure : La tenure fut, du haut Moyen Age au XVIIIe s., une institution juridique
très importante sur le plan économique et social.
Le terme désigne soit une terre
concédée par un seigneur à un tenancier, pour une durée déterminée, en échange
d'un cens, soit ce mode de concession lui-même.
Le tenancier jouissait seulement
d'un droit d'usage ("domaine utile", possession), le seigneur gardait la propriété
("domaine direct" ou "éminent").
En allemand, tenure se dit Leihe; ce mot est
toujours en usage, mais au sens de prêt à titre gracieux (art.
305-311 du Code des
obligations), parfois dans le cadre du fermage, du bail à loyer ou du prêt de
consommation.
Les historiens du droit ont pris l'habitude, dès 1900 environ, de réserver le terme de
tenure aux concessions accordées à des roturiers (paysans, artisans ou bourgeois),
par opposition au fief noble (lat.
feudum, beneficium, all.
Lehen).
Les sources ne
connaissent pas cette distinction: elles parlent de tenure et de fief dans les deux cas,
en précisant éventuellement tenure servile ou, dans le Pays de Vaud, fief rural.
En
Suisse alémanique, elles utilisent généralement Lehen ou l'un de ses nombreux
composés (que l'on retrouve dans la toponymie), même pour les tenures paysannes.
-
-
-
-
On trouve d'autre part les termes censive, censière (Jura, Neuchâtel) et manso
(Tessin).
Le seigneur baille à un paysan contre tout un tas d’autres services.
Il y avait
^plusieurs types de tenures
Mais ce monde était en mutation avec deux changements perceptibles : 1 : les
réserves étaient mises en location + démembrement de la réserve , amélioration du
système organisé de manière rationnelle visent la rentabilité = effet incastellamento +
l'indominicatum : les sols cultivés par le maître et ses agents,: installer un maître = 2
: prélèvement de + en + numéraire.
Donc cela témoigne de la financiarisation de
l’économie prémoderne.
Mais cela va à l’encontre du W des alleutiers “ ils les volent “ ( forme de
concurrence )
Mais les services sont nombreux et variables selon les régions, au nord c'était la ou
elles étaient le plus fortes.
Il y avait donc les redevances féodales
: Par redevances féodales, on entend toutes les charges, taxes, impôts et services,
institués avant l'époque de la Révolution française et dus à un seigneur par ses
dépendants (sujets, tenanciers, serfs), en vertu de liens personnels.
L'adjectif
"féodal" (Féodalisme) fait penser qu'il s'agit des redevances dérivant du droit des
fiefs.
Mais les révolutionnaires qualifièrent de féodal tout ce qui ni était lié à l'ordre
antérieur.
Sous la République helvétique, on en vint à appeler redevances féodales
(all.
Feudallasten) toutes les charges prérévolutionnaires, aussi bien celles qui
relevaient du droit des fiefs que l'ensemble des anciens droits seigneuriaux liés aux
multiples aspects de la seigneurie (domination sur les personnes, sur les serfs,
seigneurie justicière, ecclésiastique ou seigneurie foncière).Le concept forgé par les
révolutionnaires impliquait une idée d'illégitimité.
Le marxisme-léninisme y ajouta
celle d'exploitation: les redevances féodales servaient à exploiter les paysans.
Cette
interprétation idéologique ne manqua pas d'influencer au XXe s.
l'image
prédominante du Moyen Age et de l'Ancien Régime (le dictionnaire Brockhaus parle
ainsi en 1908 de redevances "opprimant" les paysans).
Les corvées (du bas latin corrogata, sous-entendu opera) étaient des prestations en
services, non rémunérées, exigées par un seigneur, ce qu'expriment les termes
allemands de Fronen ou Frondienste (du moyen haut allemand vron, seigneur).
Elles
faisaient partie des charges féodales, au même titre que les redevances en nature
ou en espèces.
Les corvées tiraient leur origine du régime domanial du haut Moyen
Age et du Moyen Age classique.
Juridiquement, elles faisaient partie du droit des
tenanciers qui régissait les rapports entre le seigneur et les paysans qui cultivaient
soit des manses, soit de plus petites tenures domaniales.
Selon la surface de la
réserve seigneuriale, le propriétaire ou l'intendant devait faire appel à la force de
travail de ces paysans et de leur entourage pour mener à chef les gros travaux
agricoles (labours, semailles, récoltes; agriculture).
Champart : Le champart est une redevance du paysan due au seigneur, à l' Époque
féodale et sous l' Ancien Régime, qui consiste à prélever une part de la récolte, à
céder au seigneur
Tout cela est accompagné d’autres interdiction comme le formariage et les mains
mortes
2 : La seigneurie banale et les coutumes : dominer les hommes
-
La coutume est fixé dans le ban = autorisation de punir : exercer une
contrainte de manière brutale : Les banalités : ensemble de façon de faire/
coutumes prise dans l'exercice du droit = honor comtae + réputation : Ouir
Nobile avec la pulvérisation des pouvoirs donc relever l’hc est exercé le
pouvoir de ban.
Les seigneurs exigent les r et c au nom du ban.
Délimitent
aussi le ressort chatelain : espace délimité avec un lieu qui polarise le
château et c’est autour de lui que l’org se construit = espace holique
( structuré de manière sacré ) et cours princière pour convoquer ses vassaux
: réunir dans la chambre d'audience et le plaid : une cour publique ou une
assemblée où un souverain, ou un comte le représentant, prend conseil
auprès d'aristocrates, appelés barons ou vassaux sur les affaires de son État
ou de son domaine.+ tour de guet et concurrence entre les paroisses
ex : le plaid tenu à Beauvais en 1114, où il rassembla ses vassaux pour
juger et condamner Thomas de Marle, seigneur de Coucy, connu pour ses
exactions contre l’Église et les paysans.
Lors de cette assemblée, les
vassaux du roi discutèrent de son sort et décidèrent de mener une expédition
militaire pour l’arrêter.= affirmer l’autorité face aux seigneur
-
Dans les espaces intermédiaires on met souvent les ministériels : Les
ministériels (parfois ministérial, du latin: ministerialis), à l'origine des serfs
utilisés comme hommes de main et intendants des seigneurs et abbés,
comptèrent bientôt des serviteurs de haut rang, au service du prince ou d'un
évêque au Moyen Âge
ex : : Au XIIe siècle, le Saint-Empire romain germanique connaissait une
organisation féodale particulière où les ministeriales (ministériaux) formaient
une classe de serviteurs nobles, souvent d’origine non noble, mais qui
occupaient des fonctions administratives et militaires essentielles.Werner von
Bolanden était un ministérial impérial chargé de l’administration et de la
gestion des territoires sous Frédéric Barberousse.
-
Voire officier de la Couronne.
+ equipement banneaux transforme leur pn
ex : moulin hydraulique , four, pressoirs , ports : viabiliser un espace pma
mais toujours en concurrence pour la guerre :
Au Moyen Âge, terre, domaine auquel un serf était attaché et avec lequel il
était vendu.
Les serfs de la glèbe.
+ macul servile : l'état d'un individu ou d'un
groupe qui vivait sous une forme de servitude ou de dépendance, ce....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- cours HISTOIRE ET VIOLENCE hlp
- Foucault : il faut défendre la société (cours au collège de France)
- 1913, l'Europe domine le Monde - Cours géopolitique prépa ECG1
- cours Prépa: Qui suis-je ?
- «L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes» - Marx