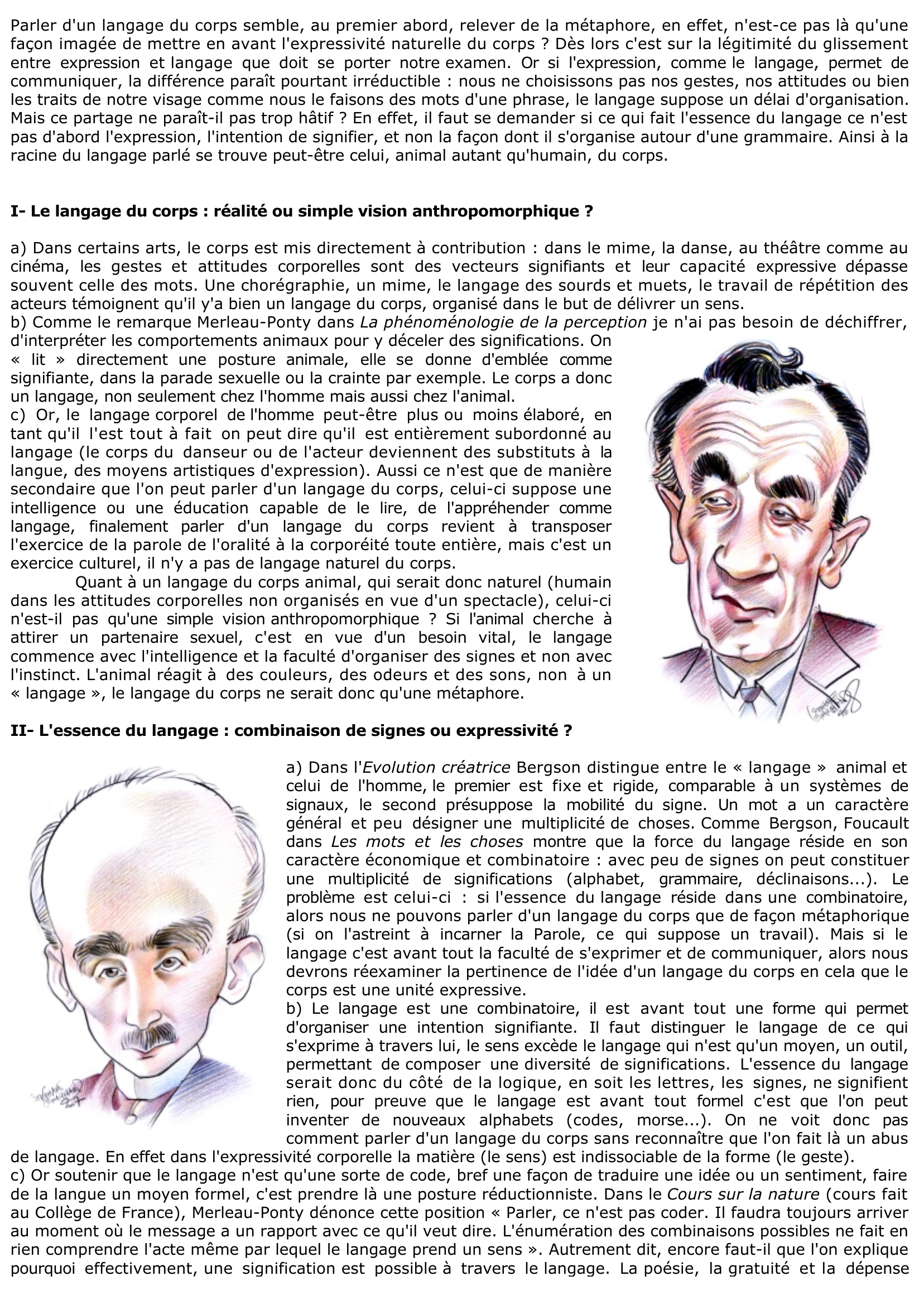Y a-t-il un langage du corps?
Extrait du document
«
Parler d'un langage du corps semble, au premier abord, relever de la métaphore, en effet, n'est-ce pas là qu'une
façon imagée de mettre en avant l'expressivité naturelle du corps ? Dès lors c'est sur la légitimité du glissement
entre expression et langage que doit se porter notre examen.
Or si l'expression, comme le langage, permet de
communiquer, la différence paraît pourtant irréductible : nous ne choisissons pas nos gestes, nos attitudes ou bien
les traits de notre visage comme nous le faisons des mots d'une phrase, le langage suppose un délai d'organisation.
Mais ce partage ne paraît-il pas trop hâtif ? En effet, il faut se demander si ce qui fait l'essence du langage ce n'est
pas d'abord l'expression, l'intention de signifier, et non la façon dont il s'organise autour d'une grammaire.
Ainsi à la
racine du langage parlé se trouve peut-être celui, animal autant qu'humain, du corps.
I- Le langage du corps : réalité ou simple vision anthropomorphique ?
a) Dans certains arts, le corps est mis directement à contribution : dans le mime, la danse, au théâtre comme au
cinéma, les gestes et attitudes corporelles sont des vecteurs signifiants et leur capacité expressive dépasse
souvent celle des mots.
Une chorégraphie, un mime, le langage des sourds et muets, le travail de répétition des
acteurs témoignent qu'il y'a bien un langage du corps, organisé dans le but de délivrer un sens.
b) Comme le remarque Merleau-Ponty dans La phénoménologie de la perception je n'ai pas besoin de déchiffrer,
d'interpréter les comportements animaux pour y déceler des significations.
On
« lit » directement une posture animale, elle se donne d'emblée comme
signifiante, dans la parade sexuelle ou la crainte par exemple.
Le corps a donc
un langage, non seulement chez l'homme mais aussi chez l'animal.
c) Or, le langage corporel de l'homme peut-être plus ou moins élaboré, en
tant qu'il l'est tout à fait on peut dire qu'il est entièrement subordonné au
langage (le corps du danseur ou de l'acteur deviennent des substituts à la
langue, des moyens artistiques d'expression).
Aussi ce n'est que de manière
secondaire que l'on peut parler d'un langage du corps, celui-ci suppose une
intelligence ou une éducation capable de le lire, de l'appréhender comme
langage, finalement parler d'un langage du corps revient à transposer
l'exercice de la parole de l'oralité à la corporéité toute entière, mais c'est un
exercice culturel, il n'y a pas de langage naturel du corps.
Quant à un langage du corps animal, qui serait donc naturel (humain
dans les attitudes corporelles non organisés en vue d'un spectacle), celui-ci
n'est-il pas qu'une simple vision anthropomorphique ? Si l'animal cherche à
attirer un partenaire sexuel, c'est en vue d'un besoin vital, le langage
commence avec l'intelligence et la faculté d'organiser des signes et non avec
l'instinct.
L'animal réagit à des couleurs, des odeurs et des sons, non à un
« langage », le langage du corps ne serait donc qu'une métaphore.
II- L'essence du langage : combinaison de signes ou expressivité ?
a) Dans l'Evolution créatrice Bergson distingue entre le « langage » animal et
celui de l'homme, le premier est fixe et rigide, comparable à un systèmes de
signaux, le second présuppose la mobilité du signe.
Un mot a un caractère
général et peu désigner une multiplicité de choses.
Comme Bergson, Foucault
dans Les mots et les choses montre que la force du langage réside en son
caractère économique et combinatoire : avec peu de signes on peut constituer
une multiplicité de significations (alphabet, grammaire, déclinaisons...).
Le
problème est celui-ci : si l'essence du langage réside dans une combinatoire,
alors nous ne pouvons parler d'un langage du corps que de façon métaphorique
(si on l'astreint à incarner la Parole, ce qui suppose un travail).
Mais si le
langage c'est avant tout la faculté de s'exprimer et de communiquer, alors nous
devrons réexaminer la pertinence de l'idée d'un langage du corps en cela que le
corps est une unité expressive.
b) Le langage est une combinatoire, il est avant tout une forme qui permet
d'organiser une intention signifiante.
Il faut distinguer le langage de ce qui
s'exprime à travers lui, le sens excède le langage qui n'est qu'un moyen, un outil,
permettant de composer une diversité de significations.
L'essence du langage
serait donc du côté de la logique, en soit les lettres, les signes, ne signifient
rien, pour preuve que le langage est avant tout formel c'est que l'on peut
inventer de nouveaux alphabets (codes, morse...).
On ne voit donc pas
comment parler d'un langage du corps sans reconnaître que l'on fait là un abus
de langage.
En effet dans l'expressivité corporelle la matière (le sens) est indissociable de la forme (le geste).
c) Or soutenir que le langage n'est qu'une sorte de code, bref une façon de traduire une idée ou un sentiment, faire
de la langue un moyen formel, c'est prendre là une posture réductionniste.
Dans le Cours sur la nature (cours fait
au Collège de France), Merleau-Ponty dénonce cette position « Parler, ce n'est pas coder.
Il faudra toujours arriver
au moment où le message a un rapport avec ce qu'il veut dire.
L'énumération des combinaisons possibles ne fait en
rien comprendre l'acte même par lequel le langage prend un sens ».
Autrement dit, encore faut-il que l'on explique
pourquoi effectivement, une signification est possible à travers le langage.
La poésie, la gratuité et la dépense.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « La loi de l’homme est la loi du langage » JACQUES LACAN
- « Je suis donc mon corps » MAURICE MERLEAU-PONTY
- Le langage et la pensee sont-ils des processus interdépendantes?
- Cour HLP sur Dans «L'Invention des corps» de Ducrozet
- Le langage est-il l'instrument idéal de la pensée ?