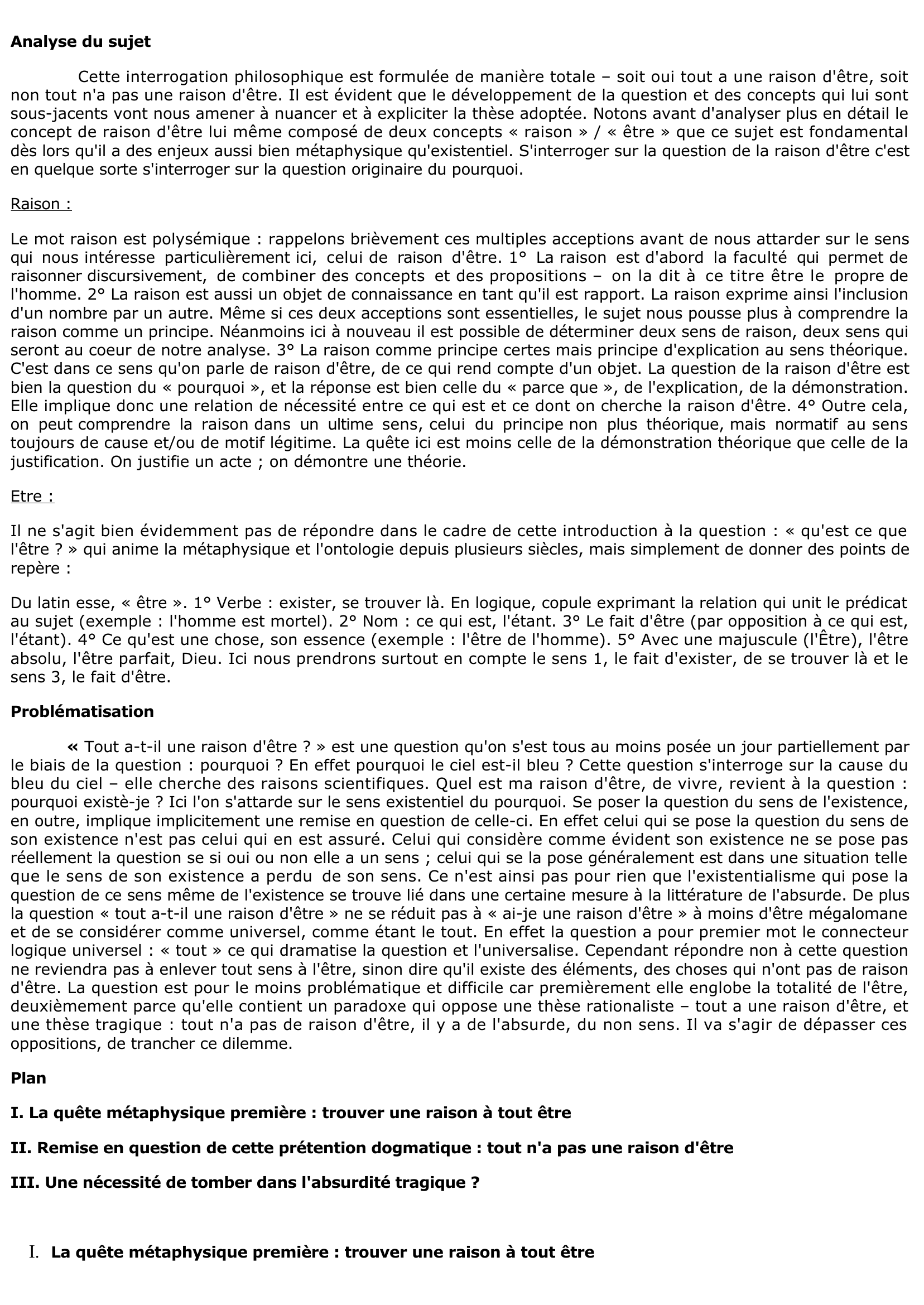Tout a-t-il une raison d'être ?
Extrait du document
«
Analyse du sujet
Cette interrogation philosophique est formulée de manière totale – soit oui tout a une raison d'être, soit
non tout n'a pas une raison d'être.
Il est évident que le développement de la question et des concepts qui lui sont
sous-jacents vont nous amener à nuancer et à expliciter la thèse adoptée.
Notons avant d'analyser plus en détail le
concept de raison d'être lui même composé de deux concepts « raison » / « être » que ce sujet est fondamental
dès lors qu'il a des enjeux aussi bien métaphysique qu'existentiel.
S'interroger sur la question de la raison d'être c'est
en quelque sorte s'interroger sur la question originaire du pourquoi.
Raison :
Le mot raison est polysémique : rappelons brièvement ces multiples acceptions avant de nous attarder sur le sens
qui nous intéresse particulièrement ici, celui de raison d'être.
1° La raison est d'abord la faculté qui permet de
raisonner discursivement, de combiner des concepts et des propositions – on la dit à ce titre être le propre de
l'homme.
2° La raison est aussi un objet de connaissance en tant qu'il est rapport.
La raison exprime ainsi l'inclusion
d'un nombre par un autre.
Même si ces deux acceptions sont essentielles, le sujet nous pousse plus à comprendre la
raison comme un principe.
Néanmoins ici à nouveau il est possible de déterminer deux sens de raison, deux sens qui
seront au coeur de notre analyse.
3° La raison comme principe certes mais principe d'explication au sens théorique.
C'est dans ce sens qu'on parle de raison d'être, de ce qui rend compte d'un objet.
La question de la raison d'être est
bien la question du « pourquoi », et la réponse est bien celle du « parce que », de l'explication, de la démonstration.
Elle implique donc une relation de nécessité entre ce qui est et ce dont on cherche la raison d'être.
4° Outre cela,
on peut comprendre la raison dans un ultime sens, celui du principe non plus théorique, mais normatif au sens
toujours de cause et/ou de motif légitime.
La quête ici est moins celle de la démonstration théorique que celle de la
justification.
On justifie un acte ; on démontre une théorie.
Etre :
Il ne s'agit bien évidemment pas de répondre dans le cadre de cette introduction à la question : « qu'est ce que
l'être ? » qui anime la métaphysique et l'ontologie depuis plusieurs siècles, mais simplement de donner des points de
repère :
Du latin esse, « être ».
1° Verbe : exister, se trouver là.
En logique, copule exprimant la relation qui unit le prédicat
au sujet (exemple : l'homme est mortel).
2° Nom : ce qui est, l'étant.
3° Le fait d'être (par opposition à ce qui est,
l'étant).
4° Ce qu'est une chose, son essence (exemple : l'être de l'homme).
5° Avec une majuscule (l'Être), l'être
absolu, l'être parfait, Dieu.
Ici nous prendrons surtout en compte le sens 1, le fait d'exister, de se trouver là et le
sens 3, le fait d'être.
Problématisation
« Tout a-t-il une raison d'être ? » est une question qu'on s'est tous au moins posée un jour partiellement par
le biais de la question : pourquoi ? En effet pourquoi le ciel est-il bleu ? Cette question s'interroge sur la cause du
bleu du ciel – elle cherche des raisons scientifiques.
Quel est ma raison d'être, de vivre, revient à la question :
pourquoi existè-je ? Ici l'on s'attarde sur le sens existentiel du pourquoi.
Se poser la question du sens de l'existence,
en outre, implique implicitement une remise en question de celle-ci.
En effet celui qui se pose la question du sens de
son existence n'est pas celui qui en est assuré.
Celui qui considère comme évident son existence ne se pose pas
réellement la question se si oui ou non elle a un sens ; celui qui se la pose généralement est dans une situation telle
que le sens de son existence a perdu de son sens.
Ce n'est ainsi pas pour rien que l'existentialisme qui pose la
question de ce sens même de l'existence se trouve lié dans une certaine mesure à la littérature de l'absurde.
De plus
la question « tout a-t-il une raison d'être » ne se réduit pas à « ai-je une raison d'être » à moins d'être mégalomane
et de se considérer comme universel, comme étant le tout.
En effet la question a pour premier mot le connecteur
logique universel : « tout » ce qui dramatise la question et l'universalise.
Cependant répondre non à cette question
ne reviendra pas à enlever tout sens à l'être, sinon dire qu'il existe des éléments, des choses qui n'ont pas de raison
d'être.
La question est pour le moins problématique et difficile car premièrement elle englobe la totalité de l'être,
deuxièmement parce qu'elle contient un paradoxe qui oppose une thèse rationaliste – tout a une raison d'être, et
une thèse tragique : tout n'a pas de raison d'être, il y a de l'absurde, du non sens.
Il va s'agir de dépasser ces
oppositions, de trancher ce dilemme.
Plan
I.
La quête métaphysique première : trouver une raison à tout être
II.
Remise en question de cette prétention dogmatique : tout n'a pas une raison d'être
III.
Une nécessité de tomber dans l'absurdité tragique ?
I.
La quête métaphysique première : trouver une raison à tout être.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les sens sans la raison son vides, mais la raison sans les sens est aveugle (Kant)
- « La seule raison légitime que puisse avoir une société pour user de la force contre un de ses membres est de l'empêcher de nuire aux autres»
- raison et vérité
- La raison permet-elle d’échapper au doute ?
- Sujet 1 : La culture peut-elle dénaturer l'homme ? Sujet 2 : Peut-on avoir raison contre les faits ?