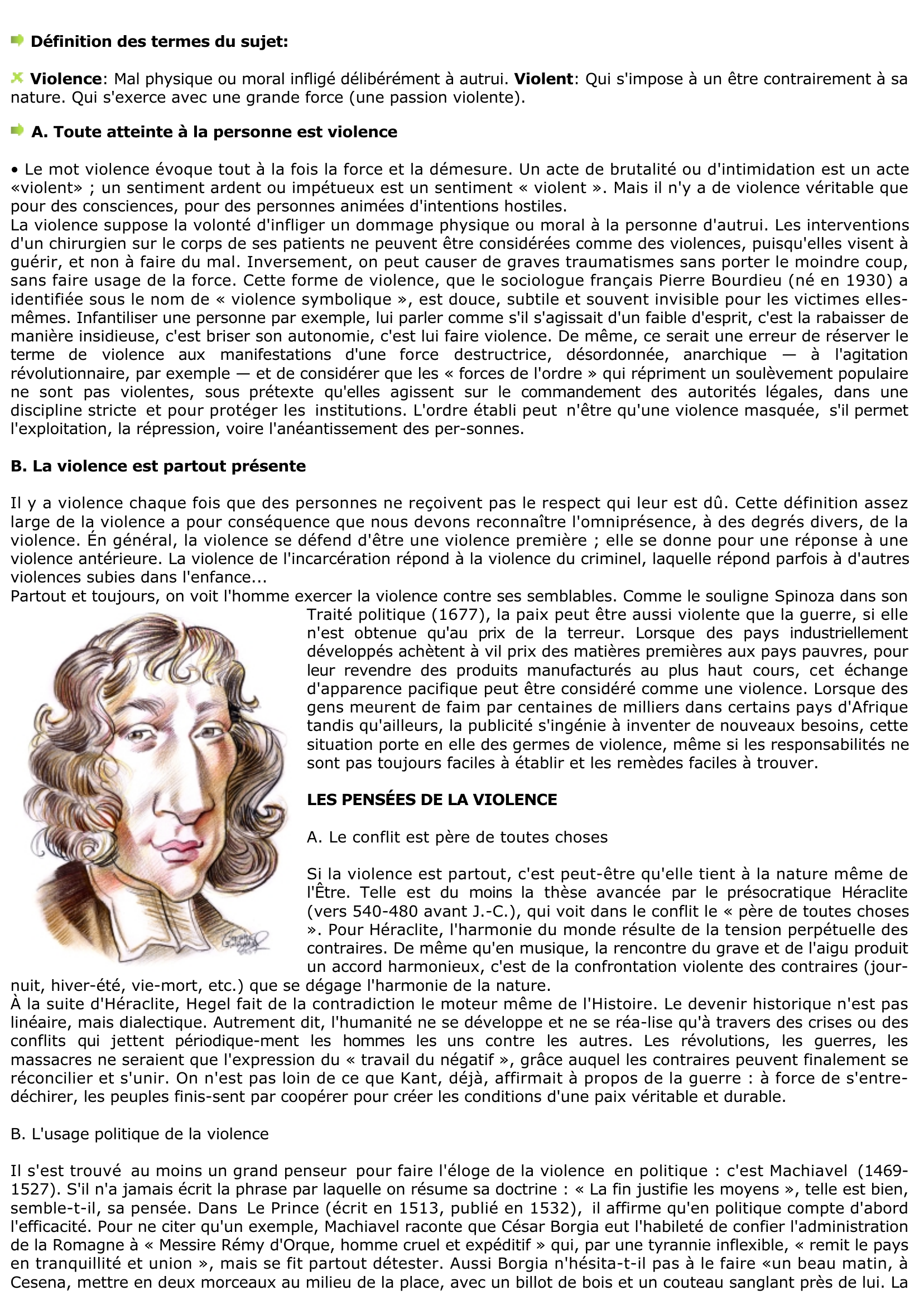Qu'est-ce que la violence ?
Extrait du document
«
Définition des termes du sujet:
Violence: Mal physique ou moral infligé délibérément à autrui.
Violent: Qui s'impose à un être contrairement à sa
nature.
Qui s'exerce avec une grande force (une passion violente).
A.
Toute atteinte à la personne est violence
• Le mot violence évoque tout à la fois la force et la démesure.
Un acte de brutalité ou d'intimidation est un acte
«violent» ; un sentiment ardent ou impétueux est un sentiment « violent ».
Mais il n'y a de violence véritable que
pour des consciences, pour des personnes animées d'intentions hostiles.
La violence suppose la volonté d'infliger un dommage physique ou moral à la personne d'autrui.
Les interventions
d'un chirurgien sur le corps de ses patients ne peuvent être considérées comme des violences, puisqu'elles visent à
guérir, et non à faire du mal.
Inversement, on peut causer de graves traumatismes sans porter le moindre coup,
sans faire usage de la force.
Cette forme de violence, que le sociologue français Pierre Bourdieu (né en 1930) a
identifiée sous le nom de « violence symbolique », est douce, subtile et souvent invisible pour les victimes ellesmêmes.
Infantiliser une personne par exemple, lui parler comme s'il s'agissait d'un faible d'esprit, c'est la rabaisser de
manière insidieuse, c'est briser son autonomie, c'est lui faire violence.
De même, ce serait une erreur de réserver le
terme de violence aux manifestations d'une force destructrice, désordonnée, anarchique — à l'agitation
révolutionnaire, par exemple — et de considérer que les « forces de l'ordre » qui répriment un soulèvement populaire
ne sont pas violentes, sous prétexte qu'elles agissent sur le commandement des autorités légales, dans une
discipline stricte et pour protéger les institutions.
L'ordre établi peut n'être qu'une violence masquée, s'il permet
l'exploitation, la répression, voire l'anéantissement des per-sonnes.
B.
La violence est partout présente
Il y a violence chaque fois que des personnes ne reçoivent pas le respect qui leur est dû.
Cette définition assez
large de la violence a pour conséquence que nous devons reconnaître l'omniprésence, à des degrés divers, de la
violence.
Én général, la violence se défend d'être une violence première ; elle se donne pour une réponse à une
violence antérieure.
La violence de l'incarcération répond à la violence du criminel, laquelle répond parfois à d'autres
violences subies dans l'enfance...
Partout et toujours, on voit l'homme exercer la violence contre ses semblables.
Comme le souligne Spinoza dans son
Traité politique (1677), la paix peut être aussi violente que la guerre, si elle
n'est obtenue qu'au prix de la terreur.
Lorsque des pays industriellement
développés achètent à vil prix des matières premières aux pays pauvres, pour
leur revendre des produits manufacturés au plus haut cours, cet échange
d'apparence pacifique peut être considéré comme une violence.
Lorsque des
gens meurent de faim par centaines de milliers dans certains pays d'Afrique
tandis qu'ailleurs, la publicité s'ingénie à inventer de nouveaux besoins, cette
situation porte en elle des germes de violence, même si les responsabilités ne
sont pas toujours faciles à établir et les remèdes faciles à trouver.
LES PENSÉES DE LA VIOLENCE
A.
Le conflit est père de toutes choses
Si la violence est partout, c'est peut-être qu'elle tient à la nature même de
l'Être.
Telle est du moins la thèse avancée par le présocratique Héraclite
(vers 540-480 avant J.-C.), qui voit dans le conflit le « père de toutes choses
».
Pour Héraclite, l'harmonie du monde résulte de la tension perpétuelle des
contraires.
De même qu'en musique, la rencontre du grave et de l'aigu produit
un accord harmonieux, c'est de la confrontation violente des contraires (journuit, hiver-été, vie-mort, etc.) que se dégage l'harmonie de la nature.
À la suite d'Héraclite, Hegel fait de la contradiction le moteur même de l'Histoire.
Le devenir historique n'est pas
linéaire, mais dialectique.
Autrement dit, l'humanité ne se développe et ne se réa-lise qu'à travers des crises ou des
conflits qui jettent périodique-ment les hommes les uns contre les autres.
Les révolutions, les guerres, les
massacres ne seraient que l'expression du « travail du négatif », grâce auquel les contraires peuvent finalement se
réconcilier et s'unir.
On n'est pas loin de ce que Kant, déjà, affirmait à propos de la guerre : à force de s'entredéchirer, les peuples finis-sent par coopérer pour créer les conditions d'une paix véritable et durable.
B.
L'usage politique de la violence
Il s'est trouvé au moins un grand penseur pour faire l'éloge de la violence en politique : c'est Machiavel (14691527).
S'il n'a jamais écrit la phrase par laquelle on résume sa doctrine : « La fin justifie les moyens », telle est bien,
semble-t-il, sa pensée.
Dans Le Prince (écrit en 1513, publié en 1532), il affirme qu'en politique compte d'abord
l'efficacité.
Pour ne citer qu'un exemple, Machiavel raconte que César Borgia eut l'habileté de confier l'administration
de la Romagne à « Messire Rémy d'Orque, homme cruel et expéditif » qui, par une tyrannie inflexible, « remit le pays
en tranquillité et union », mais se fit partout détester.
Aussi Borgia n'hésita-t-il pas à le faire «un beau matin, à
Cesena, mettre en deux morceaux au milieu de la place, avec un billot de bois et un couteau sanglant près de lui.
La.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- En quoi peut-on dire que la violence est au cœur des régimes totalitaires et de leur idéologie ?
- Démocratie et violence en côte d'ivoire: contribution à l'émergence d'une société nouvelle
- les femmes victimes de violence sexuelles et sexistes
- discuter est ce renoncer à la violence
- cours HISTOIRE ET VIOLENCE hlp