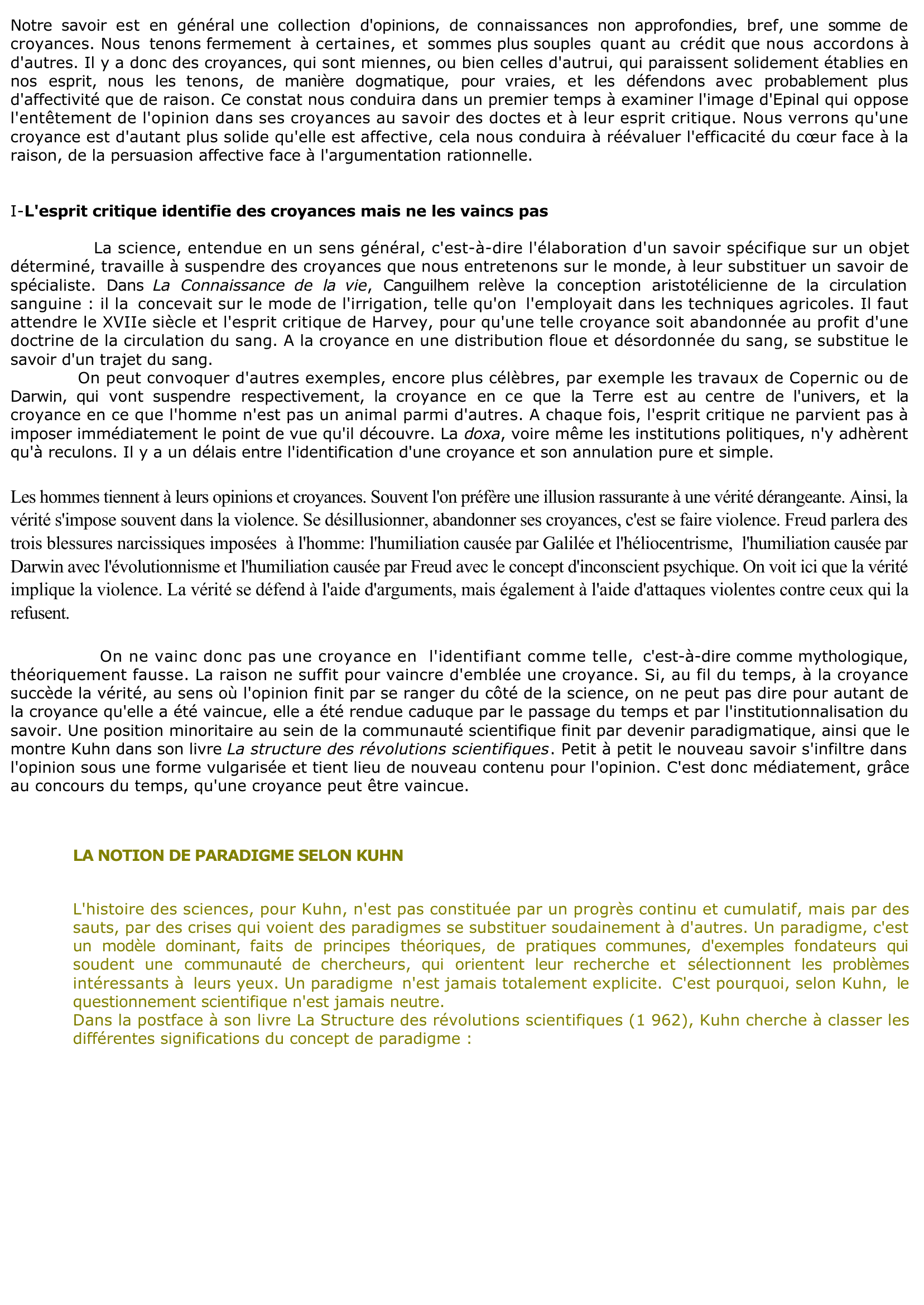Peut on vaincre une croyance ?
Extrait du document
«
Notre savoir est en général une collection d'opinions, de connaissances non approfondies, bref, une somme de
croyances.
Nous tenons fermement à certaines, et sommes plus souples quant au crédit que nous accordons à
d'autres.
Il y a donc des croyances, qui sont miennes, ou bien celles d'autrui, qui paraissent solidement établies en
nos esprit, nous les tenons, de manière dogmatique, pour vraies, et les défendons avec probablement plus
d'affectivité que de raison.
Ce constat nous conduira dans un premier temps à examiner l'image d'Epinal qui oppose
l'entêtement de l'opinion dans ses croyances au savoir des doctes et à leur esprit critique.
Nous verrons qu'une
croyance est d'autant plus solide qu'elle est affective, cela nous conduira à réévaluer l'efficacité du cœur face à la
raison, de la persuasion affective face à l'argumentation rationnelle.
I-L'esprit critique identifie des croyances mais ne les vaincs pas
La science, entendue en un sens général, c'est-à-dire l'élaboration d'un savoir spécifique sur un objet
déterminé, travaille à suspendre des croyances que nous entretenons sur le monde, à leur substituer un savoir de
spécialiste.
Dans La Connaissance de la vie, Canguilhem relève la conception aristotélicienne de la circulation
sanguine : il la concevait sur le mode de l'irrigation, telle qu'on l'employait dans les techniques agricoles.
Il faut
attendre le XVIIe siècle et l'esprit critique de Harvey, pour qu'une telle croyance soit abandonnée au profit d'une
doctrine de la circulation du sang.
A la croyance en une distribution floue et désordonnée du sang, se substitue le
savoir d'un trajet du sang.
On peut convoquer d'autres exemples, encore plus célèbres, par exemple les travaux de Copernic ou de
Darwin, qui vont suspendre respectivement, la croyance en ce que la Terre est au centre de l'univers, et la
croyance en ce que l'homme n'est pas un animal parmi d'autres.
A chaque fois, l'esprit critique ne parvient pas à
imposer immédiatement le point de vue qu'il découvre.
La doxa, voire même les institutions politiques, n'y adhèrent
qu'à reculons.
Il y a un délais entre l'identification d'une croyance et son annulation pure et simple.
Les hommes tiennent à leurs opinions et croyances.
Souvent l'on préfère une illusion rassurante à une vérité dérangeante.
Ainsi, la
vérité s'impose souvent dans la violence.
Se désillusionner, abandonner ses croyances, c'est se faire violence.
Freud parlera des
trois blessures narcissiques imposées à l'homme: l'humiliation causée par Galilée et l'héliocentrisme, l'humiliation causée par
Darwin avec l'évolutionnisme et l'humiliation causée par Freud avec le concept d'inconscient psychique.
On voit ici que la vérité
implique la violence.
La vérité se défend à l'aide d'arguments, mais également à l'aide d'attaques violentes contre ceux qui la
refusent.
On ne vainc donc pas une croyance en l'identifiant comme telle, c'est-à-dire comme mythologique,
théoriquement fausse.
La raison ne suffit pour vaincre d'emblée une croyance.
Si, au fil du temps, à la croyance
succède la vérité, au sens où l'opinion finit par se ranger du côté de la science, on ne peut pas dire pour autant de
la croyance qu'elle a été vaincue, elle a été rendue caduque par le passage du temps et par l'institutionnalisation du
savoir.
Une position minoritaire au sein de la communauté scientifique finit par devenir paradigmatique, ainsi que le
montre Kuhn dans son livre La structure des révolutions scientifiques.
Petit à petit le nouveau savoir s'infiltre dans
l'opinion sous une forme vulgarisée et tient lieu de nouveau contenu pour l'opinion.
C'est donc médiatement, grâce
au concours du temps, qu'une croyance peut être vaincue.
LA NOTION DE PARADIGME SELON KUHN
L'histoire des sciences, pour Kuhn, n'est pas constituée par un progrès continu et cumulatif, mais par des
sauts, par des crises qui voient des paradigmes se substituer soudainement à d'autres.
Un paradigme, c'est
un modèle dominant, faits de principes théoriques, de pratiques communes, d'exemples fondateurs qui
soudent une communauté de chercheurs, qui orientent leur recherche et sélectionnent les problèmes
intéressants à leurs yeux.
Un paradigme n'est jamais totalement explicite.
C'est pourquoi, selon Kuhn, le
questionnement scientifique n'est jamais neutre.
Dans la postface à son livre La Structure des révolutions scientifiques (1 962), Kuhn cherche à classer les
différentes significations du concept de paradigme :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Philosophie: croyance, certitude et vérité
- Pascal: La raison peut-elle faire l'économie de la croyance ?
- Jean-Jacques Rousseau: La raison peut-elle vaincre les passions ?
- Vaincre la crainte de la mort ?
- La croyance en Dieu exclut-elle le raisonnement ?