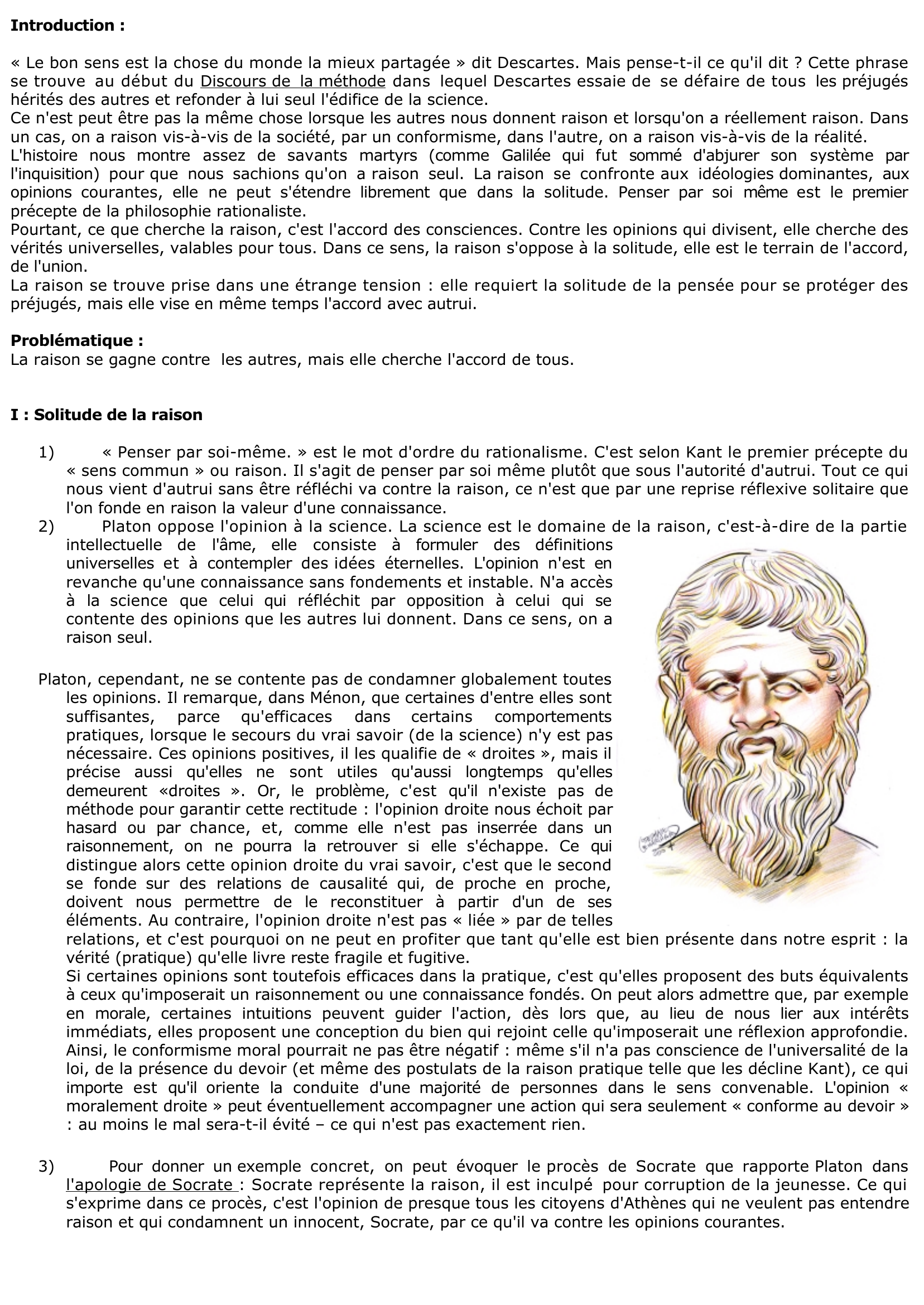Peut-on avoir raison tout seul ?
Extrait du document
«
Introduction :
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » dit Descartes.
Mais pense-t-il ce qu'il dit ? Cette phrase
se trouve au début du Discours de la méthode dans lequel Descartes essaie de se défaire de tous les préjugés
hérités des autres et refonder à lui seul l'édifice de la science.
Ce n'est peut être pas la même chose lorsque les autres nous donnent raison et lorsqu'on a réellement raison.
Dans
un cas, on a raison vis-à-vis de la société, par un conformisme, dans l'autre, on a raison vis-à-vis de la réalité.
L'histoire nous montre assez de savants martyrs (comme Galilée qui fut sommé d'abjurer son système par
l'inquisition) pour que nous sachions qu'on a raison seul.
La raison se confronte aux idéologies dominantes, aux
opinions courantes, elle ne peut s'étendre librement que dans la solitude.
Penser par soi même est le premier
précepte de la philosophie rationaliste.
Pourtant, ce que cherche la raison, c'est l'accord des consciences.
Contre les opinions qui divisent, elle cherche des
vérités universelles, valables pour tous.
Dans ce sens, la raison s'oppose à la solitude, elle est le terrain de l'accord,
de l'union.
La raison se trouve prise dans une étrange tension : elle requiert la solitude de la pensée pour se protéger des
préjugés, mais elle vise en même temps l'accord avec autrui.
Problématique :
La raison se gagne contre les autres, mais elle cherche l'accord de tous.
I : Solitude de la raison
1)
« Penser par soi-même.
» est le mot d'ordre du rationalisme.
C'est selon Kant le premier précepte du
« sens commun » ou raison.
Il s'agit de penser par soi même plutôt que sous l'autorité d'autrui.
Tout ce qui
nous vient d'autrui sans être réfléchi va contre la raison, ce n'est que par une reprise réflexive solitaire que
l'on fonde en raison la valeur d'une connaissance.
2)
Platon oppose l'opinion à la science.
La science est le domaine de la raison, c'est-à-dire de la partie
intellectuelle de l'âme, elle consiste à formuler des définitions
universelles et à contempler des idées éternelles.
L'opinion n'est en
revanche qu'une connaissance sans fondements et instable.
N'a accès
à la science que celui qui réfléchit par opposition à celui qui se
contente des opinions que les autres lui donnent.
Dans ce sens, on a
raison seul.
Platon, cependant, ne se contente pas de condamner globalement toutes
les opinions.
Il remarque, dans Ménon, que certaines d'entre elles sont
suffisantes, parce qu'efficaces dans certains comportements
pratiques, lorsque le secours du vrai savoir (de la science) n'y est pas
nécessaire.
Ces opinions positives, il les qualifie de « droites », mais il
précise aussi qu'elles ne sont utiles qu'aussi longtemps qu'elles
demeurent «droites ».
Or, le problème, c'est qu'il n'existe pas de
méthode pour garantir cette rectitude : l'opinion droite nous échoit par
hasard ou par chance, et, comme elle n'est pas inserrée dans un
raisonnement, on ne pourra la retrouver si elle s'échappe.
Ce qui
distingue alors cette opinion droite du vrai savoir, c'est que le second
se fonde sur des relations de causalité qui, de proche en proche,
doivent nous permettre de le reconstituer à partir d'un de ses
éléments.
Au contraire, l'opinion droite n'est pas « liée » par de telles
relations, et c'est pourquoi on ne peut en profiter que tant qu'elle est bien présente dans notre esprit : la
vérité (pratique) qu'elle livre reste fragile et fugitive.
Si certaines opinions sont toutefois efficaces dans la pratique, c'est qu'elles proposent des buts équivalents
à ceux qu'imposerait un raisonnement ou une connaissance fondés.
On peut alors admettre que, par exemple
en morale, certaines intuitions peuvent guider l'action, dès lors que, au lieu de nous lier aux intérêts
immédiats, elles proposent une conception du bien qui rejoint celle qu'imposerait une réflexion approfondie.
Ainsi, le conformisme moral pourrait ne pas être négatif : même s'il n'a pas conscience de l'universalité de la
loi, de la présence du devoir (et même des postulats de la raison pratique telle que les décline Kant), ce qui
importe est qu'il oriente la conduite d'une majorité de personnes dans le sens convenable.
L'opinion «
moralement droite » peut éventuellement accompagner une action qui sera seulement « conforme au devoir »
: au moins le mal sera-t-il évité – ce qui n'est pas exactement rien.
3)
Pour donner un exemple concret, on peut évoquer le procès de Socrate que rapporte Platon dans
l'apologie de Socrate : Socrate représente la raison, il est inculpé pour corruption de la jeunesse.
Ce qui
s'exprime dans ce procès, c'est l'opinion de presque tous les citoyens d'Athènes qui ne veulent pas entendre
raison et qui condamnent un innocent, Socrate, par ce qu'il va contre les opinions courantes..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les sens sans la raison son vides, mais la raison sans les sens est aveugle (Kant)
- « La seule raison légitime que puisse avoir une société pour user de la force contre un de ses membres est de l'empêcher de nuire aux autres»
- raison et vérité
- La raison permet-elle d’échapper au doute ?
- Sujet 1 : La culture peut-elle dénaturer l'homme ? Sujet 2 : Peut-on avoir raison contre les faits ?