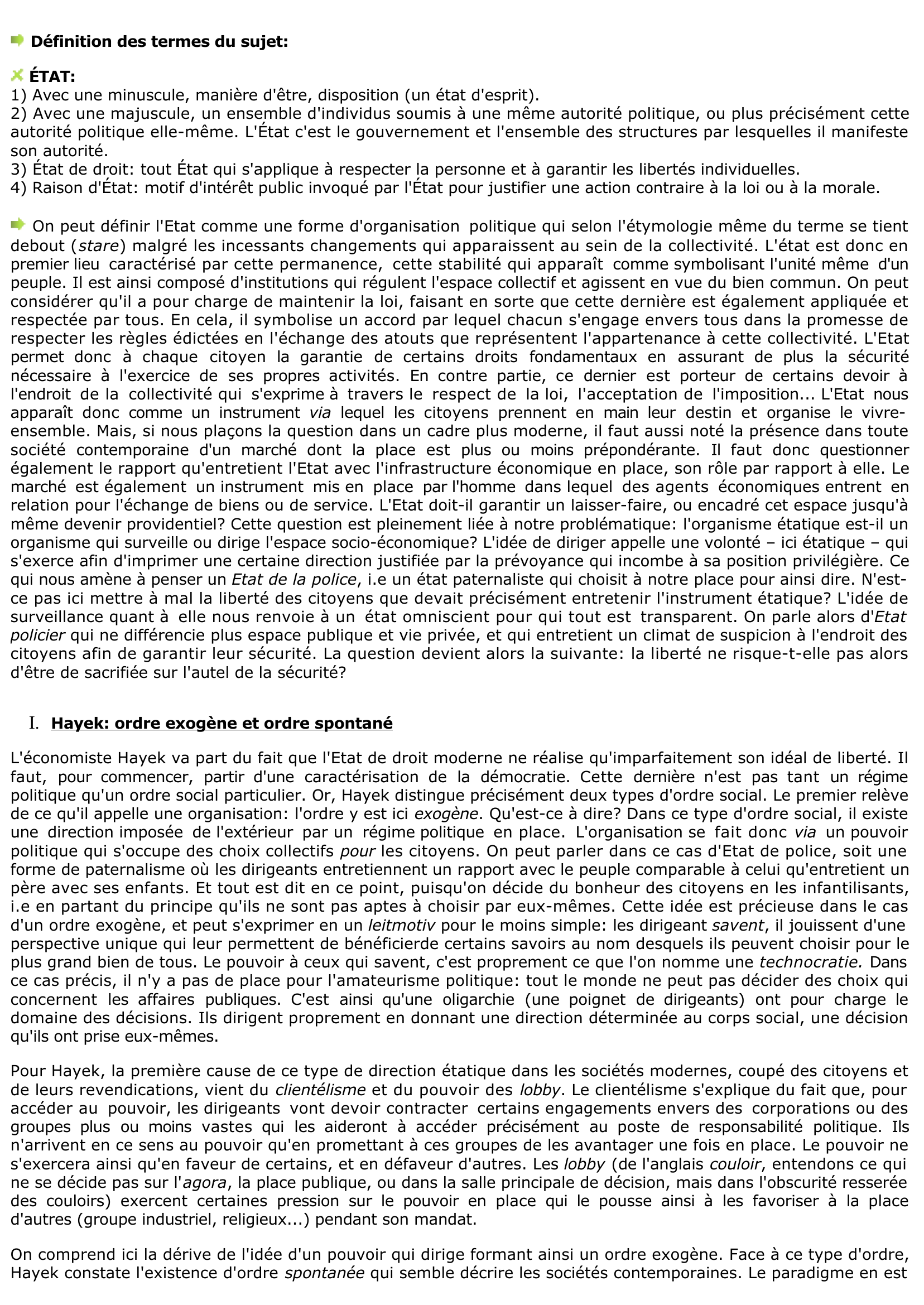L'État doit-il surveiller ou diriger ?
Extrait du document
«
Définition des termes du sujet:
ÉTAT:
1) Avec une minuscule, manière d'être, disposition (un état d'esprit).
2) Avec une majuscule, un ensemble d'individus soumis à une même autorité politique, ou plus précisément cette
autorité politique elle-même.
L'État c'est le gouvernement et l'ensemble des structures par lesquelles il manifeste
son autorité.
3) État de droit: tout État qui s'applique à respecter la personne et à garantir les libertés individuelles.
4) Raison d'État: motif d'intérêt public invoqué par l'État pour justifier une action contraire à la loi ou à la morale.
On peut définir l'Etat comme une forme d'organisation politique qui selon l'étymologie même du terme se tient
debout (stare) malgré les incessants changements qui apparaissent au sein de la collectivité.
L'état est donc en
premier lieu caractérisé par cette permanence, cette stabilité qui apparaît comme symbolisant l'unité même d'un
peuple.
Il est ainsi composé d'institutions qui régulent l'espace collectif et agissent en vue du bien commun.
On peut
considérer qu'il a pour charge de maintenir la loi, faisant en sorte que cette dernière est également appliquée et
respectée par tous.
En cela, il symbolise un accord par lequel chacun s'engage envers tous dans la promesse de
respecter les règles édictées en l'échange des atouts que représentent l'appartenance à cette collectivité.
L'Etat
permet donc à chaque citoyen la garantie de certains droits fondamentaux en assurant de plus la sécurité
nécessaire à l'exercice de ses propres activités.
En contre partie, ce dernier est porteur de certains devoir à
l'endroit de la collectivité qui s'exprime à travers le respect de la loi, l'acceptation de l'imposition...
L'Etat nous
apparaît donc comme un instrument via lequel les citoyens prennent en main leur destin et organise le vivreensemble.
Mais, si nous plaçons la question dans un cadre plus moderne, il faut aussi noté la présence dans toute
société contemporaine d'un marché dont la place est plus ou moins prépondérante.
Il faut donc questionner
également le rapport qu'entretient l'Etat avec l'infrastructure économique en place, son rôle par rapport à elle.
Le
marché est également un instrument mis en place par l'homme dans lequel des agents économiques entrent en
relation pour l'échange de biens ou de service.
L'Etat doit-il garantir un laisser-faire, ou encadré cet espace jusqu'à
même devenir providentiel? Cette question est pleinement liée à notre problématique: l'organisme étatique est-il un
organisme qui surveille ou dirige l'espace socio-économique? L'idée de diriger appelle une volonté – ici étatique – qui
s'exerce afin d'imprimer une certaine direction justifiée par la prévoyance qui incombe à sa position privilégière.
Ce
qui nous amène à penser un Etat de la police, i.e un état paternaliste qui choisit à notre place pour ainsi dire.
N'estce pas ici mettre à mal la liberté des citoyens que devait précisément entretenir l'instrument étatique? L'idée de
surveillance quant à elle nous renvoie à un état omniscient pour qui tout est transparent.
On parle alors d'Etat
policier qui ne différencie plus espace publique et vie privée, et qui entretient un climat de suspicion à l'endroit des
citoyens afin de garantir leur sécurité.
La question devient alors la suivante: la liberté ne risque-t-elle pas alors
d'être de sacrifiée sur l'autel de la sécurité?
I.
Hayek: ordre exogène et ordre spontané
L'économiste Hayek va part du fait que l'Etat de droit moderne ne réalise qu'imparfaitement son idéal de liberté.
Il
faut, pour commencer, partir d'une caractérisation de la démocratie.
Cette dernière n'est pas tant un régime
politique qu'un ordre social particulier.
Or, Hayek distingue précisément deux types d'ordre social.
Le premier relève
de ce qu'il appelle une organisation: l'ordre y est ici exogène.
Qu'est-ce à dire? Dans ce type d'ordre social, il existe
une direction imposée de l'extérieur par un régime politique en place.
L'organisation se fait donc via un pouvoir
politique qui s'occupe des choix collectifs pour les citoyens.
On peut parler dans ce cas d'Etat de police, soit une
forme de paternalisme où les dirigeants entretiennent un rapport avec le peuple comparable à celui qu'entretient un
père avec ses enfants.
Et tout est dit en ce point, puisqu'on décide du bonheur des citoyens en les infantilisants,
i.e en partant du principe qu'ils ne sont pas aptes à choisir par eux-mêmes.
Cette idée est précieuse dans le cas
d'un ordre exogène, et peut s'exprimer en un leitmotiv pour le moins simple: les dirigeant savent, il jouissent d'une
perspective unique qui leur permettent de bénéficierde certains savoirs au nom desquels ils peuvent choisir pour le
plus grand bien de tous.
Le pouvoir à ceux qui savent, c'est proprement ce que l'on nomme une technocratie.
Dans
ce cas précis, il n'y a pas de place pour l'amateurisme politique: tout le monde ne peut pas décider des choix qui
concernent les affaires publiques.
C'est ainsi qu'une oligarchie (une poignet de dirigeants) ont pour charge le
domaine des décisions.
Ils dirigent proprement en donnant une direction déterminée au corps social, une décision
qu'ils ont prise eux-mêmes.
Pour Hayek, la première cause de ce type de direction étatique dans les sociétés modernes, coupé des citoyens et
de leurs revendications, vient du clientélisme et du pouvoir des lobby.
Le clientélisme s'explique du fait que, pour
accéder au pouvoir, les dirigeants vont devoir contracter certains engagements envers des corporations ou des
groupes plus ou moins vastes qui les aideront à accéder précisément au poste de responsabilité politique.
Ils
n'arrivent en ce sens au pouvoir qu'en promettant à ces groupes de les avantager une fois en place.
Le pouvoir ne
s'exercera ainsi qu'en faveur de certains, et en défaveur d'autres.
Les lobby (de l'anglais couloir, entendons ce qui
ne se décide pas sur l'agora, la place publique, ou dans la salle principale de décision, mais dans l'obscurité resserée
des couloirs) exercent certaines pression sur le pouvoir en place qui le pousse ainsi à les favoriser à la place
d'autres (groupe industriel, religieux...) pendant son mandat.
On comprend ici la dérive de l'idée d'un pouvoir qui dirige formant ainsi un ordre exogène.
Face à ce type d'ordre,
Hayek constate l'existence d'ordre spontanée qui semble décrire les sociétés contemporaines.
Le paradigme en est.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Hayek: L'État doit-il surveiller ou diriger ?
- RoussEAu: «Si la loi naturelle n'était écrite que dans la raison humaine, elle serait peu capable de diriger la plupart de nos actions, mais elle est encore gravée dans le coeur de l'homme en caractères ineffaçables...»
- FREUD: «Le Surmoi est une instance découverte par nous, la conscience une fonction que nous lui attribuons parmi d'autres, et qui consiste à surveiller et à juger les actes et les intentions du Moi et à exercer une activité de censure.»
- Quel est le rôle des passions dans la nature humaine ? L'homme doit-il chercher à les détruire entièrement ou seulement à les modérer et à les diriger ? Quelles sont les deux écoles philosophiques de l'antiquité qui ont soutenu l'une et l'autre de ces do
- Qui doit diriger la cité ?