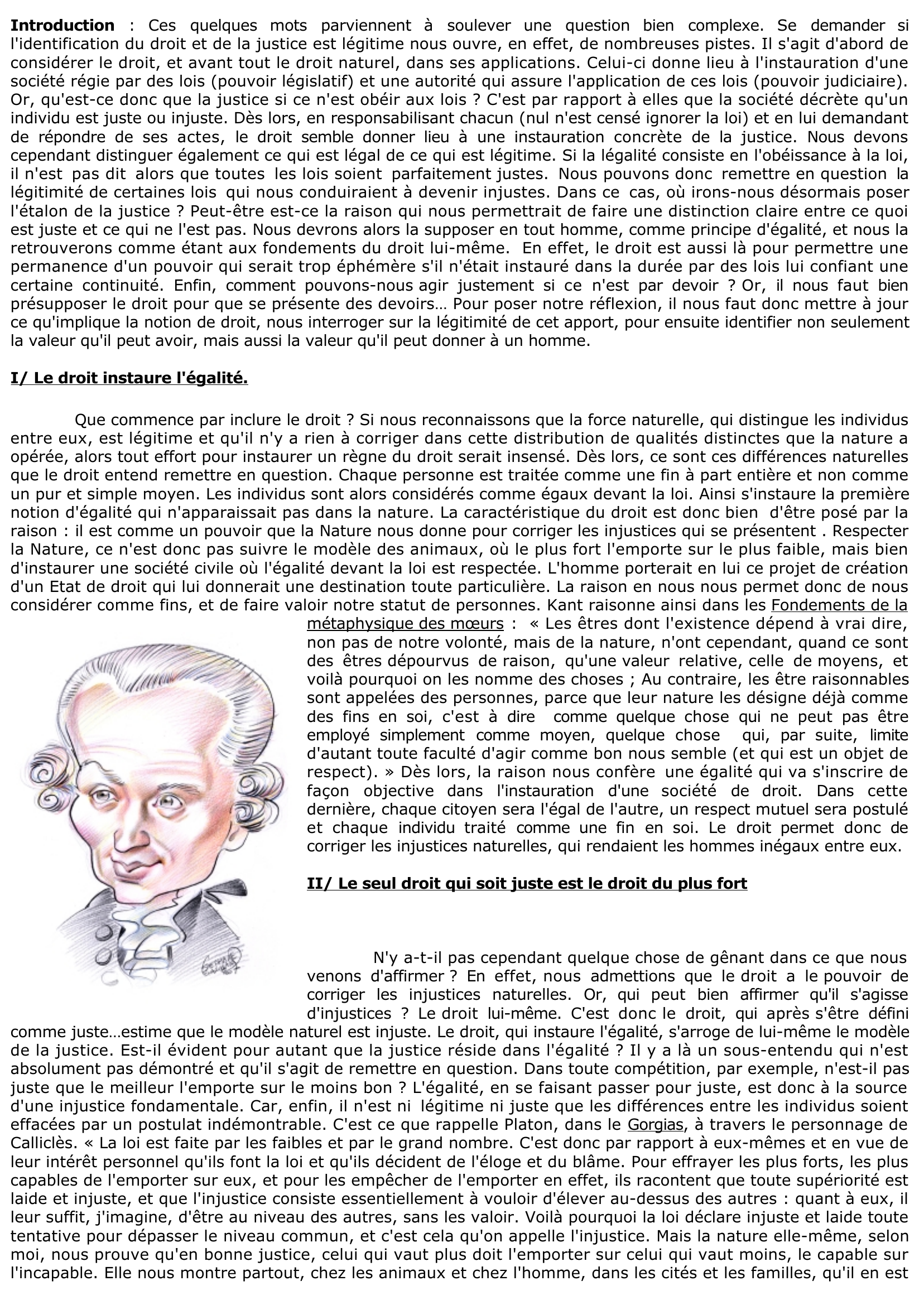Le droit est-il juste ?
Extrait du document
«
Introduction : Ces quelques mots parviennent à soulever une question bien complexe.
Se demander si
l'identification du droit et de la justice est légitime nous ouvre, en effet, de nombreuses pistes.
Il s'agit d'abord de
considérer le droit, et avant tout le droit naturel, dans ses applications.
Celui-ci donne lieu à l'instauration d'une
société régie par des lois (pouvoir législatif) et une autorité qui assure l'application de ces lois (pouvoir judiciaire).
Or, qu'est-ce donc que la justice si ce n'est obéir aux lois ? C'est par rapport à elles que la société décrète qu'un
individu est juste ou injuste.
Dès lors, en responsabilisant chacun (nul n'est censé ignorer la loi) et en lui demandant
de répondre de ses actes, le droit semble donner lieu à une instauration concrète de la justice.
Nous devons
cependant distinguer également ce qui est légal de ce qui est légitime.
Si la légalité consiste en l'obéissance à la loi,
il n'est pas dit alors que toutes les lois soient parfaitement justes.
Nous pouvons donc remettre en question la
légitimité de certaines lois qui nous conduiraient à devenir injustes.
Dans ce cas, où irons-nous désormais poser
l'étalon de la justice ? Peut-être est-ce la raison qui nous permettrait de faire une distinction claire entre ce quoi
est juste et ce qui ne l'est pas.
Nous devrons alors la supposer en tout homme, comme principe d'égalité, et nous la
retrouverons comme étant aux fondements du droit lui-même.
En effet, le droit est aussi là pour permettre une
permanence d'un pouvoir qui serait trop éphémère s'il n'était instauré dans la durée par des lois lui confiant une
certaine continuité.
Enfin, comment pouvons-nous agir justement si ce n'est par devoir ? Or, il nous faut bien
présupposer le droit pour que se présente des devoirs… Pour poser notre réflexion, il nous faut donc mettre à jour
ce qu'implique la notion de droit, nous interroger sur la légitimité de cet apport, pour ensuite identifier non seulement
la valeur qu'il peut avoir, mais aussi la valeur qu'il peut donner à un homme.
I/ Le droit instaure l'égalité.
Que commence par inclure le droit ? Si nous reconnaissons que la force naturelle, qui distingue les individus
entre eux, est légitime et qu'il n'y a rien à corriger dans cette distribution de qualités distinctes que la nature a
opérée, alors tout effort pour instaurer un règne du droit serait insensé.
Dès lors, ce sont ces différences naturelles
que le droit entend remettre en question.
Chaque personne est traitée comme une fin à part entière et non comme
un pur et simple moyen.
Les individus sont alors considérés comme égaux devant la loi.
Ainsi s'instaure la première
notion d'égalité qui n'apparaissait pas dans la nature.
La caractéristique du droit est donc bien d'être posé par la
raison : il est comme un pouvoir que la Nature nous donne pour corriger les injustices qui se présentent .
Respecter
la Nature, ce n'est donc pas suivre le modèle des animaux, où le plus fort l'emporte sur le plus faible, mais bien
d'instaurer une société civile où l'égalité devant la loi est respectée.
L'homme porterait en lui ce projet de création
d'un Etat de droit qui lui donnerait une destination toute particulière.
La raison en nous nous permet donc de nous
considérer comme fins, et de faire valoir notre statut de personnes.
Kant raisonne ainsi dans les Fondements de la
métaphysique des mœurs : « Les êtres dont l'existence dépend à vrai dire,
non pas de notre volonté, mais de la nature, n'ont cependant, quand ce sont
des êtres dépourvus de raison, qu'une valeur relative, celle de moyens, et
voilà pourquoi on les nomme des choses ; Au contraire, les être raisonnables
sont appelées des personnes, parce que leur nature les désigne déjà comme
des fins en soi, c'est à dire comme quelque chose qui ne peut pas être
employé simplement comme moyen, quelque chose qui, par suite, limite
d'autant toute faculté d'agir comme bon nous semble (et qui est un objet de
respect).
» Dès lors, la raison nous confère une égalité qui va s'inscrire de
façon objective dans l'instauration d'une société de droit.
Dans cette
dernière, chaque citoyen sera l'égal de l'autre, un respect mutuel sera postulé
et chaque individu traité comme une fin en soi.
Le droit permet donc de
corriger les injustices naturelles, qui rendaient les hommes inégaux entre eux.
II/ Le seul droit qui soit juste est le droit du plus fort
N'y a-t-il pas cependant quelque chose de gênant dans ce que nous
venons d'affirmer ? En effet, nous admettions que le droit a le pouvoir de
corriger les injustices naturelles.
Or, qui peut bien affirmer qu'il s'agisse
d'injustices ? Le droit lui-même.
C'est donc le droit, qui après s'être défini
comme juste…estime que le modèle naturel est injuste.
Le droit, qui instaure l'égalité, s'arroge de lui-même le modèle
de la justice.
Est-il évident pour autant que la justice réside dans l'égalité ? Il y a là un sous-entendu qui n'est
absolument pas démontré et qu'il s'agit de remettre en question.
Dans toute compétition, par exemple, n'est-il pas
juste que le meilleur l'emporte sur le moins bon ? L'égalité, en se faisant passer pour juste, est donc à la source
d'une injustice fondamentale.
Car, enfin, il n'est ni légitime ni juste que les différences entre les individus soient
effacées par un postulat indémontrable.
C'est ce que rappelle Platon, dans le Gorgias, à travers le personnage de
Calliclès.
« La loi est faite par les faibles et par le grand nombre.
C'est donc par rapport à eux-mêmes et en vue de
leur intérêt personnel qu'ils font la loi et qu'ils décident de l'éloge et du blâme.
Pour effrayer les plus forts, les plus
capables de l'emporter sur eux, et pour les empêcher de l'emporter en effet, ils racontent que toute supériorité est
laide et injuste, et que l'injustice consiste essentiellement à vouloir d'élever au-dessus des autres : quant à eux, il
leur suffit, j'imagine, d'être au niveau des autres, sans les valoir.
Voilà pourquoi la loi déclare injuste et laide toute
tentative pour dépasser le niveau commun, et c'est cela qu'on appelle l'injustice.
Mais la nature elle-même, selon
moi, nous prouve qu'en bonne justice, celui qui vaut plus doit l'emporter sur celui qui vaut moins, le capable sur
l'incapable.
Elle nous montre partout, chez les animaux et chez l'homme, dans les cités et les familles, qu'il en est.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DROIT PÉNAL GÉNÉRAL
- Le bois dont l'homme est fait est si courbe qu'on ne peut rien y tailler de droit. Kant
- Histoire du droit
- Rapport entre Droit et politique
- « A-t-on le droit d’offenser ? »