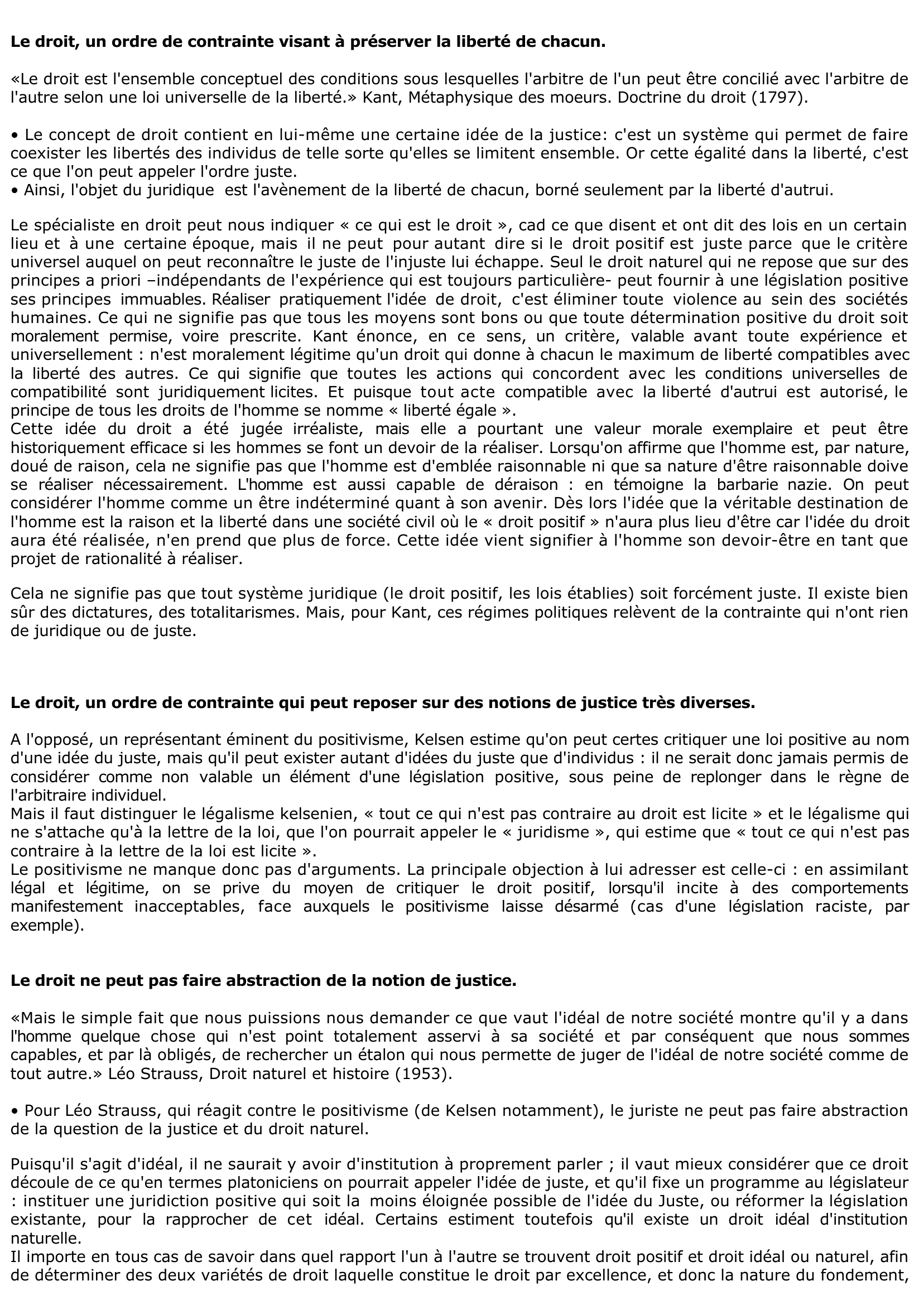Le droit doit-il chercher à être juste ?
Extrait du document
«
Le droit, un ordre de contrainte visant à préserver la liberté de chacun.
«Le droit est l'ensemble conceptuel des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être concilié avec l'arbitre de
l'autre selon une loi universelle de la liberté.» Kant, Métaphysique des moeurs.
Doctrine du droit (1797).
• Le concept de droit contient en lui-même une certaine idée de la justice: c'est un système qui permet de faire
coexister les libertés des individus de telle sorte qu'elles se limitent ensemble.
Or cette égalité dans la liberté, c'est
ce que l'on peut appeler l'ordre juste.
• Ainsi, l'objet du juridique est l'avènement de la liberté de chacun, borné seulement par la liberté d'autrui.
Le spécialiste en droit peut nous indiquer « ce qui est le droit », cad ce que disent et ont dit des lois en un certain
lieu et à une certaine époque, mais il ne peut pour autant dire si le droit positif est juste parce que le critère
universel auquel on peut reconnaître le juste de l'injuste lui échappe.
Seul le droit naturel qui ne repose que sur des
principes a priori –indépendants de l'expérience qui est toujours particulière- peut fournir à une législation positive
ses principes immuables.
Réaliser pratiquement l'idée de droit, c'est éliminer toute violence au sein des sociétés
humaines.
Ce qui ne signifie pas que tous les moyens sont bons ou que toute détermination positive du droit soit
moralement permise, voire prescrite.
Kant énonce, en ce sens, un critère, valable avant toute expérience et
universellement : n'est moralement légitime qu'un droit qui donne à chacun le maximum de liberté compatibles avec
la liberté des autres.
Ce qui signifie que toutes les actions qui concordent avec les conditions universelles de
compatibilité sont juridiquement licites.
Et puisque tout acte compatible avec la liberté d'autrui est autorisé, le
principe de tous les droits de l'homme se nomme « liberté égale ».
Cette idée du droit a été jugée irréaliste, mais elle a pourtant une valeur morale exemplaire et peut être
historiquement efficace si les hommes se font un devoir de la réaliser.
Lorsqu'on affirme que l'homme est, par nature,
doué de raison, cela ne signifie pas que l'homme est d'emblée raisonnable ni que sa nature d'être raisonnable doive
se réaliser nécessairement.
L'homme est aussi capable de déraison : en témoigne la barbarie nazie.
On peut
considérer l'homme comme un être indéterminé quant à son avenir.
Dès lors l'idée que la véritable destination de
l'homme est la raison et la liberté dans une société civil où le « droit positif » n'aura plus lieu d'être car l'idée du droit
aura été réalisée, n'en prend que plus de force.
Cette idée vient signifier à l'homme son devoir-être en tant que
projet de rationalité à réaliser.
Cela ne signifie pas que tout système juridique (le droit positif, les lois établies) soit forcément juste.
Il existe bien
sûr des dictatures, des totalitarismes.
Mais, pour Kant, ces régimes politiques relèvent de la contrainte qui n'ont rien
de juridique ou de juste.
Le droit, un ordre de contrainte qui peut reposer sur des notions de justice très diverses.
A l'opposé, un représentant éminent du positivisme, Kelsen estime qu'on peut certes critiquer une loi positive au nom
d'une idée du juste, mais qu'il peut exister autant d'idées du juste que d'individus : il ne serait donc jamais permis de
considérer comme non valable un élément d'une législation positive, sous peine de replonger dans le règne de
l'arbitraire individuel.
Mais il faut distinguer le légalisme kelsenien, « tout ce qui n'est pas contraire au droit est licite » et le légalisme qui
ne s'attache qu'à la lettre de la loi, que l'on pourrait appeler le « juridisme », qui estime que « tout ce qui n'est pas
contraire à la lettre de la loi est licite ».
Le positivisme ne manque donc pas d'arguments.
La principale objection à lui adresser est celle-ci : en assimilant
légal et légitime, on se prive du moyen de critiquer le droit positif, lorsqu'il incite à des comportements
manifestement inacceptables, face auxquels le positivisme laisse désarmé (cas d'une législation raciste, par
exemple).
Le droit ne peut pas faire abstraction de la notion de justice.
«Mais le simple fait que nous puissions nous demander ce que vaut l'idéal de notre société montre qu'il y a dans
l'homme quelque chose qui n'est point totalement asservi à sa société et par conséquent que nous sommes
capables, et par là obligés, de rechercher un étalon qui nous permette de juger de l'idéal de notre société comme de
tout autre.» Léo Strauss, Droit naturel et histoire (1953).
• Pour Léo Strauss, qui réagit contre le positivisme (de Kelsen notamment), le juriste ne peut pas faire abstraction
de la question de la justice et du droit naturel.
Puisqu'il s'agit d'idéal, il ne saurait y avoir d'institution à proprement parler ; il vaut mieux considérer que ce droit
découle de ce qu'en termes platoniciens on pourrait appeler l'idée de juste, et qu'il fixe un programme au législateur
: instituer une juridiction positive qui soit la moins éloignée possible de l'idée du Juste, ou réformer la législation
existante, pour la rapprocher de cet idéal.
Certains estiment toutefois qu'il existe un droit idéal d'institution
naturelle.
Il importe en tous cas de savoir dans quel rapport l'un à l'autre se trouvent droit positif et droit idéal ou naturel, afin
de déterminer des deux variétés de droit laquelle constitue le droit par excellence, et donc la nature du fondement,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DROIT PÉNAL GÉNÉRAL
- Le bois dont l'homme est fait est si courbe qu'on ne peut rien y tailler de droit. Kant
- Histoire du droit
- Sujet - On doit pas toujours chercher à être d'avantage heureux
- Rapport entre Droit et politique