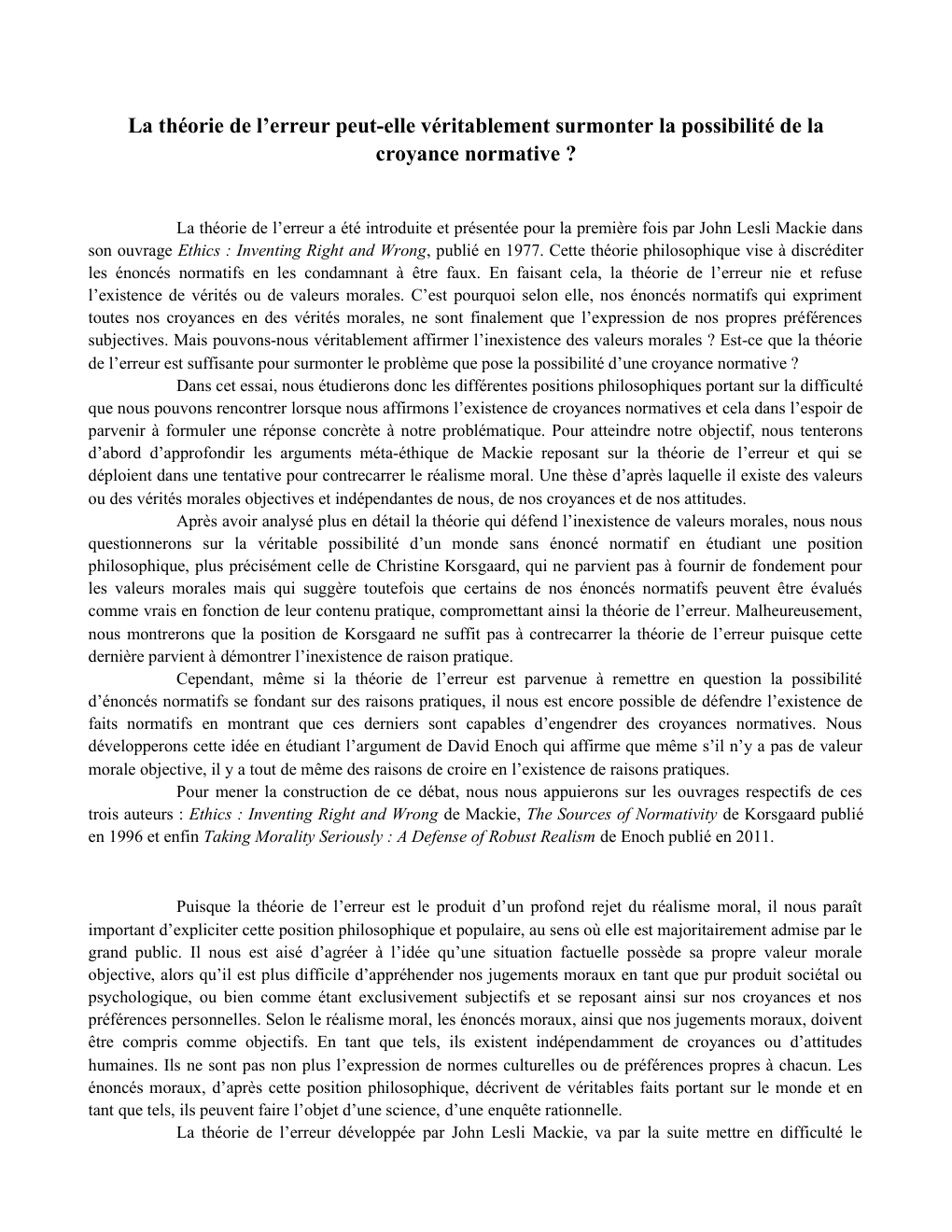La théorie de l’erreur peut-elle véritablement surmonter la possibilité de la croyance normative ?
Publié le 08/10/2025
Extrait du document
«
La théorie de l’erreur peut-elle véritablement surmonter la possibilité de la
croyance normative ?
La théorie de l’erreur a été introduite et présentée pour la première fois par John Lesli Mackie dans
son ouvrage Ethics : Inventing Right and Wrong, publié en 1977.
Cette théorie philosophique vise à discréditer
les énoncés normatifs en les condamnant à être faux.
En faisant cela, la théorie de l’erreur nie et refuse
l’existence de vérités ou de valeurs morales.
C’est pourquoi selon elle, nos énoncés normatifs qui expriment
toutes nos croyances en des vérités morales, ne sont finalement que l’expression de nos propres préférences
subjectives.
Mais pouvons-nous véritablement affirmer l’inexistence des valeurs morales ? Est-ce que la théorie
de l’erreur est suffisante pour surmonter le problème que pose la possibilité d’une croyance normative ?
Dans cet essai, nous étudierons donc les différentes positions philosophiques portant sur la difficulté
que nous pouvons rencontrer lorsque nous affirmons l’existence de croyances normatives et cela dans l’espoir de
parvenir à formuler une réponse concrète à notre problématique.
Pour atteindre notre objectif, nous tenterons
d’abord d’approfondir les arguments méta-éthique de Mackie reposant sur la théorie de l’erreur et qui se
déploient dans une tentative pour contrecarrer le réalisme moral.
Une thèse d’après laquelle il existe des valeurs
ou des vérités morales objectives et indépendantes de nous, de nos croyances et de nos attitudes.
Après avoir analysé plus en détail la théorie qui défend l’inexistence de valeurs morales, nous nous
questionnerons sur la véritable possibilité d’un monde sans énoncé normatif en étudiant une position
philosophique, plus précisément celle de Christine Korsgaard, qui ne parvient pas à fournir de fondement pour
les valeurs morales mais qui suggère toutefois que certains de nos énoncés normatifs peuvent être évalués
comme vrais en fonction de leur contenu pratique, compromettant ainsi la théorie de l’erreur.
Malheureusement,
nous montrerons que la position de Korsgaard ne suffit pas à contrecarrer la théorie de l’erreur puisque cette
dernière parvient à démontrer l’inexistence de raison pratique.
Cependant, même si la théorie de l’erreur est parvenue à remettre en question la possibilité
d’énoncés normatifs se fondant sur des raisons pratiques, il nous est encore possible de défendre l’existence de
faits normatifs en montrant que ces derniers sont capables d’engendrer des croyances normatives.
Nous
développerons cette idée en étudiant l’argument de David Enoch qui affirme que même s’il n’y a pas de valeur
morale objective, il y a tout de même des raisons de croire en l’existence de raisons pratiques.
Pour mener la construction de ce débat, nous nous appuierons sur les ouvrages respectifs de ces
trois auteurs : Ethics : Inventing Right and Wrong de Mackie, The Sources of Normativity de Korsgaard publié
en 1996 et enfin Taking Morality Seriously : A Defense of Robust Realism de Enoch publié en 2011.
Puisque la théorie de l’erreur est le produit d’un profond rejet du réalisme moral, il nous paraît
important d’expliciter cette position philosophique et populaire, au sens où elle est majoritairement admise par le
grand public.
Il nous est aisé d’agréer à l’idée qu’une situation factuelle possède sa propre valeur morale
objective, alors qu’il est plus difficile d’appréhender nos jugements moraux en tant que pur produit sociétal ou
psychologique, ou bien comme étant exclusivement subjectifs et se reposant ainsi sur nos croyances et nos
préférences personnelles.
Selon le réalisme moral, les énoncés moraux, ainsi que nos jugements moraux, doivent
être compris comme objectifs.
En tant que tels, ils existent indépendamment de croyances ou d’attitudes
humaines.
Ils ne sont pas non plus l’expression de normes culturelles ou de préférences propres à chacun.
Les
énoncés moraux, d’après cette position philosophique, décrivent de véritables faits portant sur le monde et en
tant que tels, ils peuvent faire l’objet d’une science, d’une enquête rationnelle.
La théorie de l’erreur développée par John Lesli Mackie, va par la suite mettre en difficulté le
réalisme moral en déployant deux arguments fondamentaux, celui du désaccord et celui de l’étrangeté ou
“queerness” que nous pouvons retrouver dans le premier chapitre de son ouvrage Ethics : Inventing Right and
Wrong.
Maintenant que nous avons préalablement présenté le réalisme moral, nous pouvons enfin nous
demander en quoi consiste la théorie de l’erreur.
Cette dernière est une théorie philosophique qui conteste
l’objectivité des valeurs morales telle que le défend le réalisme moral.
D’après la théorie de l’erreur, tous les
énoncés normatifs sont faux en plus de n’être que l’expression de préférences personnelles et de croyances.
Ainsi, selon elle, toute tentative de fonder des croyances morales sur la réalité objective est erronée puisque cette
croyance en une moralité objective repose elle-même sur une erreur fondamentale, celle d’une croyance en la
réalité objective de faits moraux qui existeraient indépendamment de nos préférences et nos attitudes.
D’après la
théorie de l’erreur, la moralité ne peut être que strictement subjective.
En défendant cette théorie, Mackie conteste l’existence de vérités morales universelles qui
s’appliqueraient à tous et en toutes circonstances.
Mais au-delà de cela, c’est la nécessité-même de la moralité
dans l’existence humaine qu’il remet en question.
Puisque, d’après lui, les croyances morales sont construites sur
le conditionnement culturel et sociétal, il ne peut donc pas y avoir de fondement objectif à la moralité.
C’est
aussi pour cela qu’il soutient que le langage moral est intrinsèquement défectueux puisque ce dernier cherche à
décrire des faits moraux qui n’existent pas.
Ainsi, lorsque nous disons que “voler est mal”, nous n’énonçons pas
une vérité morale universelle mais nous exprimons plutôt une désapprobation personnelle du vol.
Pour appuyer sa théorie, Mackie va développer deux arguments intéressants fondés sur les
observations qu’il mène dans sa recherche : l’argument du désaccord et l’argument de l’étrangeté.
Il va d’abord
déployer celui du désaccord en faisant remarquer qu’il a toujours existé et qu’il existe toujours de nombreux
désaccords moraux entre les différents peuples et les diverses cultures et cela même sur ce que nous pouvons
considérer comme des questions morales fondamentales, comme celle qui cherche à établir le bon et le mauvais.
L’existence de ces désaccords est pour le réalisme moral une véritable difficulté, puisqu'elle remet en question la
possibilité de valeurs morales objectives et indépendantes de nos croyances et de nos préférences.
Cet argument
cherche à montrer que si de telles valeurs existaient objectivement, alors une forme d’accord généralisé sur les
questions morales fondamentales devrait aussi exister entre les peuples et les différentes cultures.
Mais puisque
nous ne pouvons pas nier l’existence de désaccords, alors nous pouvons douter de l’effectivité de ces valeurs
morales.
C’est pour cette raison que Mackie va plutôt soutenir l’idée que nos croyances morales ne sont que le
fruit de conditionnements sociaux et culturels, mais aussi de préférences personnelles et de préjugés
psychologiques et en tant que telles, elles ne sont que des projections subjectives de nos attitudes et de nos
préférences.
Quant à l’argument de l’étrangeté ou “queerness”, il est le résultat d’une observation menée sur les
propriétés morales, telles que la bonté ou la justesse, qui sont selon Mackie bien différentes des autres propriétés
que nous pouvons rencontrer dans le monde, telles que les propriétés physiques ou mathématiques.
C’est cette
différence ou cette étrangeté, qui serait la cause d’une nouvelle difficulté pour le réalisme moral et sa théorie, qui
affirment que les propriétés ou valeurs morales existent objectivement.
Étant donné que les propriétés morales
ne sont ni observables, ni mesurables, ni soumises à des enquêtes empiriques comme peuvent l’être les
propriétés physiques ou encore les lois naturelles, elles nécessitent une explication différente et particulière.
Mais une telle explication présuppose l’existence d’une entité inconcevable que Mackie qualifie de “queer”,
d’étrange.
Si nous ajoutons cette entité nécessaire qui sert à justifier l’existence de ces propriétés morales, à
l’étrangeté-même de ces propriétés, il devient alors difficile de continuer à postuler l’objectivité des valeurs
morales.
L’étrangeté des propriétés morales ainsi que le fait qu’elles soient inconcevables rendent leur effectivité
improbable selon l’argument de “queerness” de Mackie.
Maintenant que nous avons étudié en détail la démarche qu’entreprend Mackie pour mettre en
difficulté le réalisme moral, ou plus précisément l’idée qui affirme l’objectivité des valeurs morales, à l’aide de
deux arguments déployés sur des observations menées sur les désaccords existant entre les peuples et les
cultures, mais aussi sur les propriétés morales elles-mêmes.
Appuyé par ces deux arguments, la théorie de
l’erreur de Mackie remet en question l’existence de valeurs morales objectives et indépendantes des préférences
ainsi que des croyances des hommes.
Mais est-ce que démontrer que les valeurs morales ne sont pas objectives suffit pour certifier que la
théorie de l’erreur surmonte véritablement le problème de la croyance normative ? Pouvons-nous réellement
affirmer qu’il n’existe absolument aucun énoncé normatif dans notre monde ? De nombreux philosophes ont
contesté la théorie de Mackie en certifiant que cette dernière n’était pas apte et ne parvenait pas à saisir toute la
complexité des énoncés normatifs, donc du langage normatif lui-même, ni l’utilisation effective que nous en
faisons.
En prenant en compte ces objections, nous reconnaissons que nous ne sommes plus en capacité de
répondre à notre problématique présentement, nous poursuivrons donc notre étude en examinant....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier... Les contradictions à surmonter sont le terreau de notre croissance. » Expliquez et commentez ce jugement de Saint-Exupéry, extrait de son livre : « Lettre à un Otage » ?
- Le fondement de la théorie, c'est la pratique. Mao
- Philosophie: croyance, certitude et vérité
- Le Moi chez Rousseau - Théorie des trois types d’hommes chez Rousseau
- A-t-on la possibilité de se connaître soi-même ?