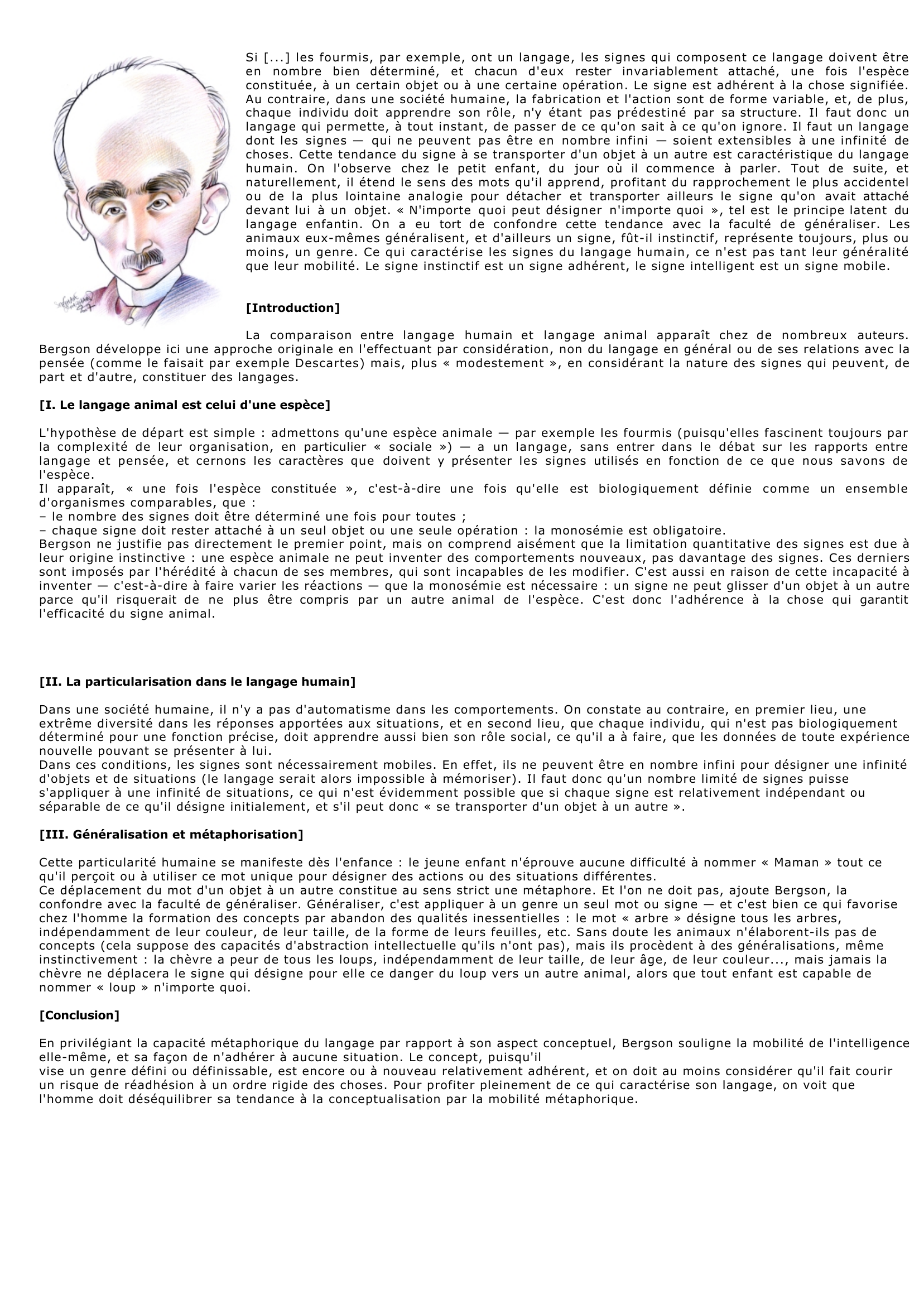Bergson
Extrait du document
«
Si [...] les fourmis, par exemple, ont un langage, les signes qui composent ce langage doivent être
en nombre bien déterminé, et chacun d'eux rester invariablement attaché, une fois l'espèce
constituée, à un certain objet ou à une certaine opération.
Le signe est adhérent à la chose signifiée.
Au contraire, dans une société humaine, la fabrication et l'action sont de forme variable, et, de plus,
chaque individu doit apprendre son rôle, n'y étant pas prédestiné par sa structure.
Il faut donc un
langage qui permette, à tout instant, de passer de ce qu'on sait à ce qu'on ignore.
Il faut un langage
dont les signes — qui ne peuvent pas être en nombre infini — soient extensibles à une infinité de
choses.
Cette tendance du signe à se transporter d'un objet à un autre est caractéristique du langage
humain.
On l'observe chez le petit enfant, du jour où il commence à parler.
Tout de suite, et
naturellement, il étend le sens des mots qu'il apprend, profitant du rapprochement le plus accidentel
ou de la plus lointaine analogie pour détacher et transporter ailleurs le signe qu'on avait attaché
devant lui à un objet.
« N'importe quoi peut désigner n'importe quoi », tel est le principe latent du
langage enfantin.
O n a eu tort d e confondre cette tendance avec la faculté de généraliser.
Les
animaux eux-mêmes généralisent, et d'ailleurs un signe, fût-il instinctif, représente toujours, plus ou
moins, un genre.
Ce qui caractérise les signes du langage humain, ce n'est pas tant leur généralité
que leur mobilité.
Le signe instinctif est un signe adhérent, le signe intelligent est un signe mobile.
[Introduction]
La comparaison entre langage humain et langage animal apparaît chez d e nombreux auteurs.
Bergson développe ici une approche originale en l'effectuant par considération, non du langage en général ou de ses relations avec la
pensée (comme le faisait par exemple Descartes) mais, plus « modestement », en considérant la nature des signes qui peuvent, de
part et d'autre, constituer des langages.
[I.
Le langage animal est celui d'une espèce]
L'hypothèse de départ est simple : admettons qu'une espèce animale — par exemple les fourmis (puisqu'elles fascinent toujours par
la complexité de leur organisation, en particulier « sociale ») — a un langage, sans entrer dans le débat sur les rapports entre
langage et pensée, et cernons les caractères que doivent y présenter les signes utilisés en fonction d e ce que nous savons de
l'espèce.
Il apparaît, « une fois l'espèce constituée », c'est-à-dire une fois qu'elle est biologiquement définie comme un ensemble
d'organismes comparables, que :
– le nombre des signes doit être déterminé une fois pour toutes ;
– chaque signe doit rester attaché à un seul objet ou une seule opération : la monosémie est obligatoire.
Bergson ne justifie pas directement le premier point, mais on comprend aisément que la limitation quantitative des signes est due à
leur origine instinctive : une espèce animale ne peut inventer des comportements nouveaux, pas davantage des signes.
Ces derniers
sont imposés par l'hérédité à chacun de ses membres, qui sont incapables de les modifier.
C'est aussi en raison de cette incapacité à
inventer — c'est-à-dire à faire varier les réactions — que la monosémie est nécessaire : un signe ne peut glisser d'un objet à un autre
parce qu'il risquerait de ne plus être compris par un autre animal de l'espèce.
C'est donc l'adhérence à la chose qui garantit
l'efficacité du signe animal.
[II.
La particularisation dans le langage humain]
Dans une société humaine, il n'y a pas d'automatisme dans les comportements.
On constate au contraire, en premier lieu, une
extrême diversité dans les réponses apportées aux situations, et en second lieu, que chaque individu, qui n'est pas biologiquement
déterminé pour une fonction précise, doit apprendre aussi bien son rôle social, ce qu'il a à faire, que les données de toute expérience
nouvelle pouvant se présenter à lui.
Dans ces conditions, les signes sont nécessairement mobiles.
En effet, ils ne peuvent être en nombre infini pour désigner une infinité
d'objets et de situations (le langage serait alors impossible à mémoriser).
Il faut donc qu'un nombre limité de signes puisse
s'appliquer à une infinité de situations, ce qui n'est évidemment possible que si chaque signe est relativement indépendant ou
séparable de ce qu'il désigne initialement, et s'il peut donc « se transporter d'un objet à un autre ».
[III.
Généralisation et métaphorisation]
Cette particularité humaine se manifeste dès l'enfance : le jeune enfant n'éprouve aucune difficulté à nommer « Maman » tout ce
qu'il perçoit ou à utiliser ce mot unique pour désigner des actions ou des situations différentes.
Ce déplacement du mot d'un objet à un autre constitue au sens strict une métaphore.
Et l'on ne doit pas, ajoute Bergson, la
confondre avec la faculté de généraliser.
Généraliser, c'est appliquer à un genre un seul mot ou signe — et c'est bien ce qui favorise
chez l'homme la formation des concepts par abandon des qualités inessentielles : le mot « arbre » désigne tous les arbres,
indépendamment de leur couleur, de leur taille, de la forme de leurs feuilles, etc.
Sans doute les animaux n'élaborent-ils pas de
concepts (cela suppose des capacités d'abstraction intellectuelle qu'ils n'ont pas), mais ils procèdent à des généralisations, même
instinctivement : la chèvre a peur de tous les loups, indépendamment de leur taille, de leur âge, de leur couleur..., mais jamais la
chèvre ne déplacera le signe qui désigne pour elle ce danger du loup vers un autre animal, alors que tout enfant est capable de
nommer « loup » n'importe quoi.
[Conclusion]
En privilégiant la capacité métaphorique du langage par rapport à son aspect conceptuel, Bergson souligne la mobilité de l'intelligence
elle-même, et sa façon de n'adhérer à aucune situation.
Le concept, puisqu'il
vise un genre défini ou définissable, est encore ou à nouveau relativement adhérent, et on doit au moins considérer qu'il fait courir
un risque de réadhésion à un ordre rigide des choses.
Pour profiter pleinement de ce qui caractérise son langage, on voit que
l'homme doit déséquilibrer sa tendance à la conceptualisation par la mobilité métaphorique..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- [Affinités de l'art et de la philosophie] Bergson
- Henri BERGSON (1859-1941) La Pensée et le Mouvant, chap. V (commentaire)
- Bergson étude de texte: liberté et invention
- Explication de texte : Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience
- Explication d'un texte de Bergson sur la conscience