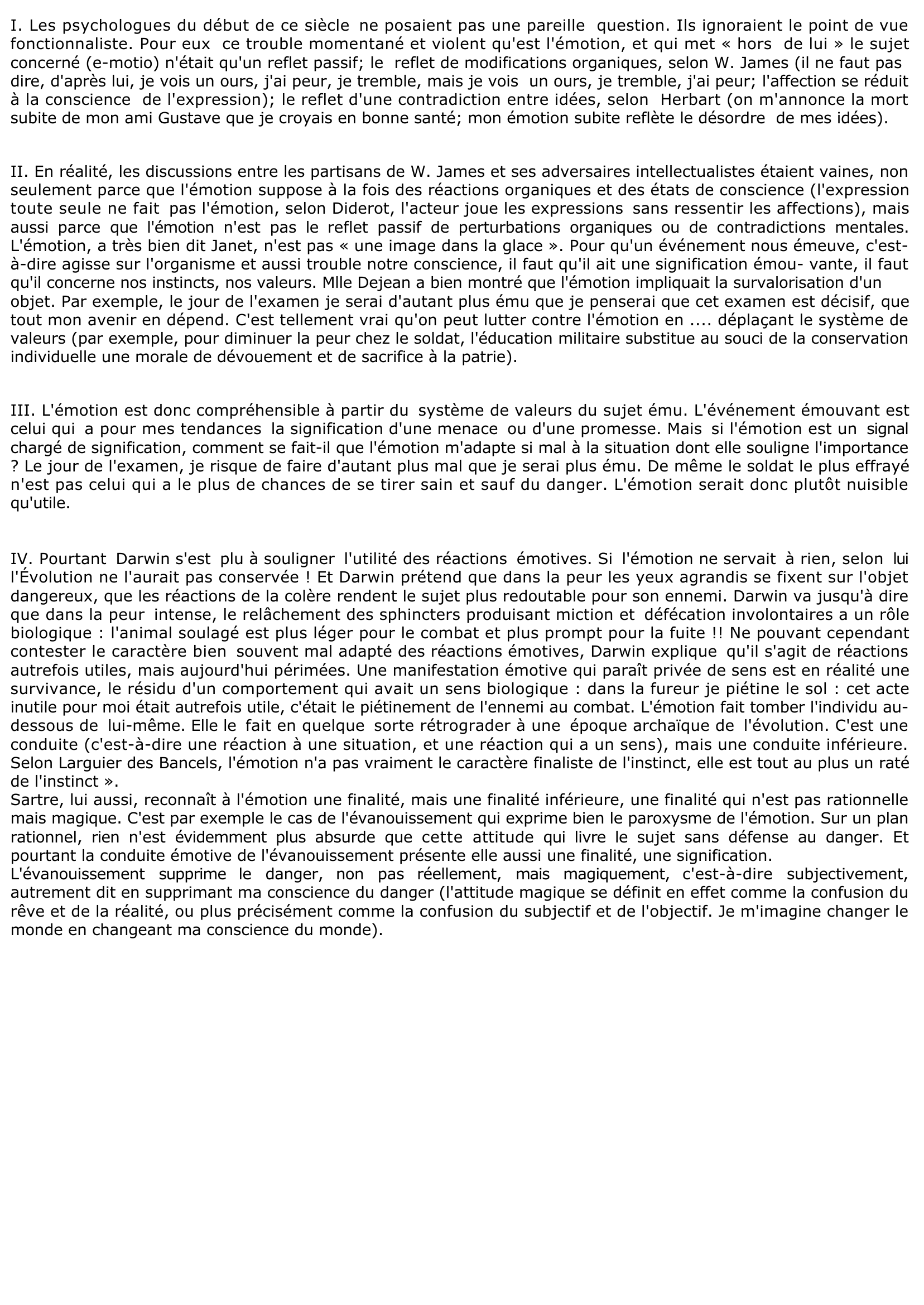A quoi sert l'émotion ?
Extrait du document
«
I.
Les psychologues du début de ce siècle ne posaient pas une pareille question.
Ils ignoraient le point de vue
fonctionnaliste.
Pour eux ce trouble momentané et violent qu'est l'émotion, et qui met « hors de lui » le sujet
concerné (e-motio) n'était qu'un reflet passif; le reflet de modifications organiques, selon W.
James (il ne faut pas
dire, d'après lui, je vois un ours, j'ai peur, je tremble, mais je vois un ours, je tremble, j'ai peur; l'affection se réduit
à la conscience de l'expression); le reflet d'une contradiction entre idées, selon Herbart (on m'annonce la mort
subite de mon ami Gustave que je croyais en bonne santé; mon émotion subite reflète le désordre de mes idées).
II.
En réalité, les discussions entre les partisans de W.
James et ses adversaires intellectualistes étaient vaines, non
seulement parce que l'émotion suppose à la fois des réactions organiques et des états de conscience (l'expression
toute seule ne fait pas l'émotion, selon Diderot, l'acteur joue les expressions sans ressentir les affections), mais
aussi parce que l'émotion n'est pas le reflet passif de perturbations organiques ou de contradictions mentales.
L'émotion, a très bien dit Janet, n'est pas « une image dans la glace ».
Pour qu'un événement nous émeuve, c'està-dire agisse sur l'organisme et aussi trouble notre conscience, il faut qu'il ait une signification émou- vante, il faut
qu'il concerne nos instincts, nos valeurs.
Mlle Dejean a bien montré que l'émotion impliquait la survalorisation d'un
objet.
Par exemple, le jour de l'examen je serai d'autant plus ému que je penserai que cet examen est décisif, que
tout mon avenir en dépend.
C'est tellement vrai qu'on peut lutter contre l'émotion en ....
déplaçant le système de
valeurs (par exemple, pour diminuer la peur chez le soldat, l'éducation militaire substitue au souci de la conservation
individuelle une morale de dévouement et de sacrifice à la patrie).
III.
L'émotion est donc compréhensible à partir du système de valeurs du sujet ému.
L'événement émouvant est
celui qui a pour mes tendances la signification d'une menace ou d'une promesse.
Mais si l'émotion est un signal
chargé de signification, comment se fait-il que l'émotion m'adapte si mal à la situation dont elle souligne l'importance
? Le jour de l'examen, je risque de faire d'autant plus mal que je serai plus ému.
De même le soldat le plus effrayé
n'est pas celui qui a le plus de chances de se tirer sain et sauf du danger.
L'émotion serait donc plutôt nuisible
qu'utile.
IV.
Pourtant Darwin s'est plu à souligner l'utilité des réactions émotives.
Si l'émotion ne servait à rien, selon lui
l'Évolution ne l'aurait pas conservée ! Et Darwin prétend que dans la peur les yeux agrandis se fixent sur l'objet
dangereux, que les réactions de la colère rendent le sujet plus redoutable pour son ennemi.
Darwin va jusqu'à dire
que dans la peur intense, le relâchement des sphincters produisant miction et défécation involontaires a un rôle
biologique : l'animal soulagé est plus léger pour le combat et plus prompt pour la fuite !! Ne pouvant cependant
contester le caractère bien souvent mal adapté des réactions émotives, Darwin explique qu'il s'agit de réactions
autrefois utiles, mais aujourd'hui périmées.
Une manifestation émotive qui paraît privée de sens est en réalité une
survivance, le résidu d'un comportement qui avait un sens biologique : dans la fureur je piétine le sol : cet acte
inutile pour moi était autrefois utile, c'était le piétinement de l'ennemi au combat.
L'émotion fait tomber l'individu audessous de lui-même.
Elle le fait en quelque sorte rétrograder à une époque archaïque de l'évolution.
C'est une
conduite (c'est-à-dire une réaction à une situation, et une réaction qui a un sens), mais une conduite inférieure.
Selon Larguier des Bancels, l'émotion n'a pas vraiment le caractère finaliste de l'instinct, elle est tout au plus un raté
de l'instinct ».
Sartre, lui aussi, reconnaît à l'émotion une finalité, mais une finalité inférieure, une finalité qui n'est pas rationnelle
mais magique.
C'est par exemple le cas de l'évanouissement qui exprime bien le paroxysme de l'émotion.
Sur un plan
rationnel, rien n'est évidemment plus absurde que cette attitude qui livre le sujet sans défense au danger.
Et
pourtant la conduite émotive de l'évanouissement présente elle aussi une finalité, une signification.
L'évanouissement supprime le danger, non pas réellement, mais magiquement, c'est-à-dire subjectivement,
autrement dit en supprimant ma conscience du danger (l'attitude magique se définit en effet comme la confusion du
rêve et de la réalité, ou plus précisément comme la confusion du subjectif et de l'objectif.
Je m'imagine changer le
monde en changeant ma conscience du monde)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Soren Kierkegaard: A quoi sert la vérité ?
- SPINOZA: «Cette méthode pour interpréter sûrement la Bible, loin d'être différente de la méthode qui sert à interpréter la nature, lui est au contraire parfaitement conforme.»
- À quoi sert la littérature ?
- Un critique contemporain, M. André Thérive, écrit : « La littérature dans son ensemble sert à faire mieux connaître l'homme. Au temps des classiques, la vérité générale, l'homme abstrait, suffisait encore. L'homme concret est une conquête de l'époque mod
- Â partir de deux ou trois cas concrets d'émotion, de passion, ou de sentiment, tâchez de préciser le rôle du physiologique, du psychologique et du social dans la vie affective et de déterminer quel est le facteur essentiel de l'affectivité. ?