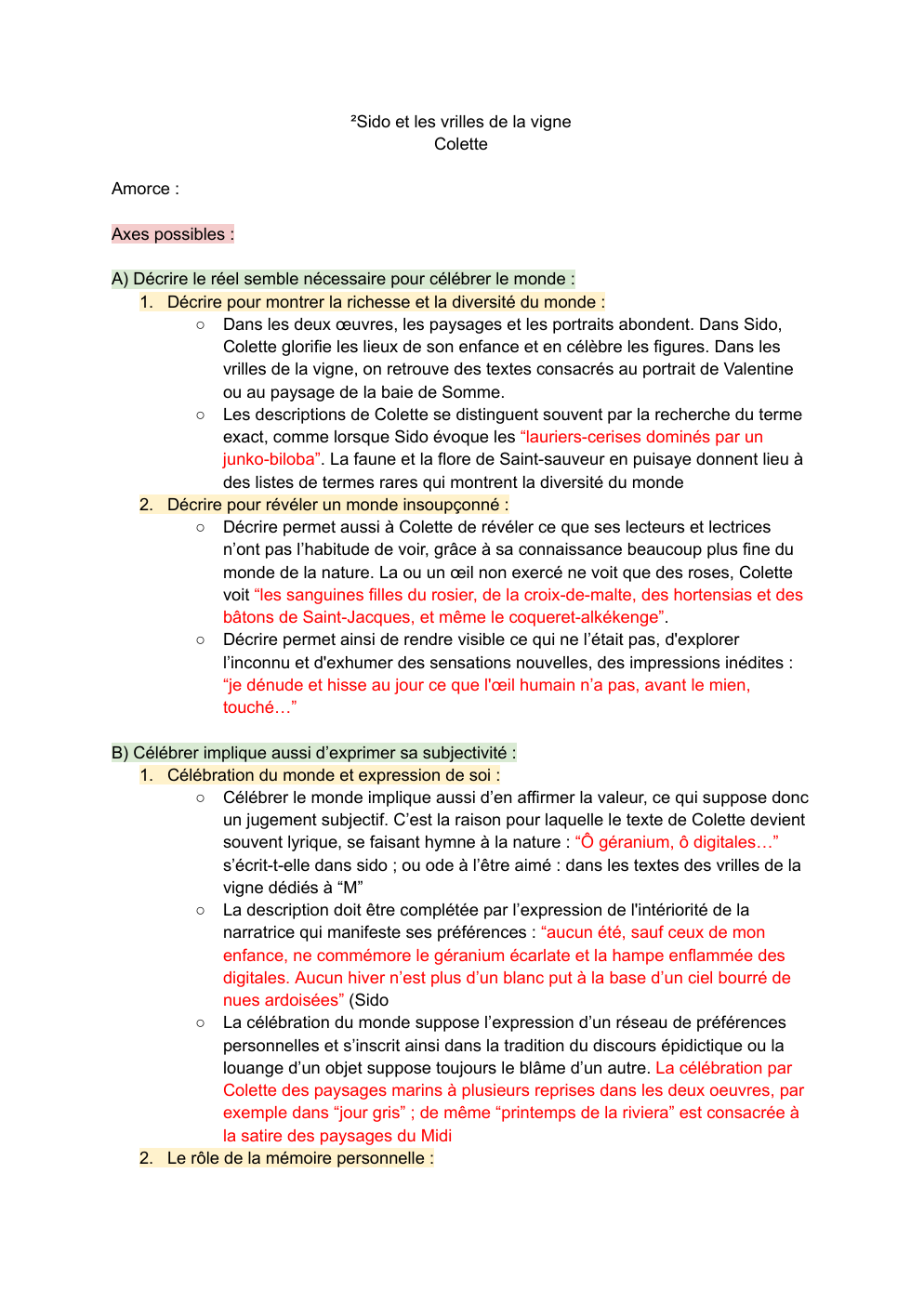Révision Sido et les Vrilles de la vigne
Publié le 14/05/2025
Extrait du document
«
²Sido et les vrilles de la vigne
Colette
Amorce :
Axes possibles :
A) Décrire le réel semble nécessaire pour célébrer le monde :
1. Décrire pour montrer la richesse et la diversité du monde :
○ Dans les deux œuvres, les paysages et les portraits abondent.
Dans Sido,
Colette glorifie les lieux de son enfance et en célèbre les figures.
Dans les
vrilles de la vigne, on retrouve des textes consacrés au portrait de Valentine
ou au paysage de la baie de Somme.
○ Les descriptions de Colette se distinguent souvent par la recherche du terme
exact, comme lorsque Sido évoque les “lauriers-cerises dominés par un
junko-biloba”.
La faune et la flore de Saint-sauveur en puisaye donnent lieu à
des listes de termes rares qui montrent la diversité du monde
2. Décrire pour révéler un monde insoupçonné :
○ Décrire permet aussi à Colette de révéler ce que ses lecteurs et lectrices
n’ont pas l’habitude de voir, grâce à sa connaissance beaucoup plus fine du
monde de la nature.
La ou un œil non exercé ne voit que des roses, Colette
voit “les sanguines filles du rosier, de la croix-de-malte, des hortensias et des
bâtons de Saint-Jacques, et même le coqueret-alkékenge”.
○ Décrire permet ainsi de rendre visible ce qui ne l’était pas, d'explorer
l’inconnu et d'exhumer des sensations nouvelles, des impressions inédites :
“je dénude et hisse au jour ce que l'œil humain n’a pas, avant le mien,
touché…”
B) Célébrer implique aussi d’exprimer sa subjectivité :
1. Célébration du monde et expression de soi :
○ Célébrer le monde implique aussi d’en affirmer la valeur, ce qui suppose donc
un jugement subjectif.
C’est la raison pour laquelle le texte de Colette devient
souvent lyrique, se faisant hymne à la nature : “Ô géranium, ô digitales…”
s’écrit-t-elle dans sido ; ou ode à l’être aimé : dans les textes des vrilles de la
vigne dédiés à “M”
○ La description doit être complétée par l’expression de l'intériorité de la
narratrice qui manifeste ses préférences : “aucun été, sauf ceux de mon
enfance, ne commémore le géranium écarlate et la hampe enflammée des
digitales.
Aucun hiver n’est plus d’un blanc put à la base d’un ciel bourré de
nues ardoisées” (Sido
○ La célébration du monde suppose l’expression d’un réseau de préférences
personnelles et s’inscrit ainsi dans la tradition du discours épidictique ou la
louange d’un objet suppose toujours le blâme d’un autre.
La célébration par
Colette des paysages marins à plusieurs reprises dans les deux oeuvres, par
exemple dans “jour gris” ; de même “printemps de la riviera” est consacrée à
la satire des paysages du Midi
2. Le rôle de la mémoire personnelle :
○ Dans les deux œuvres, la tonalité se fait souvent nostalgique : le monde qui
est célébré est un monde disparu qui ne demande cependant qu’à renaître.
Dans “dernier feu”, Colette évoque ainsi les violettes qui viennent d’éclore,
mais ne les célèbre que parce qu’elles rappellent celles d’autrefois : “Ô
violettes de mon enfance! Vous montez devant moi, toutes…”
○ Célébrer ce n’est donc pas seulement décrire, c’est aussi raconter ce qui
donne de la valeur à une chose ou à une personne, c’est pourquoi l’écriture
de Colette se fait volontier autobiographique : dans “le capitaine” et “les
sauvages”, les anecdotes sur Jules, Achille et Léopold permettent de rendre
ces personnages attachants et émouvants.
C) Célébrer suppose donc de transfigurer le monde :
1. Une description impressionniste :
○ L’écriture de Colette rappelle la peinture impressioniste, c’est à dire qu’elle
relate l’impression laissée sur elle plutôt que l’objet décrit lui-même : “tout le
chaud jardin se nourrissait d’une lumière jaune, à tremblements rouges et
violets, mais je ne pourrais dire si ce rouge, ce violet dépendaient, dépendent
encore d’un sentiment bonheur ou d’un éblouissement optique” (Sido)
○ Les anecdotes les plus réalistes se mêlent ainsi constamment aux évocations
les plus subjectives, comme en témoigne “Musicall-halls”, dont la première
partie est un récit franchement comique, avec chute, et la seconde, une
galerie de portrait impressionnistes
2. Une récréation poétique :
○ Le monde n’est donc pas tant décrit que récréer, ce qui contribue au
caractère onirique et poétique des textes.
Dans “Jour gris”, le paysage de
l’enfance, coloré par une vision fantastique (la brume est un spectre) ou
merveilleuse (la forêt conduit à un mystérieux château), se transforme en
royaume de conte de fées.
○ Les textes sont souvent de véritables poèmes en prose comme le montre
“Chanson de la danseuse” où se mêlent indistinctement souvenirs d’enfance,
amour du music-hall et expression du désir, pour mieux célébrer la liberté et
la vie.
D) Célébration des proches :
1. Sido, une mère au centre du monde :
○ Sidonie Landoy épouse du Capitaine est dépeinte par sa fille comme une
femme extraordinaire, en symbiose avec la nature (“la reine du jardin”) : elle
possède le pouvoir de parler aux animaux, de commander le vent, de
connaître l’heure où le soleil se couche… Elle a transmis son amour de la
nature à sa fille.
○ Sido entretient une relation d’affection, voire de fusion avec sa fille qu’elle
couvre de noms affectueux : “joyau tout en or”
○ L’intensité de l’amour de Colette pour sa mère érige cette dernière en déesse
de la nature.
Elle a recours au registre épidictique pour faire l’éloge de cette
mère, au centre de tout.
○ On peut établir un parallèle avec le récit autobiographique d’Annie Ernaux,
“Une femme”, où la mère de l’auteur occupe une place centrale.
Le récit est
toutefois traité dans la veine réaliste chez Annie Ernaux, où le lecteur
découvre la vie de labeur de la mère et ses derniers jours à l’hôpital ; alors
qu’il est poétique chez Colette.
2. Les figures masculines chéries :
○ Un chapitre de Sido consacré au père, “Le capitaine”.
Amputé d’une jambe, il
est présenté comme un homme joyeux, aimant la vie, sa femme et ses
enfants.
○ Les deux frères, Achille et Léopold, sont dépeints dans la section “les
sauvages” de Sido.
Les anecdotes rapportées (courte bagarre, mariage de la
sœur Juliette) montrent l’affection de Colette pour ses frères.
3. L’amour et l’amitié :
○ Colette évoque aussi son amour pour Missy, surnom de Mathilde de Morny,
l’amante de Colette depuis 1905.
Dans “Nuit blanche”, “Jour gris”, “Le dernier
feu”, elle décrit des bribes de son histoire d’amour avec douceur.
○ L’amitié pour Valentine, dans les Vrilles de la Vigne, est également au cœur
de plusieurs nouvelles.
Dans : “Belles de jour”, les deux femmes partagent
leur chagrin lié aux histoires d’amour avec des hommes.
“La guérison”
évoque la souffrance de Valentine après le départ de son amant Henri.
Même
si le personnage de Valentine permet une critique des....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse linéaire : le dernier feu Les vrilles de la vigne
- fiche révision plantes
- Fiche de révision Spleen IV Français Première
- fiche révision oral bac francais remords posthume
- révision hggsp