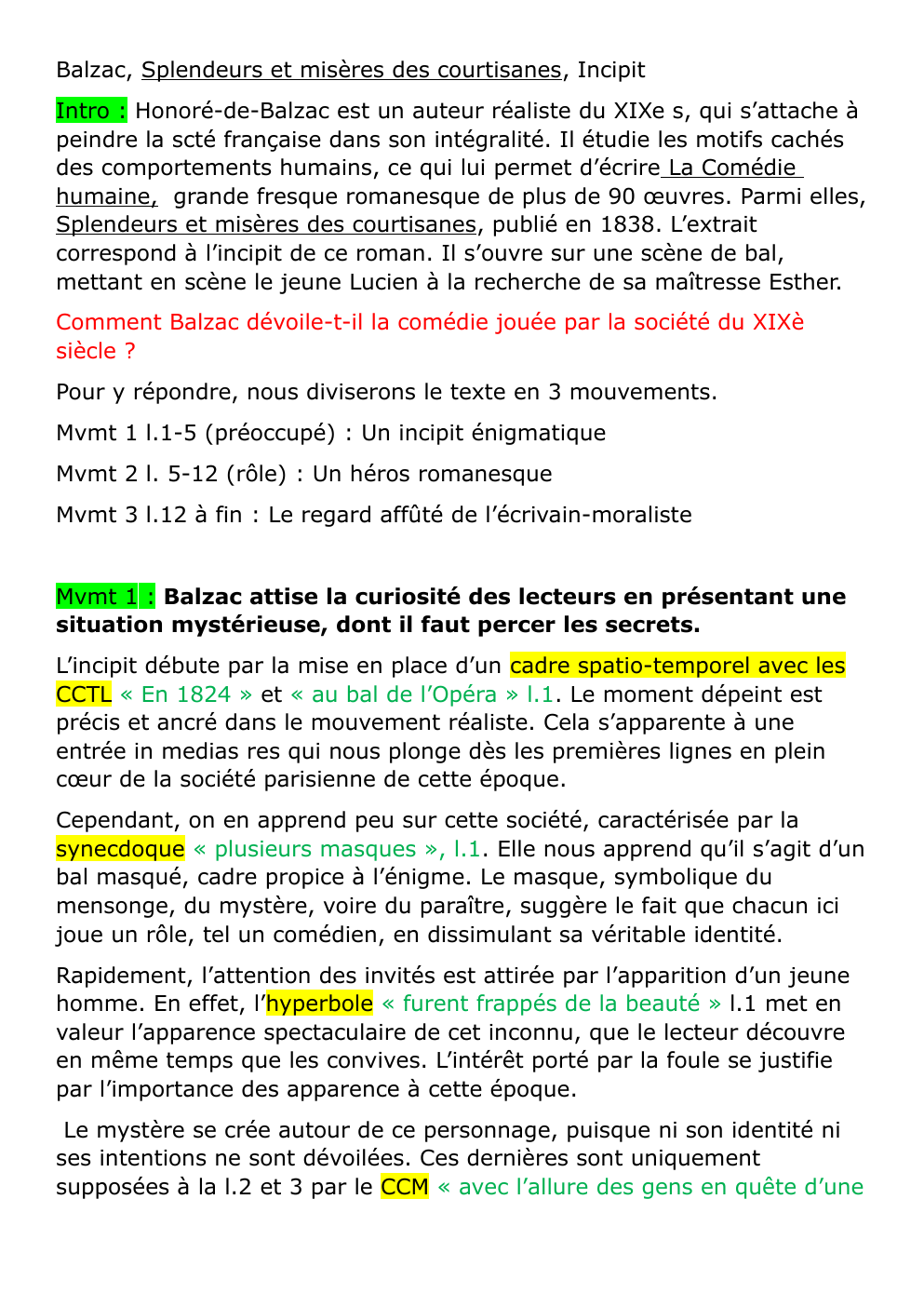lecture linéaire : Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes - l’incipit
Publié le 11/05/2025
Extrait du document
«
Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes, Incipit
Intro : Honoré-de-Balzac est un auteur réaliste du XIXe s, qui s’attache à
peindre la scté française dans son intégralité.
Il étudie les motifs cachés
des comportements humains, ce qui lui permet d’écrire La Comédie
humaine, grande fresque romanesque de plus de 90 œuvres.
Parmi elles,
Splendeurs et misères des courtisanes, publié en 1838.
L’extrait
correspond à l’incipit de ce roman.
Il s’ouvre sur une scène de bal,
mettant en scène le jeune Lucien à la recherche de sa maîtresse Esther.
Comment Balzac dévoile-t-il la comédie jouée par la société du XIXè
siècle ?
Pour y répondre, nous diviserons le texte en 3 mouvements.
Mvmt 1 l.1-5 (préoccupé) : Un incipit énigmatique
Mvmt 2 l.
5-12 (rôle) : Un héros romanesque
Mvmt 3 l.12 à fin : Le regard affûté de l’écrivain-moraliste
Mvmt 1 : Balzac attise la curiosité des lecteurs en présentant une
situation mystérieuse, dont il faut percer les secrets.
L’incipit débute par la mise en place d’un cadre spatio-temporel avec les
CCTL « En 1824 » et « au bal de l’Opéra » l.1.
Le moment dépeint est
précis et ancré dans le mouvement réaliste.
Cela s’apparente à une
entrée in medias res qui nous plonge dès les premières lignes en plein
cœur de la société parisienne de cette époque.
Cependant, on en apprend peu sur cette société, caractérisée par la
synecdoque « plusieurs masques », l.1.
Elle nous apprend qu’il s’agit d’un
bal masqué, cadre propice à l’énigme.
Le masque, symbolique du
mensonge, du mystère, voire du paraître, suggère le fait que chacun ici
joue un rôle, tel un comédien, en dissimulant sa véritable identité.
Rapidement, l’attention des invités est attirée par l’apparition d’un jeune
homme.
En effet, l’hyperbole « furent frappés de la beauté » l.1 met en
valeur l’apparence spectaculaire de cet inconnu, que le lecteur découvre
en même temps que les convives.
L’intérêt porté par la foule se justifie
par l’importance des apparence à cette époque.
Le mystère se crée autour de ce personnage, puisque ni son identité ni
ses intentions ne sont dévoilées.
Ces dernières sont uniquement
supposées à la l.2 et 3 par le CCM « avec l’allure des gens en quête d’une
femme ».
Il suggère une raison amoureuse à sa présence, qui attise la
curiosité des autres.
Le côté énigmatique se retrouve aussi dans la phrase « Le secret de cette
démarche n’est connu que de vieilles femmes et de quelques flâneurs
émérites » l.4 L’annonce d’un secret dès l’ouverture du roman donne
envie d’en savoir plus.
Aussi, la négation restrictive montre que seuls
quelques initiés peuvent déchiffrer les apparences, grâce à leur
expérience (vieilles femmes) ou leur perspicacité (flâneurs émérites).
Ainsi, l’Opéra semble être un lieu mystérieux où les participants
du bal sont à la fois acteurs et spectateurs.
Le narrateur dénonce
également le règne des apparences et des regards dans cette
société de spectacle.
Mvmt 2 : Puis, il élève Lucien au rang de personnage romanesque,
admirable, énigmatique.
Pour le décrire, il utilise un lexique mélioratif, avec « jeune dandy » l.5,
« succès » « exclamations » l.6 , « admiratives » l.
7, « beauté » l.8,
« personnages exceptionnels » l.
8-9.
Lucien présente toutes les
caractéristiques du parfait héros : jeunesse, beauté, caractère
extraordinaire.
Les avis contradictoires des spectateurs sur lui, dans l’énumération de la
l.6-8, soulignent leur confusion.
Le héros suscite un flot de réactions chez
les autres....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LECTURE LINÉAIRE 12 « Mémoires d’une âme » « Melancholia », Les Contemplations, (1856), Victor Hugo
- lecture de l'incipit de Bouvard et Pécuchet de Flaubert
- Argument lecture linéaire sur la princesse de clèves - scène d'aveu et caractère exceptionnel des personnages
- Lecture Linéaire N°11 Charles Baudelaire, Fleurs du Mal, Texte Intégral, « Tableaux parisiens » « Le Soleil »
- Lecture linéaire Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil : La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle