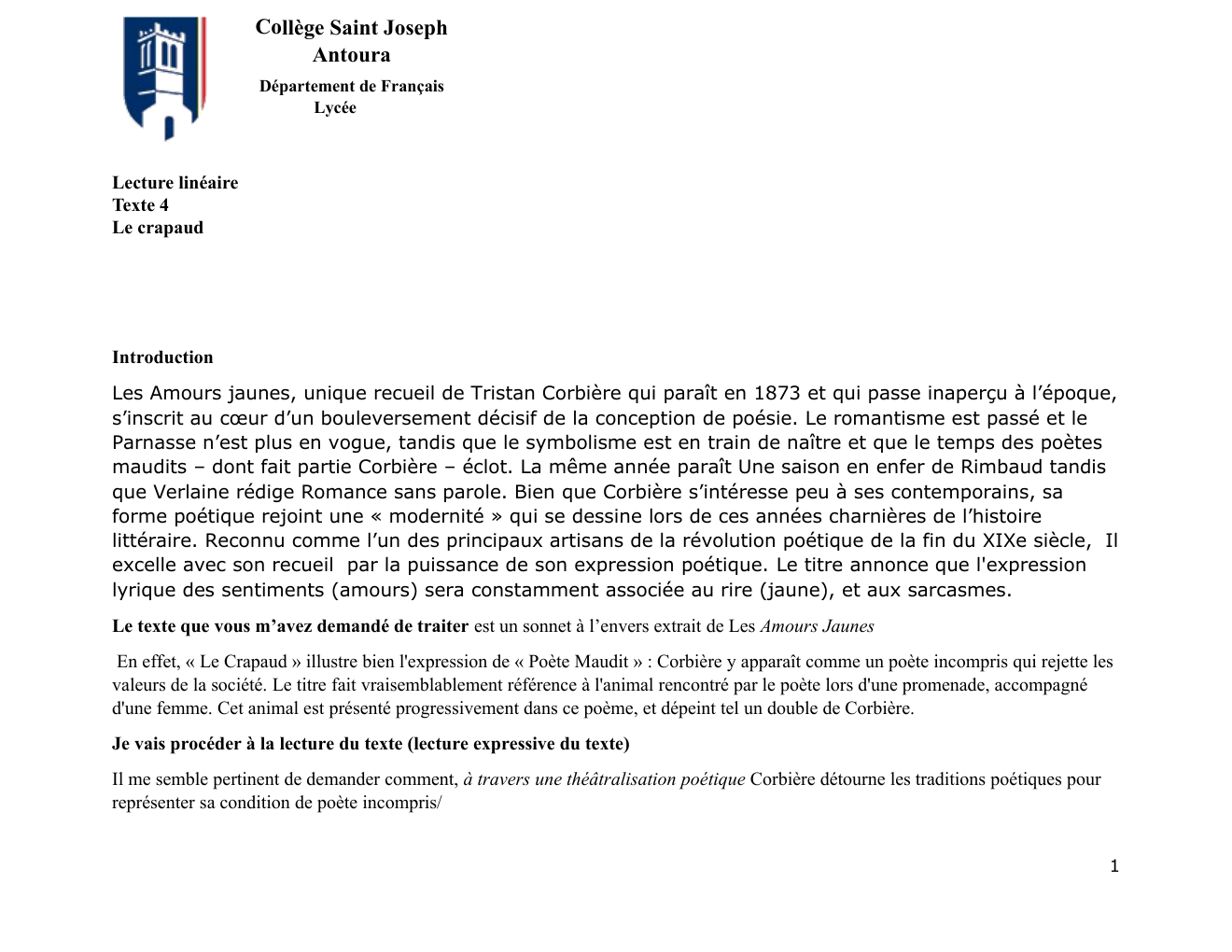Cahier de douai - Lecture linéaire Texte 4 Le crapaud
Publié le 30/04/2025
Extrait du document
«
Lecture linéaire
Texte 4
Le crapaud
Introduction
Les Amours jaunes, unique recueil de Tristan Corbière qui paraît en 1873 et qui passe inaperçu à l’époque,
s’inscrit au cœur d’un bouleversement décisif de la conception de poésie.
Le romantisme est passé et le
Parnasse n’est plus en vogue, tandis que le symbolisme est en train de naître et que le temps des poètes
maudits – dont fait partie Corbière – éclot.
La même année paraît Une saison en enfer de Rimbaud tandis
que Verlaine rédige Romance sans parole.
Bien que Corbière s’intéresse peu à ses contemporains, sa
forme poétique rejoint une « modernité » qui se dessine lors de ces années charnières de l’histoire
littéraire.
Reconnu comme l’un des principaux artisans de la révolution poétique de la fin du XIXe siècle, Il
excelle avec son recueil par la puissance de son expression poétique.
Le titre annonce que l'expression
lyrique des sentiments (amours) sera constamment associée au rire (jaune), et aux sarcasmes.
Le texte que vous m’avez demandé de traiter est un sonnet à l’envers extrait de Les Amours Jaunes
En effet, « Le Crapaud » illustre bien l'expression de « Poète Maudit » : Corbière y apparaît comme un poète incompris qui rejette les
valeurs de la société.
Le titre fait vraisemblablement référence à l'animal rencontré par le poète lors d'une promenade, accompagné
d'une femme.
Cet animal est présenté progressivement dans ce poème, et dépeint tel un double de Corbière.
Je vais procéder à la lecture du texte (lecture expressive du texte)
Il me semble pertinent de demander comment, à travers une théâtralisation poétique Corbière détourne les traditions poétiques pour
représenter sa condition de poète incompris/
1
L’analyse linéaire que je propose progressera en 3 mouvements : Les deux premiers tercets permettent de traduire un lyrisme dégradé.
Le premier quatrain évoque une esthétique paradoxale.
Quant au 3e mouvement, il porte sur le dernier quatrain qui montre un poète
isolé et fatalement incompris.
Mouvement 1 (Les 2 tercets) : Le lyrisme dégradé
Un chant dans une nuit sans air...
-La lune plaque en métal clair
Les découpures du vert sombre.
...
Un chant ; comme un écho, tout vif
Enterré, là, sous le massif...
— Ça se tait : Viens, c’est là, dans l’ombre...
Un: article indéfini qui montre que nous ne savons pas d’où provient le chant.
De plus, le tiret au début du vers sert à insister
sur l’aspect incongru du chant.
Le cadre spatio-temporel :
Le poème semble décrire une balade amoureuse, nocturne, en pleine nature.
Tout est figé, calme, serein, naturel, cela se traduit
par l'expression « une nuit sans air » qui montre l'aspect paisible, solennel du moment présent.
Cet aspect silencieux de la nuit,
qui veille sur les amants, est renforcé par les points de suspension, qui peuvent marquer plusieurs choses : ils soulignent le
silence, peuvent aussi marquer le souffle, la respiration ou encore l'hésitation.
La mention de la lune permet elle aussi de souligner l'aspect romantique de la scène et l'expression de l'amour, qui se veut
rassurant.
« Une nuit sans air »: C’est une nuit étouffante, mais aussi une nuit sans musique.
Le vers commence avec un chant et se
termine sans air, c’est une antithèse, le rapprochement de deux termes opposés.
Le lyrisme est mis à mal, et pourtant, c’est
bien le mot « air » qui est mis à la rime.
Le lyrisme n’est pas tout à fait refusé, il est dégradé.
Le tiret placé au début du 2e vers, lance le dialogue sans préciser qui parle.
2
De plus, cette ambiance inquiétante se dévoile à travers le champ lexical du tranchant avec des mots comme « plaque/ métal/
découpures » et est soutenue par l’allitération [q] et en [r] mimant les découpures.
Le mystère est non seulement renforcé par le cadre nocturne mais aussi par l’antithèse « clair/ sombre » qui illustre l’étrangeté
du décor.
Enterré : on a un enjambement qui surprend le lecteur.
C’est un mot relié à la mort, on continue donc dans l’atmosphère peu
rassurante.
Dans le vers 6, le tiret peut signifier que le poète prend la parole et s’adresse à quelqu’un.
« Ça se tait » : cette phrase semble péjorative avec le pronom démonstratif qualifiant la personne qui chante et dégageant une
forme de mépris.
Le verbe « taire » montre la fin du chant des premiers vers.
L’impératif « viens » montre qu’il s’adresse à une personne qui pourrait être une femme, qu’il tutoie.
Cette proximité est
d’autant plus mystérieuse car le vers 6 se termine par des points de suspension et par les rimes « ombre » et « sombre ».
Le pronom démonstartif « ça » et le présentatif « c’est » désignent un élément qui apparaît plus tard dans le texte.
C’est bien
une preuve que le poète ménage ses effets, en prolongeant le mystère au maximum.
En plus, ce sont des pronoms dépréciatifs,
(on dirait des mots vides) c'est-à-dire qu’ils portent une connotation négative.
Ce qu’on cherche à voir n’a donc pourtant rien
de beau.
C’est ainsi que je passe au 2e mouvement.
Mouvement 2 (le premier tercet)
Le Crapaud, une esthétique paradoxale
— Un crapaud ! — Pourquoi cette peur,
Près de moi, ton soldat fidèle !
Vois-le, poète tondu, sans aile,
Rossignol de la boue...
— Horreur ! —....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture Linéaire N°11 Charles Baudelaire, Fleurs du Mal, Texte Intégral, « Tableaux parisiens » « Le Soleil »
- LECTURE LINÉAIRE 12 « Mémoires d’une âme » « Melancholia », Les Contemplations, (1856), Victor Hugo
- Argument lecture linéaire sur la princesse de clèves - scène d'aveu et caractère exceptionnel des personnages
- texte 4 - Molière, Le Malade imaginaire, III, 12 comm linéaire
- TEXTE 1 Mme de Lafayette, "Le Discours de Mme de Chartres à sa fille", Analyse Linéaire