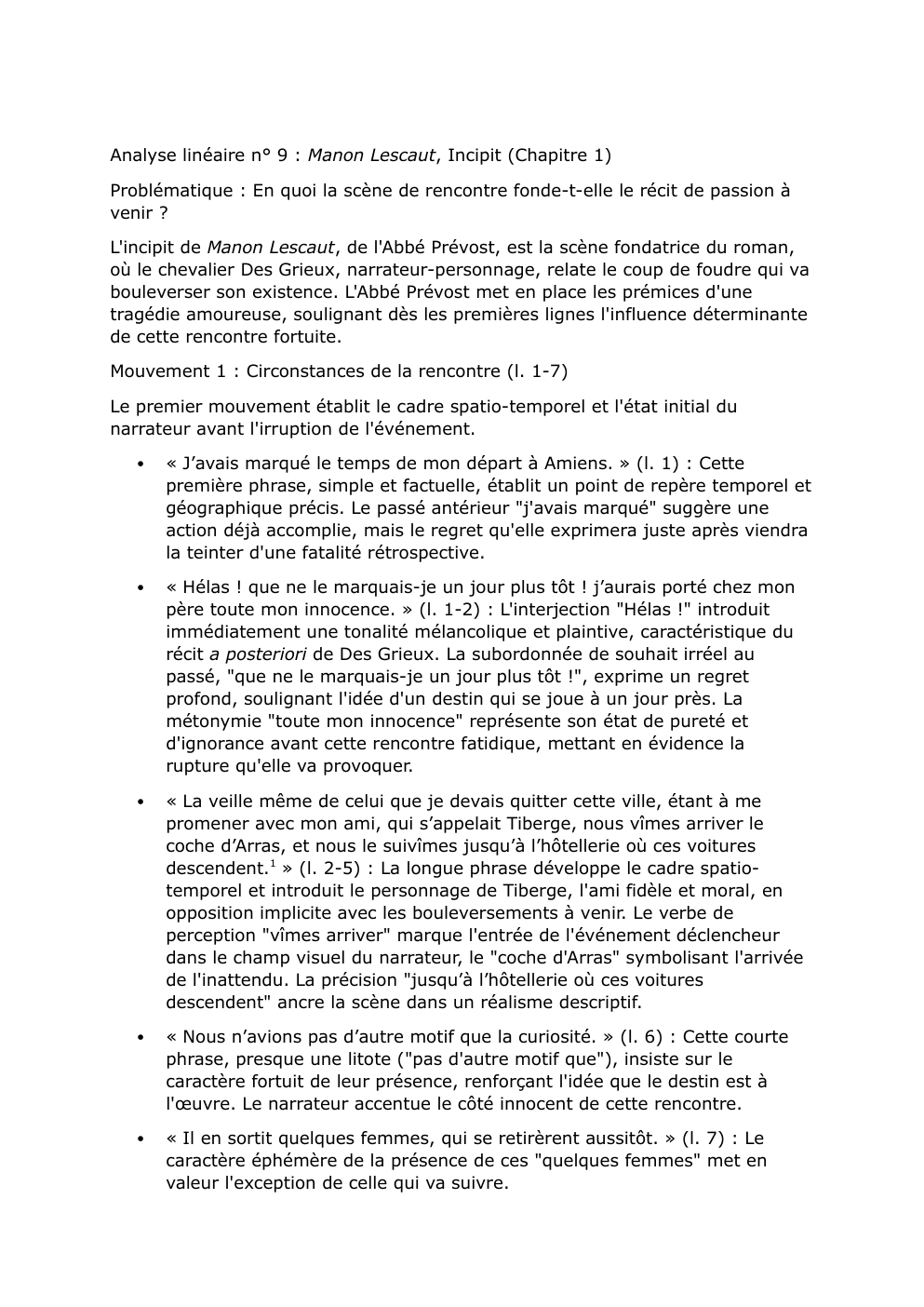Analyse linéaire n° 9 : Manon Lescaut, Incipit (Chapitre 1)
Publié le 21/09/2025
Extrait du document
«
Analyse linéaire n° 9 : Manon Lescaut, Incipit (Chapitre 1)
Problématique : En quoi la scène de rencontre fonde-t-elle le récit de passion à
venir ?
L'incipit de Manon Lescaut, de l'Abbé Prévost, est la scène fondatrice du roman,
où le chevalier Des Grieux, narrateur-personnage, relate le coup de foudre qui va
bouleverser son existence.
L'Abbé Prévost met en place les prémices d'une
tragédie amoureuse, soulignant dès les premières lignes l'influence déterminante
de cette rencontre fortuite.
Mouvement 1 : Circonstances de la rencontre (l.
1-7)
Le premier mouvement établit le cadre spatio-temporel et l'état initial du
narrateur avant l'irruption de l'événement.
« J’avais marqué le temps de mon départ à Amiens.
» (l.
1) : Cette
première phrase, simple et factuelle, établit un point de repère temporel et
géographique précis.
Le passé antérieur "j'avais marqué" suggère une
action déjà accomplie, mais le regret qu'elle exprimera juste après viendra
la teinter d'une fatalité rétrospective.
« Hélas ! que ne le marquais-je un jour plus tôt ! j’aurais porté chez mon
père toute mon innocence.
» (l.
1-2) : L'interjection "Hélas !" introduit
immédiatement une tonalité mélancolique et plaintive, caractéristique du
récit a posteriori de Des Grieux.
La subordonnée de souhait irréel au
passé, "que ne le marquais-je un jour plus tôt !", exprime un regret
profond, soulignant l'idée d'un destin qui se joue à un jour près.
La
métonymie "toute mon innocence" représente son état de pureté et
d'ignorance avant cette rencontre fatidique, mettant en évidence la
rupture qu'elle va provoquer.
« La veille même de celui que je devais quitter cette ville, étant à me
promener avec mon ami, qui s’appelait Tiberge, nous vîmes arriver le
coche d’Arras, et nous le suivîmes jusqu’à l’hôtellerie où ces voitures
descendent.1 » (l.
2-5) : La longue phrase développe le cadre spatiotemporel et introduit le personnage de Tiberge, l'ami fidèle et moral, en
opposition implicite avec les bouleversements à venir.
Le verbe de
perception "vîmes arriver" marque l'entrée de l'événement déclencheur
dans le champ visuel du narrateur, le "coche d'Arras" symbolisant l'arrivée
de l'inattendu.
La précision "jusqu’à l’hôtellerie où ces voitures
descendent" ancre la scène dans un réalisme descriptif.
« Nous n’avions pas d’autre motif que la curiosité.
» (l.
6) : Cette courte
phrase, presque une litote ("pas d'autre motif que"), insiste sur le
caractère fortuit de leur présence, renforçant l'idée que le destin est à
l'œuvre.
Le narrateur accentue le côté innocent de cette rencontre.
« Il en sortit quelques femmes, qui se retirèrent aussitôt.
» (l.
7) : Le
caractère éphémère de la présence de ces "quelques femmes" met en
valeur l'exception de celle qui va suivre.
Mouvement 2 : Fascination de Des Grieux (l.
7-15)
Ce second mouvement se concentre sur l'apparition de Manon et l'effet
dévastateur et instantané qu'elle produit sur Des Grieux.
« Mais il en restait une, fort jeune, qui s’arrêta seule dans la cour, pendant
qu’un homme d’un âge avancé, qui paraissait lui servir de conducteur,
s’empressait pour faire tirer son équipage des paniers.
» (l.
7-10) :
L'adverbe d'opposition "Mais" souligne la singularité de cette femme.
La
description se fait par la dénomination "fort jeune" et la mise en scène de
sa solitude au milieu de l'agitation, ce qui la distingue immédiatement.
La
présence de l'homme âgé, "conducteur", contraste avec la jeunesse de la
femme et anticipe une forme d'autorité ou de contrainte.
« Elle me parut si charmante que moi, qui n’avais jamais pensé à la
différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d’attention, moi, disje, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvai
enflammé tout d’un coup jusqu’au transport.
2 » (l.
10-13) : Cette longue
et complexe phrase décrit le coup de foudre avec force.
La conjonction de
conséquence "si… que" exprime l'intensité de l'impression.
La triple incise
qui décrit Des Grieux avant cette rencontre ("qui n’avais jamais pensé...
ni
regardé...
dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue") est une
anaphore du "moi" et une antithèse frappante entre son état antérieur
(innocent, sage, retenu) et l'effet immédiat de cette rencontre.
Le
participe passé "enflammé" et l'hyperbole "jusqu'au transport" traduisent
l'intensité soudaine et violente de la passion.
C'est le passage d'une
aseptisation des sentiments à une tempête intérieure.
« J’avais le défaut d’être excessivement timide et facile à déconcerter ;
mais loin d’être arrêté alors par cette faiblesse, je m’avançai vers la
maîtresse de mon cœur.
» (l.
13-15) : L'antithèse entre la timidité
habituelle de Des Grieux et son audace nouvelle souligne la force
transformatrice de l'amour.
La métaphore "maîtresse de mon cœur"
indique déjà une soumission totale.
Mouvement 3 : Les premières conversations (l.
15-30)
Le troisième mouvement relate les premiers échanges, révélant la situation de
Manon et la détermination naissante de Des Grieux.
« Quoiqu’elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses
sans paraître embarrassée.
» (l.
15-16) : L'âge de Manon ("moins âgée
que moi") est précisé, accentuant la jeunesse des deux personnages.
Sa
réception "sans paraître embarrassée" contraste avec la timidité de Des
Grieux et révèle déjà une certaine assurance, voire une forme de maturité
précoce ou de désinvolture qui caractérisera Manon.
« Je lui demandai ce qui l’amenait à Amiens, et si elle y avait quelques
personnes de connaissance.
» (l.
16-17) : Question banale qui marque le
début de l'échange, une tentative d'établir un contact.
« Elle me répondit ingénument, qu’elle y était envoyée par ses parents,
pour être religieuse.
» (l.
18-19) : L'adverbe "ingénument" (avec
innocence, naïveté) est ironique, au vu de la suite du roman.
La
destination "pour être religieuse" est un élément dramatique fort, une
antithèse absolue à la passion naissante, et une source de conflit
immédiate.
« L’amour me rendait déjà si éclairé, depuis un moment qu’il était dans
mon cœur, que je regardai ce dessein comme un coup mortel pour mes
désirs.
» (l.
19-21) : La personnification de l'amour ("L'amour me
rendait...
éclairé") lui confère une puissance quasi divine et initiatrice.
La
métaphore "coup mortel" exprime la perception immédiate du danger que
représente ce projet pour les désirs de Des Grieux, soulignant
l'instantanéité de sa compréhension des enjeux.
« Je lui parlai d’une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car
elle était bien plus expérimentée que moi : c’était malgré elle qu’on
l’envoyait au couvent, pour arrêter sans doute son penchant au plaisir, qui
s’était déjà déclaré, et qui3 causa dans la suite tous ses malheurs et les
miens.
» (l.
21-25) : La phrase introduit la dissymétrie d'expérience entre
les deux personnages ("elle était bien plus expérimentée que moi"), et
révèle le "penchant au plaisir" de Manon, présenté ici comme une cause
initiale des malheurs à venir.
L'incise "qui causa dans la suite tous ses
malheurs et les miens" est une analepse qui annonce la tragédie et
renforce la tonalité de fatalité.
« Je combattis la cruelle intention de ses parents, par toutes les raisons
que mon amour naissant et mon éloquence scolastique purent me
suggérer.
» (l.
25-27) : L'expression "cruelle intention" révèle l'indignation
de Des Grieux.
L'association de son "amour naissant" et de son "éloquence
scolastique" (issue de ses études, donc théorique) met en lumière son
inexpérience et sa jeunesse face à la situation.
« Elle n’affecta ni rigueur ni dédain.
» (l.
27) : La double négation insiste
sur la bienveillance de Manon, ou du moins son absence de rejet.
« Elle me dit, après un moment de silence, qu’elle ne prévoyait que trop
qu’elle allait être malheureuse, mais que c’était apparemment la volonté
du Ciel, puisqu’il ne lui laissait nul moyen de l’éviter.4 » (l.
28-30) : Le
"moment de silence" de Manon suggère une réflexion ou une résignation.
Sa réponse exprime une forme de fatalisme ("volonté du Ciel") et une
impuissance face à son destin, résonnant avec les premières lignes de Des
Grieux.
L'antiphrase "ne prévoyait que trop qu'elle allait être malheureuse"
indique qu'elle est consciente de son destin, ce qui est ironique au vu de
sa légèreté.
Analyse linéaire n° 13 : Gargantua, « PROLOGUE »
Problématique : En quoi ce prologue par ses caractéristiques comiques, donne-til le ton de l'œuvre ?
Le prologue de Gargantua de François Rabelais est bien plus qu'une simple
introduction : c'est une invitation facétieuse et provocatrice à la lecture.
Par son
adresse directe, ses figures inattendues et l'éloge du paradoxe, Rabelais prépare
son lecteur à une œuvre qui mêle le rire le plus gras à une sagesse profonde.
Mouvement 1 : Une entrée en matière contrastée (l.
1-5)
Le prologue débute par une interpellation originale et un éloge paradoxal, qui
déconcertent le lecteur et l'invitent à une lecture au second degré.
« Buveurs très illustres, et vous vérolés très précieux (car c’est à vous, à
personne d’autre, que sont dédiés mes écrits) » (l.
1-2) : L'apostrophe
directe et volontairement provocatrice.
L'association des "Buveurs très
illustres" et des "vérolés très précieux" crée un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- etude linéaire sur Manon Lescaut
- Manon Lescaut extrait 1 étude linéaire: Explication linéaire, extrait 1 : « J'avais marqué le temps de mon départ … ses malheurs et les miens. »
- Analyse linéaire Cyrano de Bergerac - La scène du balcon
- Analyse linéaire : le dernier feu Les vrilles de la vigne
- Séquence 3 : Le Malade imaginaire de Molière. Analyse linéaire n°12 scène 10 acte III