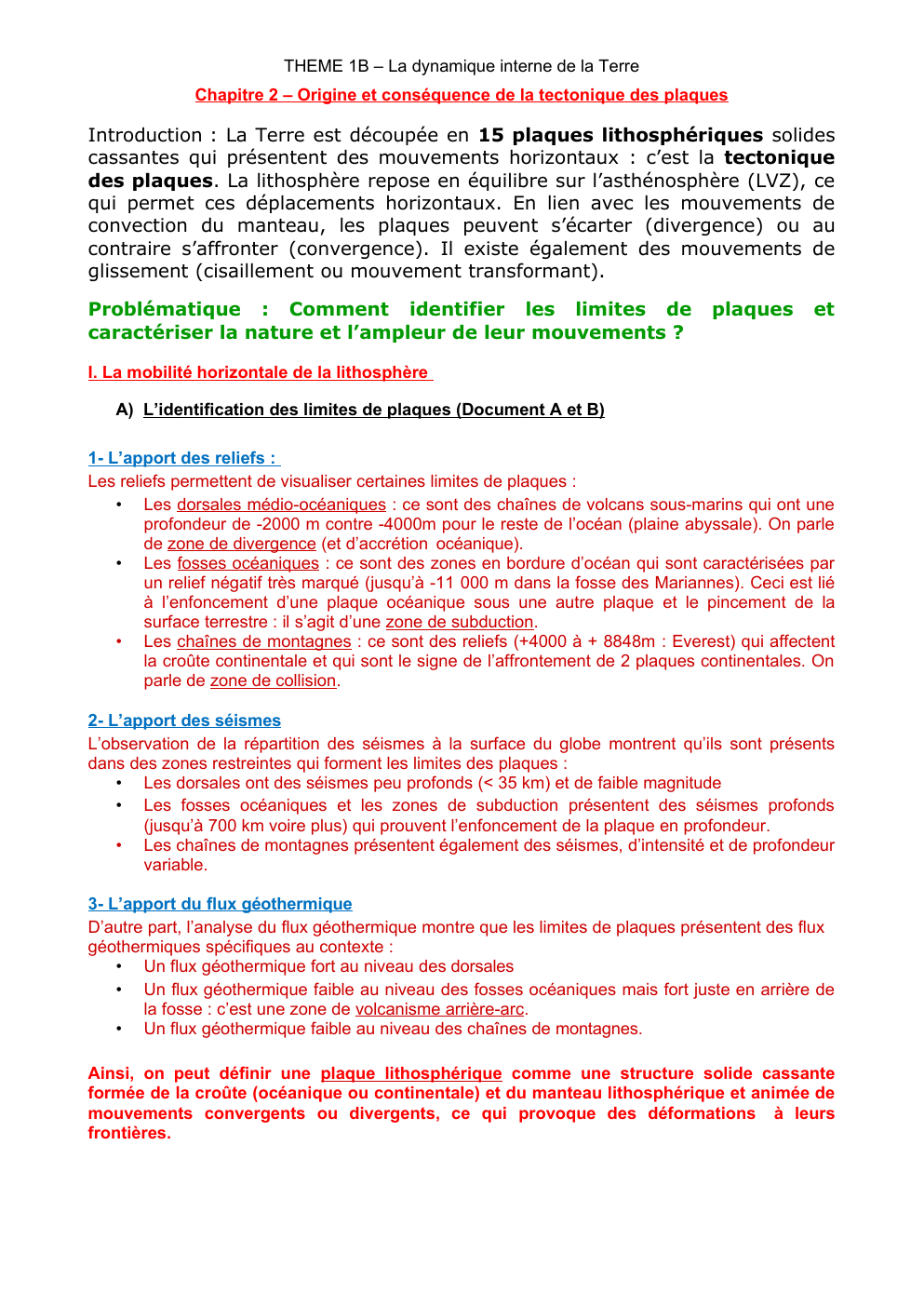cours de svt geologie de premiere
Publié le 18/06/2025
Extrait du document
«
THEME 1B – La dynamique interne de la Terre
Chapitre 2 – Origine et conséquence de la tectonique des plaques
Introduction : La Terre est découpée en 15 plaques lithosphériques solides
cassantes qui présentent des mouvements horizontaux : c’est la tectonique
des plaques.
La lithosphère repose en équilibre sur l’asthénosphère (LVZ), ce
qui permet ces déplacements horizontaux.
En lien avec les mouvements de
convection du manteau, les plaques peuvent s’écarter (divergence) ou au
contraire s’affronter (convergence).
Il existe également des mouvements de
glissement (cisaillement ou mouvement transformant).
Problématique : Comment identifier les limites de
caractériser la nature et l’ampleur de leur mouvements ?
plaques
et
I.
La mobilité horizontale de la lithosphère
A) L’identification des limites de plaques (Document A et B)
1- L’apport des reliefs :
Les reliefs permettent de visualiser certaines limites de plaques :
• Les dorsales médio-océaniques : ce sont des chaînes de volcans sous-marins qui ont une
profondeur de -2000 m contre -4000m pour le reste de l’océan (plaine abyssale).
On parle
de zone de divergence (et d’accrétion océanique).
• Les fosses océaniques : ce sont des zones en bordure d’océan qui sont caractérisées par
un relief négatif très marqué (jusqu’à -11 000 m dans la fosse des Mariannes).
Ceci est lié
à l’enfoncement d’une plaque océanique sous une autre plaque et le pincement de la
surface terrestre : il s’agit d’une zone de subduction.
• Les chaînes de montagnes : ce sont des reliefs (+4000 à + 8848m : Everest) qui affectent
la croûte continentale et qui sont le signe de l’affrontement de 2 plaques continentales.
On
parle de zone de collision.
2- L’apport des séismes
L’observation de la répartition des séismes à la surface du globe montrent qu’ils sont présents
dans des zones restreintes qui forment les limites des plaques :
• Les dorsales ont des séismes peu profonds (< 35 km) et de faible magnitude
• Les fosses océaniques et les zones de subduction présentent des séismes profonds
(jusqu’à 700 km voire plus) qui prouvent l’enfoncement de la plaque en profondeur.
• Les chaînes de montagnes présentent également des séismes, d’intensité et de profondeur
variable.
3- L’apport du flux géothermique
D’autre part, l’analyse du flux géothermique montre que les limites de plaques présentent des flux
géothermiques spécifiques au contexte :
• Un flux géothermique fort au niveau des dorsales
• Un flux géothermique faible au niveau des fosses océaniques mais fort juste en arrière de
la fosse : c’est une zone de volcanisme arrière-arc.
• Un flux géothermique faible au niveau des chaînes de montagnes.
Ainsi, on peut définir une plaque lithosphérique comme une structure solide cassante
formée de la croûte (océanique ou continentale) et du manteau lithosphérique et animée de
mouvements convergents ou divergents, ce qui provoque des déformations à leurs
frontières.
THEME 1B – La dynamique interne de la Terre
B) La vitesse de déplacements des plaques
TP 1 : Les mouvements des plaques lithosphériques
1- L’apport du paléomagnétisme (Documents C et D)
Les basaltes sont les roches du plancher océanique.
Elles se forment par refroidissement d’un
magma.
Or le magma basaltique contient des minéraux ferromagnétiques (magnétite).
Ces
derniers enregistrent les caractéristiques du champ terrestre de l’époque de leur formation.
Le champ magnétique des basaltes peut présenter des sens inversés.
Les périodes caractérisées
par un champ magnétique orienté dans le même sens qu’actuellement sont dites « normales » (en
noir) alors que les périodes dites « inverses » (en blanc).
La répartition de ces anomalies
magnétique est symétrique de part et d’autre de la dorsale ce qui permet de dire que le plancher
océanique se forme à la dorsale.
Les vitesses d’expansion identifiées grâce au paléomagnétisme sont identiques à celles identifiées
par les sédiments océaniques (2 à 8 cm/an), ce qui confirme la nature et l’ampleur du mouvement
2- L’apport des volcans de point chaud
Certains alignements volcaniques, situés en domaine océanique ou continental, sont placés à des
endroits ne correspondant pas à des frontières de plaques.
C’est le cas des volcans de l’archipel
d’Hawaï.
Ces volcans correspondent à des volcans de type points chauds.
Un point chaud est une
zone de remontée du manteau profond à l’origine d’une activité volcanique.
Les volcans sont
alignés et seul un volcan est actif (celui situé sous le point chaud) les autres sont éteints ce qui
montre que la plaque s’est déplacée car le point chaud lui est fixe.
La datation de chaque volcan permet de retracer le mouvement et la vitesse de la plaque.
Dans
l’océan Pacifique, cette méthode donne à nouveau des valeurs de 6 à 8cm/an et montre
également que la plaque a changé de trajectoire (vers le nord puis vers l’ouest).
3- Les données GPS
A partir des années 1980, le développement du GPS (Global Positioning System), un système de
géolocalisation (géodésie spatiale) permet de mesurer les vitesses de déplacements instantanées.
Le GPS comprend au moins 30 satellites orbitant à 20 000 km d'altitude et émettant en
permanence.
A chaque instant, au moins 4 satellites émettent un signal capté par des récepteurs.
Le récepteur pourra alors déterminer sa latitude, sa longitude et son altitude précisément à un
moment donné.
Les données GPS permettent donc d’obtenir le déplacement d’un point donné au
cours du temps et donc sa vitesse.
Cette technique confirme les valeurs obtenues précédemment
mais permet également d’identifier des variations locales.
Conclusion Partie I :
Il existe deux types de mouvements des plaques en lien avec le contexte géologie
• Des mouvements de divergence : les dorsales sont donc de zones de divergence qui
contribue à la formation de l’océan.
• Des mouvements de convergence : les mécanismes de subduction et de collision
sont des zones de convergence
II.
Le dynamisme des zones de divergence
Problématique : comment la dorsale produit-elle la lithosphère océanique, dans un
contexte de divergence ?
TP 2 : Le fonctionnement de la dorsale océanique
A) La structure de la lithosphère océanique
De 1968 à 1980, le programme JOIDES permet de dater les sédiments et le plancher
THEME 1B – La dynamique interne de la Terre
basaltique de la croûte océanique.
Dès lors, on remarque que :
Plus on s’éloigne de la dorsale, plus les sédiments sont épais et plus les couches en contact
avec le fond océanique sont vieilles.
Cette répartition des sédiments est symétrique de part et d’autre de la dorsale.
Dans l’Atlantique, les sédiments les plus anciens remontent à – 180MA, ce qui est corrélé avec
le début de l’ouverture de cet océan au Jurassique.
1- Deux types de dorsales : lentes et rapides (Document 1 TP1)
Les études océanographiques menées depuis des décennies montrent que la surface de la
lithosphère océanique au niveau des dorsales est hétérogène.
Ainsi, la bathymétrie et la
composition de la lithosphère varie beaucoup d’une dorsale à une autre.
A l’aplomb des dorsales
rapides, le plancher océanique, bombé, est caractérisé par la succession de gabbros et basaltes.
En revanche, au niveau des dorsales lentes, le plancher océanique est constitué directement du
manteau comprenant des lentilles dispersées de basaltes et gabbros et il est creusé au centre par
une vallée axiale appelée rift.
Les dorsales sont toutes découpées par des failles normales.
2- Le fonctionnement des dorsales rapides et lentes (Documents 3, 4 et 5 TP1)
L’étude du comportement de la péridotite dans une presse « à enclumes de diamant » permet de
tracer sur un diagramme pression/température/profondeur, son solidus (= courbe montrant les
conditions de pressions et de température nécessaires à un début de fusion) et son liquidus
(courbe de fin de fusion).
Entre ces deux courbes, la péridotite est partiellement fondue.
Si on
reporte sur le diagramme le géotherme d’une dorsale, on observe qu’il recoupe le solidus entre
20 et 80 km de profondeur.
Cela signifie qu’à ces profondeurs sous l’axe de la dorsale, la
péridotite est partiellement fondue.
•
Ainsi, sous les dorsales rapides (vitesse de divergence d’au moins 9cm/an), l’ascension
de péridotite fait diminuer la pression à laquelle celle-ci est soumise (sans que la
température ne diminue).
Cette décompression entraîne sa fusion partielle (max 20% de
péridotite qui entre en fusion).
Le magma qui en résulte remonte pour s’accumuler entre 2
et 7 km de profondeur puis refroidit, formant une croûte océanique de gabbros surmontés
de basaltes en filons et coussins.
Ainsi, dans ces contextes d’accrétion océanique rapide,
la mise en place de lithosphère océanique est gouvernée par des processus magmatiques.
•
Au niveau des dorsales lentes, des failles normales (dont celles de grande surface et
faible pente dites failles de détachement) engendrent la présence d’une vallée axiale (rift)
qui permettent l’exhumation du manteau profond (=péridotites à l’affleurement).
La croûte
océanique est peu épaisse, discontinue voire absente ! Ces déchirures mantelliques sont
favorisées par les interactions avec l’eau qui en s’infiltrant dans les fissures de lithosphère
chaude, transforme la péridotite dure et cassante en péridotite hydratée dite péridotite
serpentinisée.
Ainsi, l’apport d’eau dans le manteau facilite aussi la fusion partielle des
péridotites, produisant des lentilles de gabbros qui cristallisent dans le manteau.
Dans ces
contextes d’accrétion océanique lente, les processus tectoniques prédominent sur....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- cours de svt la plasticité cérébrale
- SVT climat cours
- SVT DEBAT Les pesticides
- LE THEATRE COMIQUE (cours)
- Synthèse svt météo