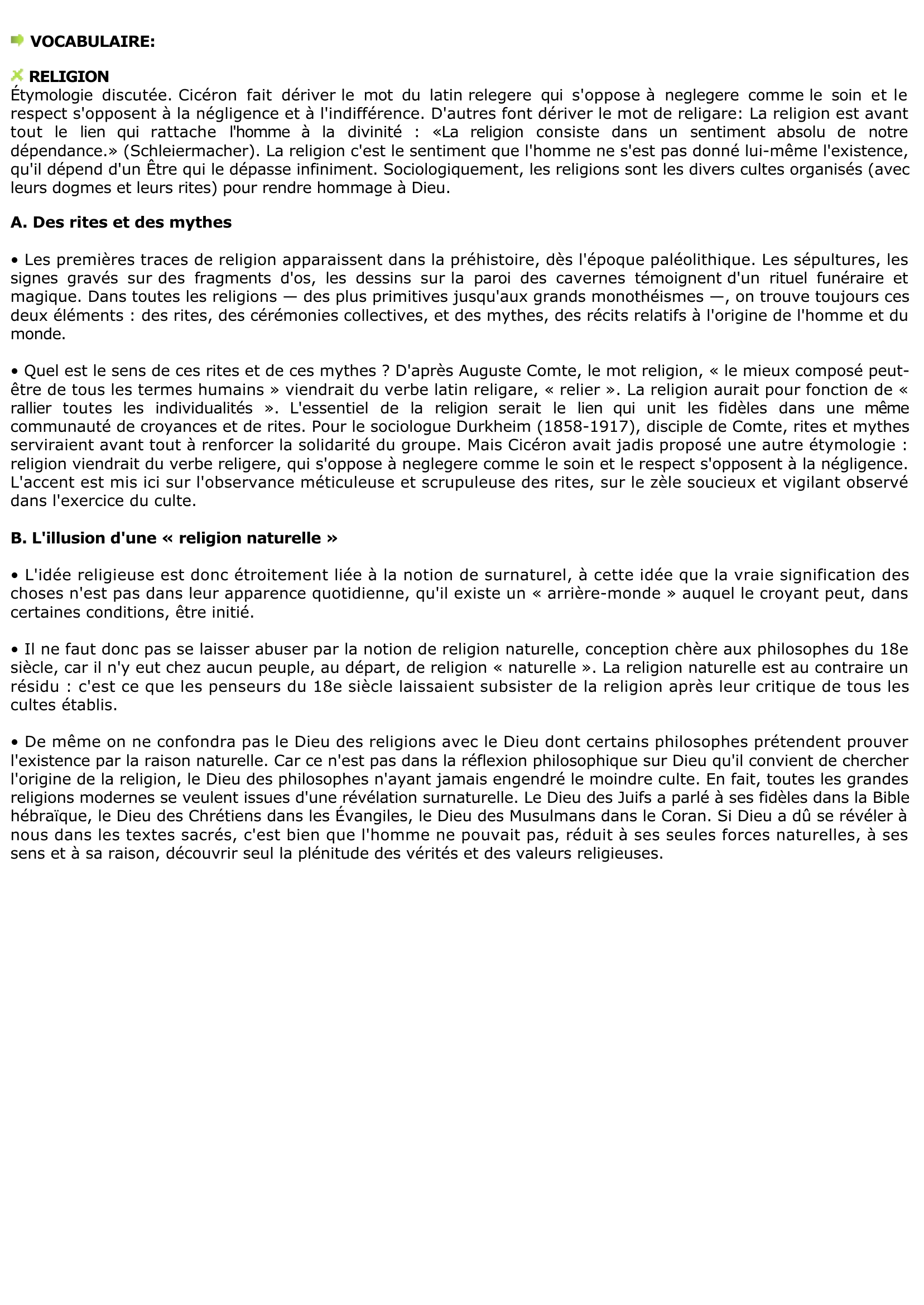Qu'est-ce que la religion ?
Extrait du document
«
VOCABULAIRE:
RELIGION
Étymologie discutée.
Cicéron fait dériver le mot du latin relegere qui s'oppose à neglegere comme le soin et le
respect s'opposent à la négligence et à l'indifférence.
D'autres font dériver le mot de religare: La religion est avant
tout le lien qui rattache l'homme à la divinité : «La religion consiste dans un sentiment absolu de notre
dépendance.» (Schleiermacher).
La religion c'est le sentiment que l'homme ne s'est pas donné lui-même l'existence,
qu'il dépend d'un Être qui le dépasse infiniment.
Sociologiquement, les religions sont les divers cultes organisés (avec
leurs dogmes et leurs rites) pour rendre hommage à Dieu.
A.
Des rites et des mythes
• Les premières traces de religion apparaissent dans la préhistoire, dès l'époque paléolithique.
Les sépultures, les
signes gravés sur des fragments d'os, les dessins sur la paroi des cavernes témoignent d'un rituel funéraire et
magique.
Dans toutes les religions — des plus primitives jusqu'aux grands monothéismes —, on trouve toujours ces
deux éléments : des rites, des cérémonies collectives, et des mythes, des récits relatifs à l'origine de l'homme et du
monde.
• Quel est le sens de ces rites et de ces mythes ? D'après Auguste Comte, le mot religion, « le mieux composé peutêtre de tous les termes humains » viendrait du verbe latin religare, « relier ».
La religion aurait pour fonction de «
rallier toutes les individualités ».
L'essentiel de la religion serait le lien qui unit les fidèles dans une même
communauté de croyances et de rites.
Pour le sociologue Durkheim (1858-1917), disciple de Comte, rites et mythes
serviraient avant tout à renforcer la solidarité du groupe.
Mais Cicéron avait jadis proposé une autre étymologie :
religion viendrait du verbe religere, qui s'oppose à neglegere comme le soin et le respect s'opposent à la négligence.
L'accent est mis ici sur l'observance méticuleuse et scrupuleuse des rites, sur le zèle soucieux et vigilant observé
dans l'exercice du culte.
B.
L'illusion d'une « religion naturelle »
• L'idée religieuse est donc étroitement liée à la notion de surnaturel, à cette idée que la vraie signification des
choses n'est pas dans leur apparence quotidienne, qu'il existe un « arrière-monde » auquel le croyant peut, dans
certaines conditions, être initié.
• Il ne faut donc pas se laisser abuser par la notion de religion naturelle, conception chère aux philosophes du 18e
siècle, car il n'y eut chez aucun peuple, au départ, de religion « naturelle ».
La religion naturelle est au contraire un
résidu : c'est ce que les penseurs du 18e siècle laissaient subsister de la religion après leur critique de tous les
cultes établis.
• De même on ne confondra pas le Dieu des religions avec le Dieu dont certains philosophes prétendent prouver
l'existence par la raison naturelle.
Car ce n'est pas dans la réflexion philosophique sur Dieu qu'il convient de chercher
l'origine de la religion, le Dieu des philosophes n'ayant jamais engendré le moindre culte.
En fait, toutes les grandes
religions modernes se veulent issues d'une révélation surnaturelle.
Le Dieu des Juifs a parlé à ses fidèles dans la Bible
hébraïque, le Dieu des Chrétiens dans les Évangiles, le Dieu des Musulmans dans le Coran.
Si Dieu a dû se révéler à
nous dans les textes sacrés, c'est bien que l'homme ne pouvait pas, réduit à ses seules forces naturelles, à ses
sens et à sa raison, découvrir seul la plénitude des vérités et des valeurs religieuses..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation philosophie Bertrand Russell in Science et Religion: la conscience
- Nietzsche et la religion
- Freud-commentaire de texte sur la religion
- La religion et les états unis
- Cours de philo sur la religion