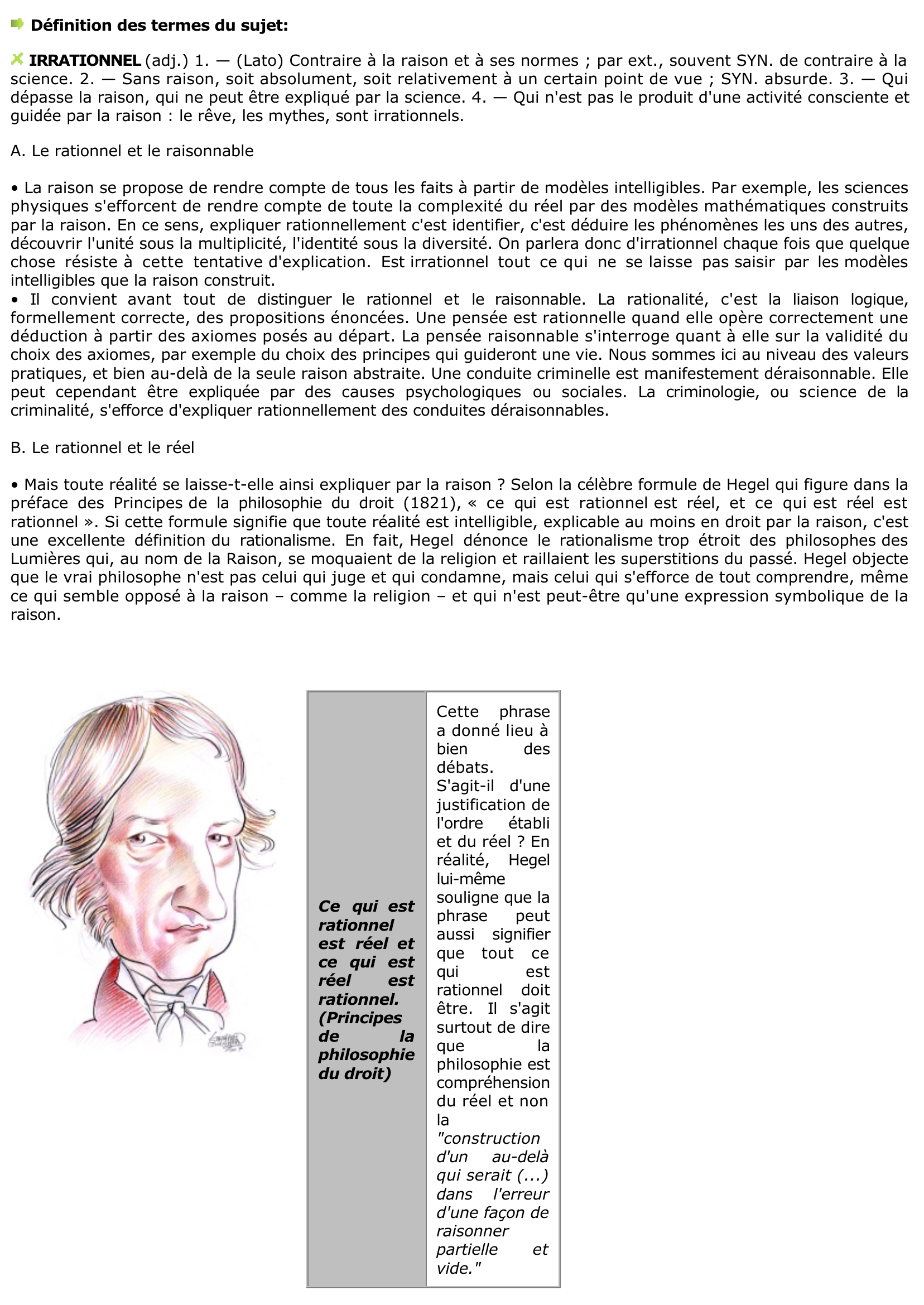Présence de l'irrationnel
Extrait du document
«
Définition des termes du sujet:
IRRATIONNEL (adj.) 1.
— (Lato) Contraire à la raison et à ses normes ; par ext., souvent SYN.
de contraire à la
science.
2.
— Sans raison, soit absolument, soit relativement à un certain point de vue ; SYN.
absurde.
3.
— Qui
dépasse la raison, qui ne peut être expliqué par la science.
4.
— Qui n'est pas le produit d'une activité consciente et
guidée par la raison : le rêve, les mythes, sont irrationnels.
A.
Le rationnel et le raisonnable
• La raison se propose de rendre compte de tous les faits à partir de modèles intelligibles.
Par exemple, les sciences
physiques s'efforcent de rendre compte de toute la complexité du réel par des modèles mathématiques construits
par la raison.
En ce sens, expliquer rationnellement c'est identifier, c'est déduire les phénomènes les uns des autres,
découvrir l'unité sous la multiplicité, l'identité sous la diversité.
On parlera donc d'irrationnel chaque fois que quelque
chose résiste à cette tentative d'explication.
Est irrationnel tout ce qui ne se laisse pas saisir par les modèles
intelligibles que la raison construit.
• Il convient avant tout de distinguer le rationnel et le raisonnable.
La rationalité, c'est la liaison logique,
formellement correcte, des propositions énoncées.
Une pensée est rationnelle quand elle opère correctement une
déduction à partir des axiomes posés au départ.
La pensée raisonnable s'interroge quant à elle sur la validité du
choix des axiomes, par exemple du choix des principes qui guideront une vie.
Nous sommes ici au niveau des valeurs
pratiques, et bien au-delà de la seule raison abstraite.
Une conduite criminelle est manifestement déraisonnable.
Elle
peut cependant être expliquée par des causes psychologiques ou sociales.
La criminologie, ou science de la
criminalité, s'efforce d'expliquer rationnellement des conduites déraisonnables.
B.
Le rationnel et le réel
• Mais toute réalité se laisse-t-elle ainsi expliquer par la raison ? Selon la célèbre formule de Hegel qui figure dans la
préface des Principes de la philosophie du droit (1821), « ce qui est rationnel est réel, et ce qui est réel est
rationnel ».
Si cette formule signifie que toute réalité est intelligible, explicable au moins en droit par la raison, c'est
une excellente définition du rationalisme.
En fait, Hegel dénonce le rationalisme trop étroit des philosophes des
Lumières qui, au nom de la Raison, se moquaient de la religion et raillaient les superstitions du passé.
Hegel objecte
que le vrai philosophe n'est pas celui qui juge et qui condamne, mais celui qui s'efforce de tout comprendre, même
ce qui semble opposé à la raison – comme la religion – et qui n'est peut-être qu'une expression symbolique de la
raison.
Ce qui est
rationnel
est réel et
ce qui est
réel
est
rationnel.
(Principes
de
la
philosophie
du droit)
Cette phrase
a donné lieu à
bien
des
débats.
S'agit-il d'une
justification de
l'ordre
établi
et du réel ? En
réalité, Hegel
lui-même
souligne que la
phrase
peut
aussi signifier
que tout ce
qui
est
rationnel doit
être.
Il s'agit
surtout de dire
que
la
philosophie est
compréhension
du réel et non
la
"construction
d'un
au-delà
qui serait (...)
dans l'erreur
d'une façon de
raisonner
partielle
et
vide.".
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La base américaine d’Okinawa, épine dans le pied du premier ministre japonais. La présence militaire américaine au Japon
- Freud: L'inconscient est irrationnel
- Hegel: La raison, une totalité qui exclut l'irrationnel
- « La raison s'intéresse d'une façon universelle au monde parce qu'elle est la certitude d'avoir dans ce monde sa propre présence, et parce qu'elle est certaine que cette présence du monde est rationnelle. La raison cherche son autre, sachant bien qu'en
- Notes de cours: L'irrationnel et le sens. ?