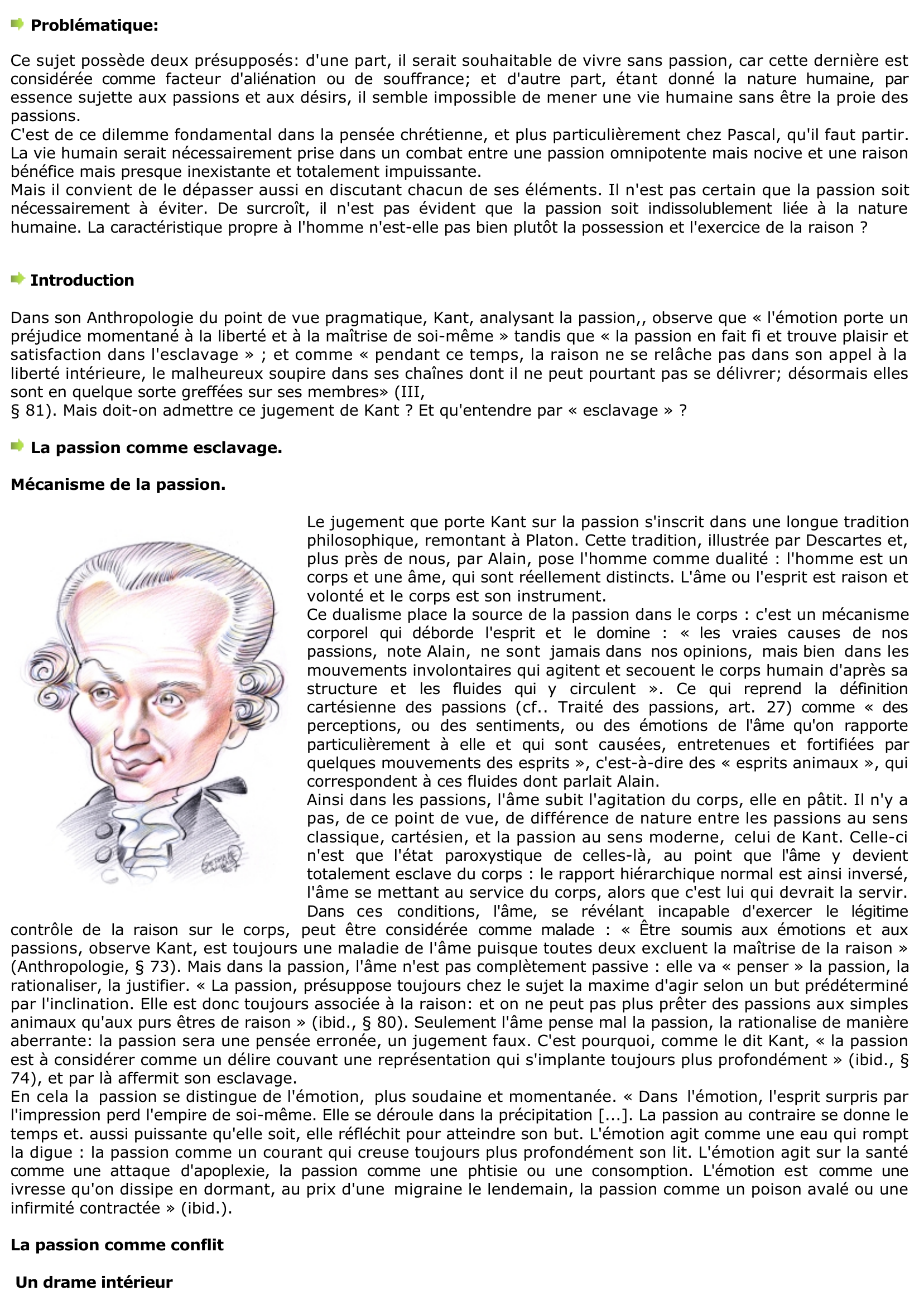Peut-on vivre sans passion ?
Extrait du document
«
Problématique:
Ce sujet possède deux présupposés: d'une part, il serait souhaitable de vivre sans passion, car cette dernière est
considérée comme facteur d'aliénation ou de souffrance; et d'autre part, étant donné la nature humaine, par
essence sujette aux passions et aux désirs, il semble impossible de mener une vie humaine sans être la proie des
passions.
C'est de ce dilemme fondamental dans la pensée chrétienne, et plus particulièrement chez Pascal, qu'il faut partir.
La vie humain serait nécessairement prise dans un combat entre une passion omnipotente mais nocive et une raison
bénéfice mais presque inexistante et totalement impuissante.
Mais il convient de le dépasser aussi en discutant chacun de ses éléments.
Il n'est pas certain que la passion soit
nécessairement à éviter.
De surcroît, il n'est pas évident que la passion soit indissolublement liée à la nature
humaine.
La caractéristique propre à l'homme n'est-elle pas bien plutôt la possession et l'exercice de la raison ?
Introduction
Dans son Anthropologie du point de vue pragmatique, Kant, analysant la passion,, observe que « l'émotion porte un
préjudice momentané à la liberté et à la maîtrise de soi-même » tandis que « la passion en fait fi et trouve plaisir et
satisfaction dans l'esclavage » ; et comme « pendant ce temps, la raison ne se relâche pas dans son appel à la
liberté intérieure, le malheureux soupire dans ses chaînes dont il ne peut pourtant pas se délivrer; désormais elles
sont en quelque sorte greffées sur ses membres» (III,
§ 81).
Mais doit-on admettre ce jugement de Kant ? Et qu'entendre par « esclavage » ?
La passion comme esclavage.
Mécanisme de la passion.
Le jugement que porte Kant sur la passion s'inscrit dans une longue tradition
philosophique, remontant à Platon.
Cette tradition, illustrée par Descartes et,
plus près de nous, par Alain, pose l'homme comme dualité : l'homme est un
corps et une âme, qui sont réellement distincts.
L'âme ou l'esprit est raison et
volonté et le corps est son instrument.
Ce dualisme place la source de la passion dans le corps : c'est un mécanisme
corporel qui déborde l'esprit et le domine : « les vraies causes de nos
passions, note Alain, ne sont jamais dans nos opinions, mais bien dans les
mouvements involontaires qui agitent et secouent le corps humain d'après sa
structure et les fluides qui y circulent ».
Ce qui reprend la définition
cartésienne des passions (cf..
Traité des passions, art.
27) comme « des
perceptions, ou des sentiments, ou des émotions de l'âme qu'on rapporte
particulièrement à elle et qui sont causées, entretenues et fortifiées par
quelques mouvements des esprits », c'est-à-dire des « esprits animaux », qui
correspondent à ces fluides dont parlait Alain.
Ainsi dans les passions, l'âme subit l'agitation du corps, elle en pâtit.
Il n'y a
pas, de ce point de vue, de différence de nature entre les passions au sens
classique, cartésien, et la passion au sens moderne, celui de Kant.
Celle-ci
n'est que l'état paroxystique de celles-là, au point que l'âme y devient
totalement esclave du corps : le rapport hiérarchique normal est ainsi inversé,
l'âme se mettant au service du corps, alors que c'est lui qui devrait la servir.
Dans ces conditions, l'âme, se révélant incapable d'exercer le légitime
contrôle de la raison sur le corps, peut être considérée comme malade : « Être soumis aux émotions et aux
passions, observe Kant, est toujours une maladie de l'âme puisque toutes deux excluent la maîtrise de la raison »
(Anthropologie, § 73).
Mais dans la passion, l'âme n'est pas complètement passive : elle va « penser » la passion, la
rationaliser, la justifier.
« La passion, présuppose toujours chez le sujet la maxime d'agir selon un but prédéterminé
par l'inclination.
Elle est donc toujours associée à la raison: et on ne peut pas plus prêter des passions aux simples
animaux qu'aux purs êtres de raison » (ibid., § 80).
Seulement l'âme pense mal la passion, la rationalise de manière
aberrante: la passion sera une pensée erronée, un jugement faux.
C'est pourquoi, comme le dit Kant, « la passion
est à considérer comme un délire couvant une représentation qui s'implante toujours plus profondément » (ibid., §
74), et par là affermit son esclavage.
En cela la passion se distingue de l'émotion, plus soudaine et momentanée.
« Dans l'émotion, l'esprit surpris par
l'impression perd l'empire de soi-même.
Elle se déroule dans la précipitation [...].
La passion au contraire se donne le
temps et.
aussi puissante qu'elle soit, elle réfléchit pour atteindre son but.
L'émotion agit comme une eau qui rompt
la digue : la passion comme un courant qui creuse toujours plus profondément son lit.
L'émotion agit sur la santé
comme une attaque d'apoplexie, la passion comme une phtisie ou une consomption.
L'émotion est comme une
ivresse qu'on dissipe en dormant, au prix d'une migraine le lendemain, la passion comme un poison avalé ou une
infirmité contractée » (ibid.).
La passion comme conflit
Un drame intérieur.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Doit on vivre sans passion ?
- L'espoir fait-il vivre les hommes ?
- « Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours» Gandhi
- travailler moins est-ce vivre mieux ?
- Philosopher, est‐ce apprendre à vivre ?