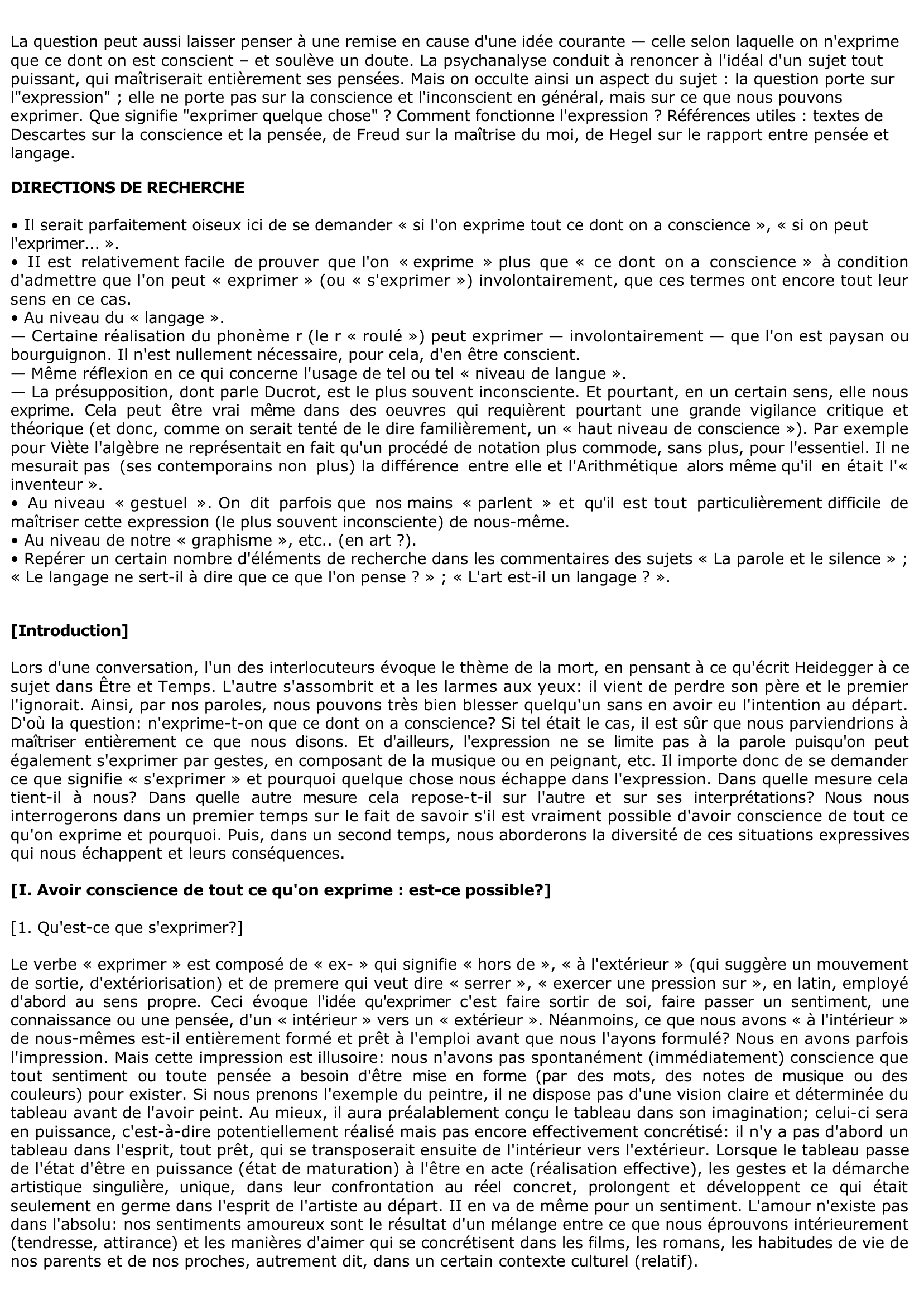N'exprime-t-on que ce dont on est conscient ?
Extrait du document
«
La question peut aussi laisser penser à une remise en cause d'une idée courante — celle selon laquelle on n'exprime
que ce dont on est conscient – et soulève un doute.
La psychanalyse conduit à renoncer à l'idéal d'un sujet tout
puissant, qui maîtriserait entièrement ses pensées.
Mais on occulte ainsi un aspect du sujet : la question porte sur
l"expression" ; elle ne porte pas sur la conscience et l'inconscient en général, mais sur ce que nous pouvons
exprimer.
Que signifie "exprimer quelque chose" ? Comment fonctionne l'expression ? Références utiles : textes de
Descartes sur la conscience et la pensée, de Freud sur la maîtrise du moi, de Hegel sur le rapport entre pensée et
langage.
DIRECTIONS DE RECHERCHE
• Il serait parfaitement oiseux ici de se demander « si l'on exprime tout ce dont on a conscience », « si on peut
l'exprimer...
».
• II est relativement facile de prouver que l'on « exprime » plus que « ce dont on a conscience » à condition
d'admettre que l'on peut « exprimer » (ou « s'exprimer ») involontairement, que ces termes ont encore tout leur
sens en ce cas.
• Au niveau du « langage ».
— Certaine réalisation du phonème r (le r « roulé ») peut exprimer — involontairement — que l'on est paysan ou
bourguignon.
Il n'est nullement nécessaire, pour cela, d'en être conscient.
— Même réflexion en ce qui concerne l'usage de tel ou tel « niveau de langue ».
— La présupposition, dont parle Ducrot, est le plus souvent inconsciente.
Et pourtant, en un certain sens, elle nous
exprime.
Cela peut être vrai même dans des oeuvres qui requièrent pourtant une grande vigilance critique et
théorique (et donc, comme on serait tenté de le dire familièrement, un « haut niveau de conscience »).
Par exemple
pour Viète l'algèbre ne représentait en fait qu'un procédé de notation plus commode, sans plus, pour l'essentiel.
Il ne
mesurait pas (ses contemporains non plus) la différence entre elle et l'Arithmétique alors même qu'il en était l'«
inventeur ».
• Au niveau « gestuel ».
On dit parfois que nos mains « parlent » et qu'il est tout particulièrement difficile de
maîtriser cette expression (le plus souvent inconsciente) de nous-même.
• Au niveau de notre « graphisme », etc..
(en art ?).
• Repérer un certain nombre d'éléments de recherche dans les commentaires des sujets « La parole et le silence » ;
« Le langage ne sert-il à dire que ce que l'on pense ? » ; « L'art est-il un langage ? ».
[Introduction]
Lors d'une conversation, l'un des interlocuteurs évoque le thème de la mort, en pensant à ce qu'écrit Heidegger à ce
sujet dans Être et Temps.
L'autre s'assombrit et a les larmes aux yeux: il vient de perdre son père et le premier
l'ignorait.
Ainsi, par nos paroles, nous pouvons très bien blesser quelqu'un sans en avoir eu l'intention au départ.
D'où la question: n'exprime-t-on que ce dont on a conscience? Si tel était le cas, il est sûr que nous parviendrions à
maîtriser entièrement ce que nous disons.
Et d'ailleurs, l'expression ne se limite pas à la parole puisqu'on peut
également s'exprimer par gestes, en composant de la musique ou en peignant, etc.
Il importe donc de se demander
ce que signifie « s'exprimer » et pourquoi quelque chose nous échappe dans l'expression.
Dans quelle mesure cela
tient-il à nous? Dans quelle autre mesure cela repose-t-il sur l'autre et sur ses interprétations? Nous nous
interrogerons dans un premier temps sur le fait de savoir s'il est vraiment possible d'avoir conscience de tout ce
qu'on exprime et pourquoi.
Puis, dans un second temps, nous aborderons la diversité de ces situations expressives
qui nous échappent et leurs conséquences.
[I.
Avoir conscience de tout ce qu'on exprime : est-ce possible?]
[1.
Qu'est-ce que s'exprimer?]
Le verbe « exprimer » est composé de « ex- » qui signifie « hors de », « à l'extérieur » (qui suggère un mouvement
de sortie, d'extériorisation) et de premere qui veut dire « serrer », « exercer une pression sur », en latin, employé
d'abord au sens propre.
Ceci évoque l'idée qu'exprimer c'est faire sortir de soi, faire passer un sentiment, une
connaissance ou une pensée, d'un « intérieur » vers un « extérieur ».
Néanmoins, ce que nous avons « à l'intérieur »
de nous-mêmes est-il entièrement formé et prêt à l'emploi avant que nous l'ayons formulé? Nous en avons parfois
l'impression.
Mais cette impression est illusoire: nous n'avons pas spontanément (immédiatement) conscience que
tout sentiment ou toute pensée a besoin d'être mise en forme (par des mots, des notes de musique ou des
couleurs) pour exister.
Si nous prenons l'exemple du peintre, il ne dispose pas d'une vision claire et déterminée du
tableau avant de l'avoir peint.
Au mieux, il aura préalablement conçu le tableau dans son imagination; celui-ci sera
en puissance, c'est-à-dire potentiellement réalisé mais pas encore effectivement concrétisé: il n'y a pas d'abord un
tableau dans l'esprit, tout prêt, qui se transposerait ensuite de l'intérieur vers l'extérieur.
Lorsque le tableau passe
de l'état d'être en puissance (état de maturation) à l'être en acte (réalisation effective), les gestes et la démarche
artistique singulière, unique, dans leur confrontation au réel concret, prolongent et développent ce qui était
seulement en germe dans l'esprit de l'artiste au départ.
II en va de même pour un sentiment.
L'amour n'existe pas
dans l'absolu: nos sentiments amoureux sont le résultat d'un mélange entre ce que nous éprouvons intérieurement
(tendresse, attirance) et les manières d'aimer qui se concrétisent dans les films, les romans, les habitudes de vie de
nos parents et de nos proches, autrement dit, dans un certain contexte culturel (relatif)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SES Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?
- Suffit-il d'être conscient de ses actes pour en être responsable ?
- « monde conscient » Nietzsche
- Y’a-t-il un sens à dire que l’inconscient s’exprime ?
- KANT: «Avoir des représentations, et pourtant n'en être pas conscient, constitue, semble-t-il, une contradiction...»