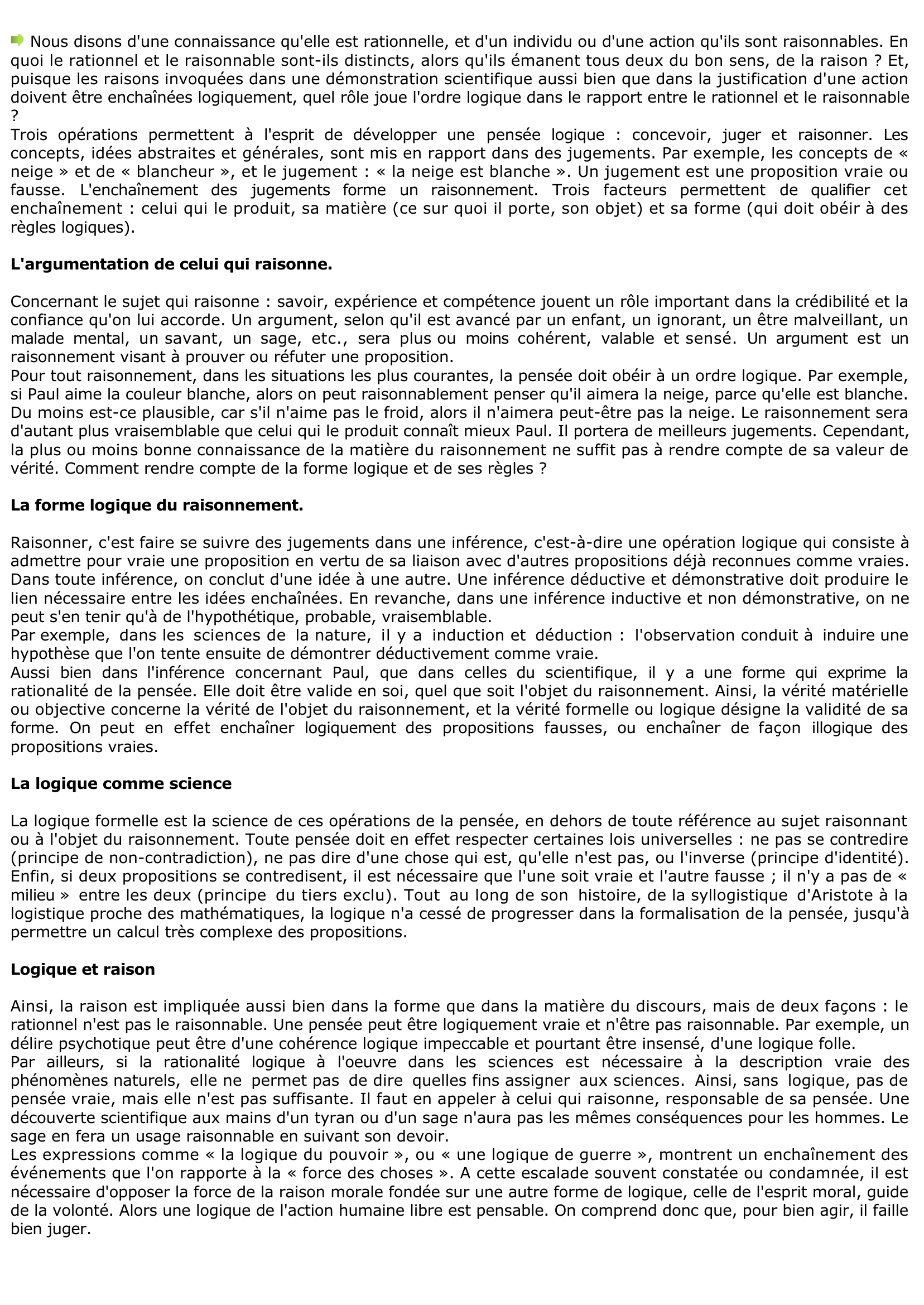Logique: rationnel et raisonnable ?
Extrait du document
«
Nous disons d'une connaissance qu'elle est rationnelle, et d'un individu ou d'une action qu'ils sont raisonnables.
En
quoi le rationnel et le raisonnable sont-ils distincts, alors qu'ils émanent tous deux du bon sens, de la raison ? Et,
puisque les raisons invoquées dans une démonstration scientifique aussi bien que dans la justification d'une action
doivent être enchaînées logiquement, quel rôle joue l'ordre logique dans le rapport entre le rationnel et le raisonnable
?
Trois opérations permettent à l'esprit de développer une pensée logique : concevoir, juger et raisonner.
Les
concepts, idées abstraites et générales, sont mis en rapport dans des jugements.
Par exemple, les concepts de «
neige » et de « blancheur », et le jugement : « la neige est blanche ».
Un jugement est une proposition vraie ou
fausse.
L'enchaînement des jugements forme un raisonnement.
Trois facteurs permettent de qualifier cet
enchaînement : celui qui le produit, sa matière (ce sur quoi il porte, son objet) et sa forme (qui doit obéir à des
règles logiques).
L'argumentation de celui qui raisonne.
Concernant le sujet qui raisonne : savoir, expérience et compétence jouent un rôle important dans la crédibilité et la
confiance qu'on lui accorde.
Un argument, selon qu'il est avancé par un enfant, un ignorant, un être malveillant, un
malade mental, un savant, un sage, etc., sera plus ou moins cohérent, valable et sensé.
Un argument est un
raisonnement visant à prouver ou réfuter une proposition.
Pour tout raisonnement, dans les situations les plus courantes, la pensée doit obéir à un ordre logique.
Par exemple,
si Paul aime la couleur blanche, alors on peut raisonnablement penser qu'il aimera la neige, parce qu'elle est blanche.
Du moins est-ce plausible, car s'il n'aime pas le froid, alors il n'aimera peut-être pas la neige.
Le raisonnement sera
d'autant plus vraisemblable que celui qui le produit connaît mieux Paul.
Il portera de meilleurs jugements.
Cependant,
la plus ou moins bonne connaissance de la matière du raisonnement ne suffit pas à rendre compte de sa valeur de
vérité.
Comment rendre compte de la forme logique et de ses règles ?
La forme logique du raisonnement.
Raisonner, c'est faire se suivre des jugements dans une inférence, c'est-à-dire une opération logique qui consiste à
admettre pour vraie une proposition en vertu de sa liaison avec d'autres propositions déjà reconnues comme vraies.
Dans toute inférence, on conclut d'une idée à une autre.
Une inférence déductive et démonstrative doit produire le
lien nécessaire entre les idées enchaînées.
En revanche, dans une inférence inductive et non démonstrative, on ne
peut s'en tenir qu'à de l'hypothétique, probable, vraisemblable.
Par exemple, dans les sciences de la nature, il y a induction et déduction : l'observation conduit à induire une
hypothèse que l'on tente ensuite de démontrer déductivement comme vraie.
Aussi bien dans l'inférence concernant Paul, que dans celles du scientifique, il y a une forme qui exprime la
rationalité de la pensée.
Elle doit être valide en soi, quel que soit l'objet du raisonnement.
Ainsi, la vérité matérielle
ou objective concerne la vérité de l'objet du raisonnement, et la vérité formelle ou logique désigne la validité de sa
forme.
On peut en effet enchaîner logiquement des propositions fausses, ou enchaîner de façon illogique des
propositions vraies.
La logique comme science
La logique formelle est la science de ces opérations de la pensée, en dehors de toute référence au sujet raisonnant
ou à l'objet du raisonnement.
Toute pensée doit en effet respecter certaines lois universelles : ne pas se contredire
(principe de non-contradiction), ne pas dire d'une chose qui est, qu'elle n'est pas, ou l'inverse (principe d'identité).
Enfin, si deux propositions se contredisent, il est nécessaire que l'une soit vraie et l'autre fausse ; il n'y a pas de «
milieu » entre les deux (principe du tiers exclu).
Tout au long de son histoire, de la syllogistique d'Aristote à la
logistique proche des mathématiques, la logique n'a cessé de progresser dans la formalisation de la pensée, jusqu'à
permettre un calcul très complexe des propositions.
Logique et raison
Ainsi, la raison est impliquée aussi bien dans la forme que dans la matière du discours, mais de deux façons : le
rationnel n'est pas le raisonnable.
Une pensée peut être logiquement vraie et n'être pas raisonnable.
Par exemple, un
délire psychotique peut être d'une cohérence logique impeccable et pourtant être insensé, d'une logique folle.
Par ailleurs, si la rationalité logique à l'oeuvre dans les sciences est nécessaire à la description vraie des
phénomènes naturels, elle ne permet pas de dire quelles fins assigner aux sciences.
Ainsi, sans logique, pas de
pensée vraie, mais elle n'est pas suffisante.
Il faut en appeler à celui qui raisonne, responsable de sa pensée.
Une
découverte scientifique aux mains d'un tyran ou d'un sage n'aura pas les mêmes conséquences pour les hommes.
Le
sage en fera un usage raisonnable en suivant son devoir.
Les expressions comme « la logique du pouvoir », ou « une logique de guerre », montrent un enchaînement des
événements que l'on rapporte à la « force des choses ».
A cette escalade souvent constatée ou condamnée, il est
nécessaire d'opposer la force de la raison morale fondée sur une autre forme de logique, celle de l'esprit moral, guide
de la volonté.
Alors une logique de l'action humaine libre est pensable.
On comprend donc que, pour bien agir, il faille
bien juger..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le raisonnable se confond-il avec le rationnel ?
- ARISTOTE : L'ANIMAL RATIONNEL
- Toutes les propositions de logique disent la même chose. A savoir rien. Wittgenstein
- Bergson: Est-il raisonnable de faire confiance à ses intuitions ?
- Kant: La raison est-elle réductible à la logique ?