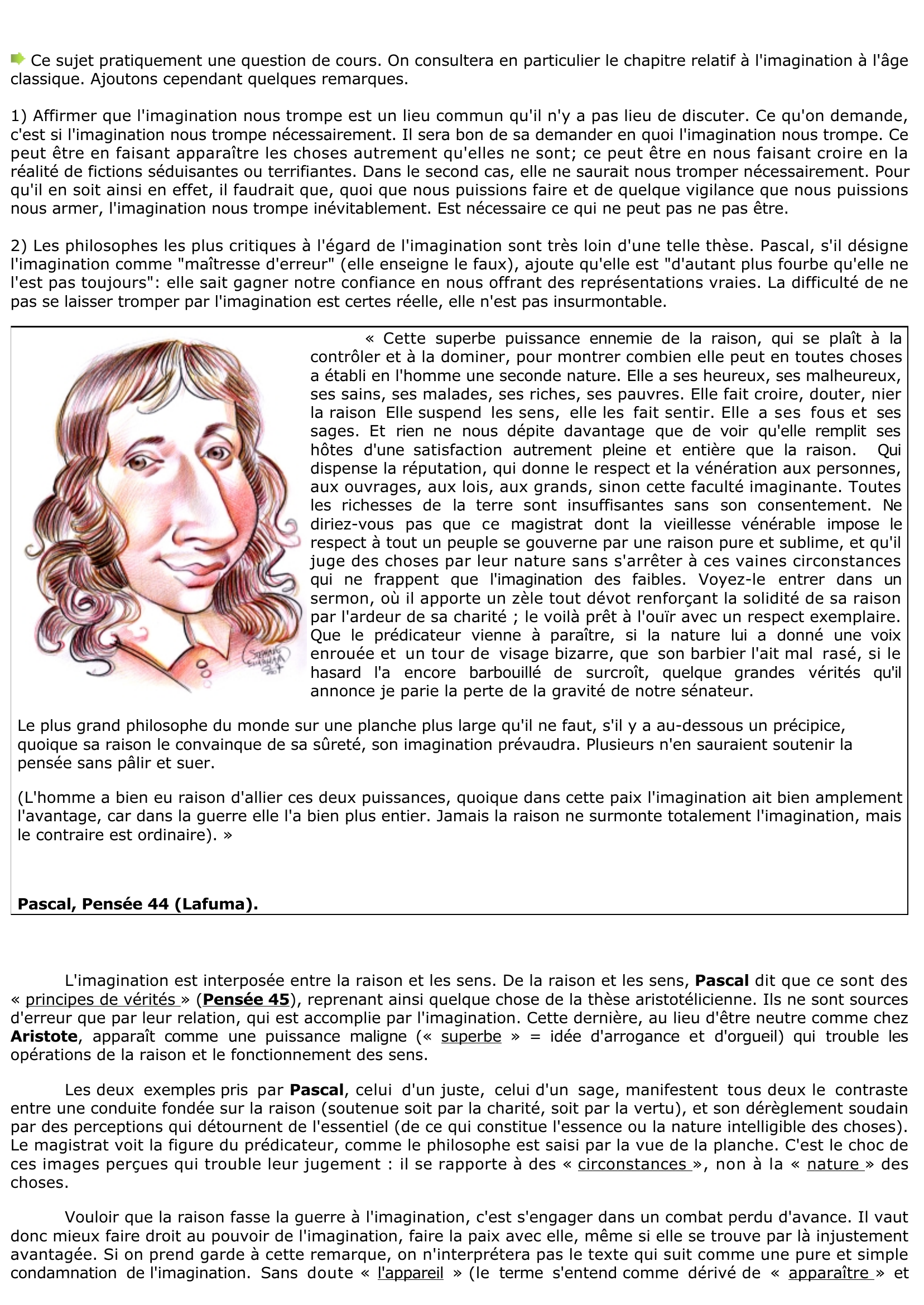L’imagination est-elle le refuge de la liberté ?
Extrait du document
«
Ce sujet pratiquement une question de cours.
On consultera en particulier le chapitre relatif à l'imagination à l'âge
classique.
Ajoutons cependant quelques remarques.
1) Affirmer que l'imagination nous trompe est un lieu commun qu'il n'y a pas lieu de discuter.
Ce qu'on demande,
c'est si l'imagination nous trompe nécessairement.
Il sera bon de sa demander en quoi l'imagination nous trompe.
Ce
peut être en faisant apparaître les choses autrement qu'elles ne sont; ce peut être en nous faisant croire en la
réalité de fictions séduisantes ou terrifiantes.
Dans le second cas, elle ne saurait nous tromper nécessairement.
Pour
qu'il en soit ainsi en effet, il faudrait que, quoi que nous puissions faire et de quelque vigilance que nous puissions
nous armer, l'imagination nous trompe inévitablement.
Est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être.
2) Les philosophes les plus critiques à l'égard de l'imagination sont très loin d'une telle thèse.
Pascal, s'il désigne
l'imagination comme "maîtresse d'erreur" (elle enseigne le faux), ajoute qu'elle est "d'autant plus fourbe qu'elle ne
l'est pas toujours": elle sait gagner notre confiance en nous offrant des représentations vraies.
La difficulté de ne
pas se laisser tromper par l'imagination est certes réelle, elle n'est pas insurmontable.
« Cette superbe puissance ennemie de la raison, qui se plaît à la
contrôler et à la dominer, pour montrer combien elle peut en toutes choses
a établi en l'homme une seconde nature.
Elle a ses heureux, ses malheureux,
ses sains, ses malades, ses riches, ses pauvres.
Elle fait croire, douter, nier
la raison Elle suspend les sens, elle les fait sentir.
Elle a ses fous et ses
sages.
Et rien ne nous dépite davantage que de voir qu'elle remplit ses
hôtes d'une satisfaction autrement pleine et entière que la raison.
Qui
dispense la réputation, qui donne le respect et la vénération aux personnes,
aux ouvrages, aux lois, aux grands, sinon cette faculté imaginante.
Toutes
les richesses de la terre sont insuffisantes sans son consentement.
Ne
diriez-vous pas que ce magistrat dont la vieillesse vénérable impose le
respect à tout un peuple se gouverne par une raison pure et sublime, et qu'il
juge des choses par leur nature sans s'arrêter à ces vaines circonstances
qui ne frappent que l'imagination des faibles.
Voyez-le entrer dans un
sermon, où il apporte un zèle tout dévot renforçant la solidité de sa raison
par l'ardeur de sa charité ; le voilà prêt à l'ouïr avec un respect exemplaire.
Que le prédicateur vienne à paraître, si la nature lui a donné une voix
enrouée et un tour de visage bizarre, que son barbier l'ait mal rasé, si le
hasard l'a encore barbouillé de surcroît, quelque grandes vérités qu'il
annonce je parie la perte de la gravité de notre sénateur.
Le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a au-dessous un précipice,
quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra.
Plusieurs n'en sauraient soutenir la
pensée sans pâlir et suer.
(L'homme a bien eu raison d'allier ces deux puissances, quoique dans cette paix l'imagination ait bien amplement
l'avantage, car dans la guerre elle l'a bien plus entier.
Jamais la raison ne surmonte totalement l'imagination, mais
le contraire est ordinaire).
»
Pascal, Pensée 44 (Lafuma).
L'imagination est interposée entre la raison et les sens.
De la raison et les sens, Pascal dit que ce sont des
« principes de vérités » (Pensée 45), reprenant ainsi quelque chose de la thèse aristotélicienne.
Ils ne sont sources
d'erreur que par leur relation, qui est accomplie par l'imagination.
Cette dernière, au lieu d'être neutre comme chez
Aristote, apparaît comme une puissance maligne (« superbe » = idée d'arrogance et d'orgueil) qui trouble les
opérations de la raison et le fonctionnement des sens.
Les deux exemples pris par Pascal, celui d'un juste, celui d'un sage, manifestent tous deux le contraste
entre une conduite fondée sur la raison (soutenue soit par la charité, soit par la vertu), et son dérèglement soudain
par des perceptions qui détournent de l'essentiel (de ce qui constitue l'essence ou la nature intelligible des choses).
Le magistrat voit la figure du prédicateur, comme le philosophe est saisi par la vue de la planche.
C'est le choc de
ces images perçues qui trouble leur jugement : il se rapporte à des « circonstances », non à la « nature » des
choses.
Vouloir que la raison fasse la guerre à l'imagination, c'est s'engager dans un combat perdu d'avance.
Il vaut
donc mieux faire droit au pouvoir de l'imagination, faire la paix avec elle, même si elle se trouve par là injustement
avantagée.
Si on prend garde à cette remarque, on n'interprétera pas le texte qui suit comme une pure et simple
condamnation de l'imagination.
Sans doute « l'appareil » (le terme s'entend comme dérivé de « apparaître » et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- l'imagination est-elle le refuge de la liberté ?
- L'imagination est elle le refuge de la liberté?
- L'IMAGINATION EST-ELLE LE REFUGE DE LA LIBERTÉ ?
- L'imagination est-elle le refuge de la liberté ?
- L'imagination est-elle le refuge de la liberté ?