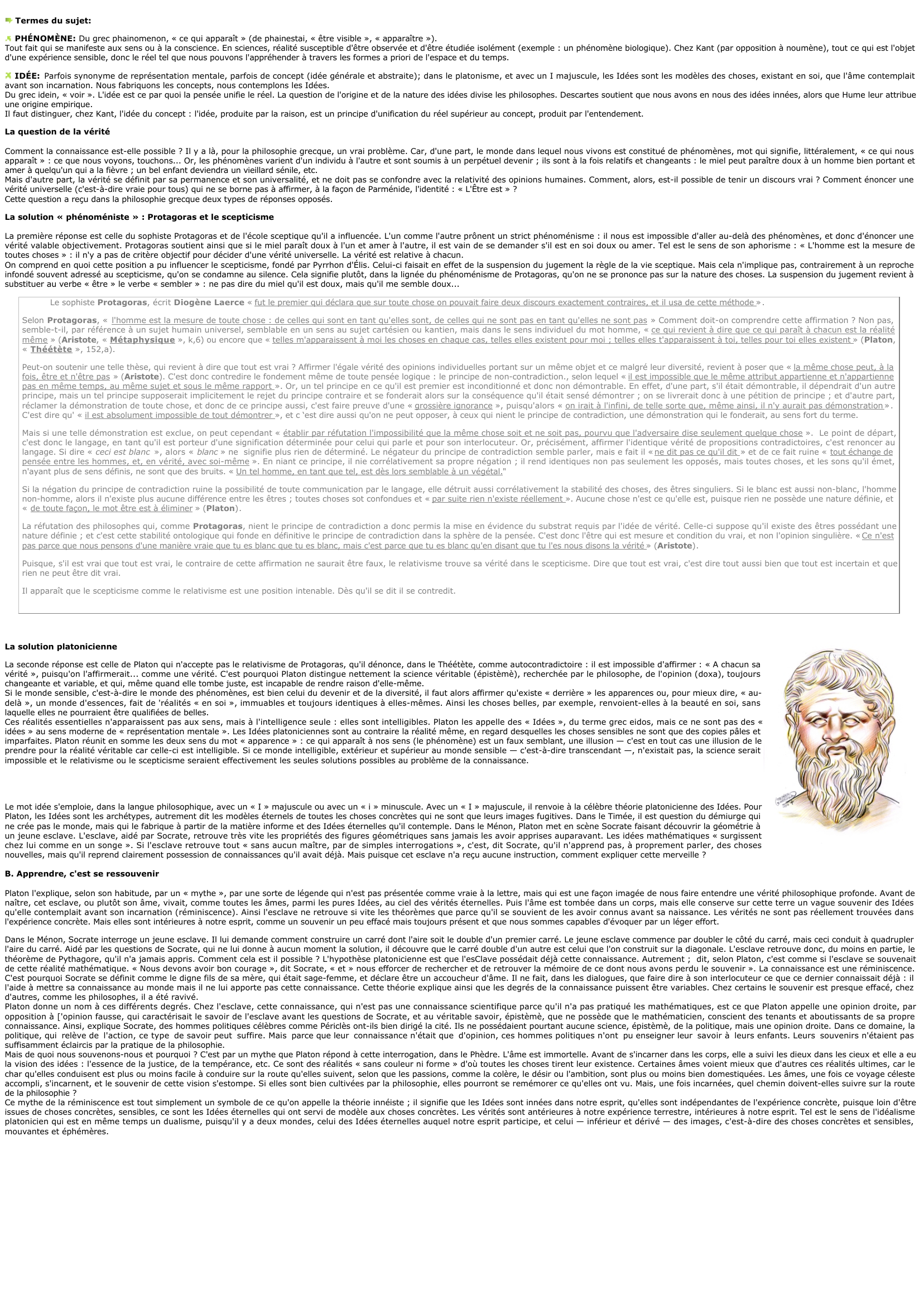Les phénomènes et les Idées ?
Extrait du document
«
Termes du sujet:
PHÉNOMÈNE: Du grec phainomenon, « ce qui apparaît » (de phainestai, « être visible », « apparaître »).
Tout fait qui se manifeste aux sens ou à la conscience.
En sciences, réalité susceptible d'être observée et d'être étudiée isolément (exemple : un phénomène biologique).
Chez Kant (par opposition à noumène), tout ce qui est l'objet
d'une expérience sensible, donc le réel tel que nous pouvons l'appréhender à travers les formes a priori de l'espace et du temps.
IDÉE: Parfois synonyme de représentation mentale, parfois de concept (idée générale et abstraite); dans le platonisme, et avec un I majuscule, les Idées sont les modèles des choses, existant en soi, que l'âme contemplait
avant son incarnation.
Nous fabriquons les concepts, nous contemplons les Idées.
Du grec idein, « voir ».
L'idée est ce par quoi la pensée unifie le réel.
La question de l'origine et de la nature des idées divise les philosophes.
Descartes soutient que nous avons en nous des idées innées, alors que Hume leur attribue
une origine empirique.
Il faut distinguer, chez Kant, l'idée du concept : l'idée, produite par la raison, est un principe d'unification du réel supérieur au concept, produit par l'entendement.
La question de la vérité
Comment la connaissance est-elle possible ? Il y a là, pour la philosophie grecque, un vrai problème.
Car, d'une part, le monde dans lequel nous vivons est constitué de phénomènes, mot qui signifie, littéralement, « ce qui nous
apparaît » : ce que nous voyons, touchons...
Or, les phénomènes varient d'un individu à l'autre et sont soumis à un perpétuel devenir ; ils sont à la fois relatifs et changeants : le miel peut paraître doux à un homme bien portant et
amer à quelqu'un qui a la fièvre ; un bel enfant deviendra un vieillard sénile, etc.
Mais d'autre part, la vérité se définit par sa permanence et son universalité, et ne doit pas se confondre avec la relativité des opinions humaines.
Comment, alors, est-il possible de tenir un discours vrai ? Comment énoncer une
vérité universelle (c'est-à-dire vraie pour tous) qui ne se borne pas à affirmer, à la façon de Parménide, l'identité : « L'Être est » ?
Cette question a reçu dans la philosophie grecque deux types de réponses opposés.
La solution « phénoméniste » : Protagoras et le scepticisme
La première réponse est celle du sophiste Protagoras et de l'école sceptique qu'il a influencée.
L'un comme l'autre prônent un strict phénoménisme : il nous est impossible d'aller au-delà des phénomènes, et donc d'énoncer une
vérité valable objectivement.
Protagoras soutient ainsi que si le miel paraît doux à l'un et amer à l'autre, il est vain de se demander s'il est en soi doux ou amer.
Tel est le sens de son aphorisme : « L'homme est la mesure de
toutes choses » : il n'y a pas de critère objectif pour décider d'une vérité universelle.
La vérité est relative à chacun.
On comprend en quoi cette position a pu influencer le scepticisme, fondé par Pyrrhon d'Élis.
Celui-ci faisait en effet de la suspension du jugement la règle de la vie sceptique.
Mais cela n'implique pas, contrairement à un reproche
infondé souvent adressé au scepticisme, qu'on se condamne au silence.
Cela signifie plutôt, dans la lignée du phénoménisme de Protagoras, qu'on ne se prononce pas sur la nature des choses.
La suspension du jugement revient à
substituer au verbe « être » le verbe « sembler » : ne pas dire du miel qu'il est doux, mais qu'il me semble doux...
Le sophiste Protagoras, écrit Diogène Laerce « fut le premier qui déclara que sur toute chose on pouvait faire deux discours exactement contraires, et il usa de cette méthode ».
Selon Protagoras, « l'homme est la mesure de toute chose : de celles qui sont en tant qu'elles sont, de celles qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas » Comment doit-on comprendre cette affirmation ? Non pas,
semble-t-il, par référence à un sujet humain universel, semblable en un sens au sujet cartésien ou kantien, mais dans le sens individuel du mot homme, « ce qui revient à dire que ce qui paraît à chacun est la réalité
même » (Aristote, « Métaphysique », k,6) ou encore que « telles m'apparaissent à moi les choses en chaque cas, telles elles existent pour moi ; telles elles t'apparaissent à toi, telles pour toi elles existent » (Platon,
« Théétète », 152,a).
Peut-on soutenir une telle thèse, qui revient à dire que tout est vrai ? Affirmer l'égale vérité des opinions individuelles portant sur un même objet et ce malgré leur diversité, revient à poser que « la même chose peut, à la
fois, être et n'être pas » (Aristote).
C'est donc contredire le fondement même de toute pensée logique : le principe de non-contradiction., selon lequel « il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne
pas en même temps, au même sujet et sous le même rapport ».
Or, un tel principe en ce qu'il est premier est inconditionné et donc non démontrable.
En effet, d'une part, s'il était démontrable, il dépendrait d'un autre
principe, mais un tel principe supposerait implicitement le rejet du principe contraire et se fonderait alors sur la conséquence qu'il était sensé démontrer ; on se livrerait donc à une pétition de principe ; et d'autre part,
réclamer la démonstration de toute chose, et donc de ce principe aussi, c'est faire preuve d'une « grossière ignorance », puisqu'alors « on irait à l'infini, de telle sorte que, même ainsi, il n'y aurait pas démonstration ».
C'est dire qu' « il est absolument impossible de tout démontrer », et c ‘est dire aussi qu'on ne peut opposer, à ceux qui nient le principe de contradiction, une démonstration qui le fonderait, au sens fort du terme.
Mais si une telle démonstration est exclue, on peut cependant « établir par réfutation l'impossibilité que la même chose soit et ne soit pas, pourvu que l'adversaire dise seulement quelque chose ».
Le point de départ,
c'est donc le langage, en tant qu'il est porteur d'une signification déterminée pour celui qui parle et pour son interlocuteur.
Or, précisément, affirmer l'identique vérité de propositions contradictoires, c'est renoncer au
langage.
Si dire « ceci est blanc », alors « blanc » ne signifie plus rien de déterminé.
Le négateur du principe de contradiction semble parler, mais e fait il « ne dit pas ce qu'il dit » et de ce fait ruine « tout échange de
pensée entre les hommes, et, en vérité, avec soi-même ».
En niant ce principe, il nie corrélativement sa propre négation ; il rend identiques non pas seulement les opposés, mais toutes choses, et les sons qu'il émet,
n'ayant plus de sens définis, ne sont que des bruits.
« Un tel homme, en tant que tel, est dès lors semblable à un végétal."
Si la négation du principe de contradiction ruine la possibilité de toute communication par le langage, elle détruit aussi corrélativement la stabilité des choses, des êtres singuliers.
Si le blanc est aussi non-blanc, l'homme
non-homme, alors il n'existe plus aucune différence entre les êtres ; toutes choses sot confondues et « par suite rien n'existe réellement ».
Aucune chose n'est ce qu'elle est, puisque rien ne possède une nature définie, et
« de toute façon, le mot être est à éliminer » (Platon).
La réfutation des philosophes qui, comme Protagoras, nient le principe de contradiction a donc permis la mise en évidence du substrat requis par l'idée de vérité.
Celle-ci suppose qu'il existe des êtres possédant une
nature définie ; et c'est cette stabilité ontologique qui fonde en définitive le principe de contradiction dans la sphère de la pensée.
C'est donc l'être qui est mesure et condition du vrai, et non l'opinion singulière.
« Ce n'est
pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es nous disons la vérité » (Aristote).
Puisque, s'il est vrai que tout est vrai, le contraire de cette affirmation ne saurait être faux, le relativisme trouve sa vérité dans le scepticisme.
Dire que tout est vrai, c'est dire tout aussi bien que tout est incertain et que
rien ne peut être dit vrai.
Il apparaît que le scepticisme comme le relativisme est une position intenable.
Dès qu'il se dit il se contredit.
La solution platonicienne
La seconde réponse est celle de Platon qui n'accepte pas le relativisme de Protagoras, qu'il dénonce, dans le Théétète, comme autocontradictoire : il est impossible d'affirmer : « A chacun sa
vérité », puisqu'on l'affirmerait...
comme une vérité.
C'est pourquoi Platon distingue nettement la science véritable (épistèmè), recherchée par le philosophe, de l'opinion (doxa), toujours
changeante et variable, et qui, même quand elle tombe juste, est incapable de rendre raison d'elle-même.
Si le monde sensible, c'est-à-dire le monde des phénomènes, est bien celui du devenir et de la diversité, il faut alors affirmer qu'existe « derrière » les apparences ou, pour mieux dire, « audelà », un monde d'essences, fait de 'réalités « en soi », immuables et toujours identiques à elles-mêmes.
Ainsi les choses belles, par exemple, renvoient-elles à la beauté en soi, sans
laquelle elles ne pourraient être qualifiées de belles.
Ces réalités essentielles n'apparaissent pas aux sens, mais à l'intelligence seule : elles sont intelligibles.
Platon les appelle des « Idées », du terme grec eidos, mais ce ne sont pas des «
idées » au sens moderne de « représentation mentale ».
Les Idées platoniciennes sont au contraire la réalité même, en regard desquelles les choses sensibles ne sont que des copies pâles et
imparfaites.
Platon réunit en somme les deux sens du mot « apparence » : ce qui apparaît à nos sens (le phénomène) est un faux semblant, une illusion — c'est en tout cas une illusion de le
prendre pour la réalité véritable car celle-ci est intelligible.
Si ce monde intelligible, extérieur et supérieur au monde sensible — c'est-à-dire transcendant —, n'existait pas, la science serait
impossible et le relativisme ou le scepticisme seraient effectivement les seules solutions possibles au problème de la connaissance.
Le mot idée s'emploie, dans la langue philosophique, avec un « I » majuscule ou avec un « i » minuscule.
Avec un « I » majuscule, il renvoie à la célèbre théorie platonicienne des Idées.
Pour
Platon, les Idées sont les archétypes, autrement dit les modèles éternels de toutes les choses concrètes qui ne sont que leurs images fugitives.
Dans le Timée, il est question du démiurge qui
ne crée pas le monde, mais qui le fabrique à partir de la matière informe et des Idées éternelles qu'il contemple.
Dans le Ménon, Platon met en scène Socrate faisant découvrir la géométrie à
un jeune esclave.
L'esclave, aidé par Socrate, retrouve très vite les propriétés des figures géométriques sans jamais les avoir apprises auparavant.
Les idées mathématiques « surgissent
chez lui comme en un songe ».
Si l'esclave retrouve tout « sans aucun maître, par de simples interrogations », c'est, dit Socrate, qu'il n'apprend pas, à proprement parler, des choses
nouvelles, mais qu'il reprend clairement possession de connaissances qu'il avait déjà.
Mais puisque cet esclave n'a reçu aucune instruction, comment expliquer cette merveille ?
B.
Apprendre, c'est se ressouvenir
Platon l'explique, selon son habitude, par un « mythe », par une sorte de légende qui n'est pas présentée comme vraie à la lettre, mais qui est une façon imagée de nous faire entendre une vérité philosophique profonde.
Avant de
naître, cet esclave, ou plutôt son âme, vivait, comme toutes les âmes, parmi les pures Idées, au ciel des vérités éternelles.
Puis l'âme est tombée dans un corps, mais elle conserve sur cette terre un vague souvenir des Idées
qu'elle contemplait avant son incarnation (réminiscence).
Ainsi l'esclave ne retrouve si vite les théorèmes que parce qu'il se souvient de les avoir connus avant sa naissance.
Les vérités ne sont pas réellement trouvées dans
l'expérience concrète.
Mais elles sont intérieures à notre esprit, comme un souvenir un peu effacé mais toujours présent et que nous sommes capables d'évoquer par un léger effort.
Dans le Ménon, Socrate interroge un jeune esclave.
Il lui demande comment construire un carré dont l'aire soit le double d'un premier carré.
Le jeune esclave commence par doubler le côté du carré, mais ceci conduit à quadrupler
l'aire du carré.
Aidé par les questions de Socrate, qui ne lui donne à aucun moment la solution, il découvre que le carré double d'un autre est celui que l'on construit sur la diagonale.
L'esclave retrouve donc, du moins en partie, le
théorème de Pythagore, qu'il n'a jamais appris.
Comment cela est il possible ? L'hypothèse platonicienne est que l'esClave possédait déjà cette connaissance.
Autrement ; dit, selon Platon, c'est comme si l'esclave se souvenait
de cette réalité mathématique.
« Nous devons avoir bon courage », dit Socrate, « et » nous efforcer de rechercher et de retrouver la mémoire de ce dont nous avons perdu le souvenir ».
La connaissance est une réminiscence.
C'est pourquoi Socrate se définit comme le digne fils de sa mère, qui était sage-femme, et déclare être un accoucheur d'âme.
Il ne fait, dans les dialogues, que faire dire à son interlocuteur ce que ce dernier connaissait déjà : il
l'aide à mettre sa connaissance au monde mais il ne lui apporte pas cette connaissance.
Cette théorie explique ainsi que les degrés de la connaissance puissent être variables.
Chez certains le souvenir est presque effacé, chez
d'autres, comme les philosophes, il a été ravivé.
Platon donne un nom à ces différents degrés.
Chez l'esclave, cette connaissance, qui n'est pas une connaissance scientifique parce qu'il n'a pas pratiqué les mathématiques, est ce que Platon appelle une opinion droite, par
opposition à ['opinion fausse, qui caractérisait le savoir de l'esclave avant les questions de Socrate, et au véritable savoir, épistèmè, que ne possède que le mathématicien, conscient des tenants et aboutissants de sa propre
connaissance.
Ainsi, explique Socrate, des hommes politiques célèbres comme Périclès ont-ils bien dirigé la cité.
Ils ne possédaient pourtant aucune science, épistèmè, de la politique, mais une opinion droite.
Dans ce domaine, la
politique, qui relève de l'action, ce type de savoir peut suffire.
Mais parce que leur connaissance n'était que d'opinion, ces hommes politiques n'ont pu enseigner leur savoir à leurs enfants.
Leurs souvenirs n'étaient pas
suffisamment éclaircis par la pratique de la philosophie.
Mais de quoi nous souvenons-nous et pourquoi ? C'est par un mythe que Platon répond à cette interrogation, dans le Phèdre.
L'âme est immortelle.
Avant de s'incarner dans les corps, elle a suivi les dieux dans les cieux et elle a eu
la vision des idées : l'essence de la justice, de la tempérance, etc.
Ce sont des réalités « sans couleur ni forme » d'où toutes les choses tirent leur existence.
Certaines âmes voient mieux que d'autres ces réalités ultimes, car le
char qu'elles conduisent est plus ou moins facile à conduire sur la route qu'elles suivent, selon que les passions, comme la colère, le désir ou l'ambition, sont plus ou moins bien domestiquées.
Les âmes, une fois ce voyage céleste
accompli, s'incarnent, et le souvenir de cette vision s'estompe.
Si elles sont bien cultivées par la philosophie, elles pourront se remémorer ce qu'elles ont vu.
Mais, une fois incarnées, quel chemin doivent-elles suivre sur la route
de la philosophie ?
Ce mythe de la réminiscence est tout simplement un symbole de ce qu'on appelle la théorie innéiste ; il signifie que les Idées sont innées dans notre esprit, qu'elles sont indépendantes de l'expérience concrète, puisque loin d'être
issues de choses concrètes, sensibles, ce sont les Idées éternelles qui ont servi de modèle aux choses concrètes.
Les vérités sont antérieures à notre expérience terrestre, intérieures à notre esprit.
Tel est le sens de l'idéalisme
platonicien qui est en même temps un dualisme, puisqu'il y a deux mondes, celui des Idées éternelles auquel notre esprit participe, et celui — inférieur et dérivé — des images, c'est-à-dire des choses concrètes et sensibles,
mouvantes et éphémères..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentez et discutez ce texte de Claude Bernard : « Nos idées ne sont que des instruments intellectuels qui nous servent à pénétrer les phénomènes. Il faut les changer quand elles ont rempli leur rôle comme on change de bistouri quand il a servi trop lo
- Nos idées ne sont que des instruments intellectuels qui nous servent à pénétrer les phénomènes (Claude Bernard)
- Physique: Que sont les phénomènes de diffraction et d’interférences ?
- Les idées démocratiques de Tocqueville
- Lecture linéaire Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil : La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle