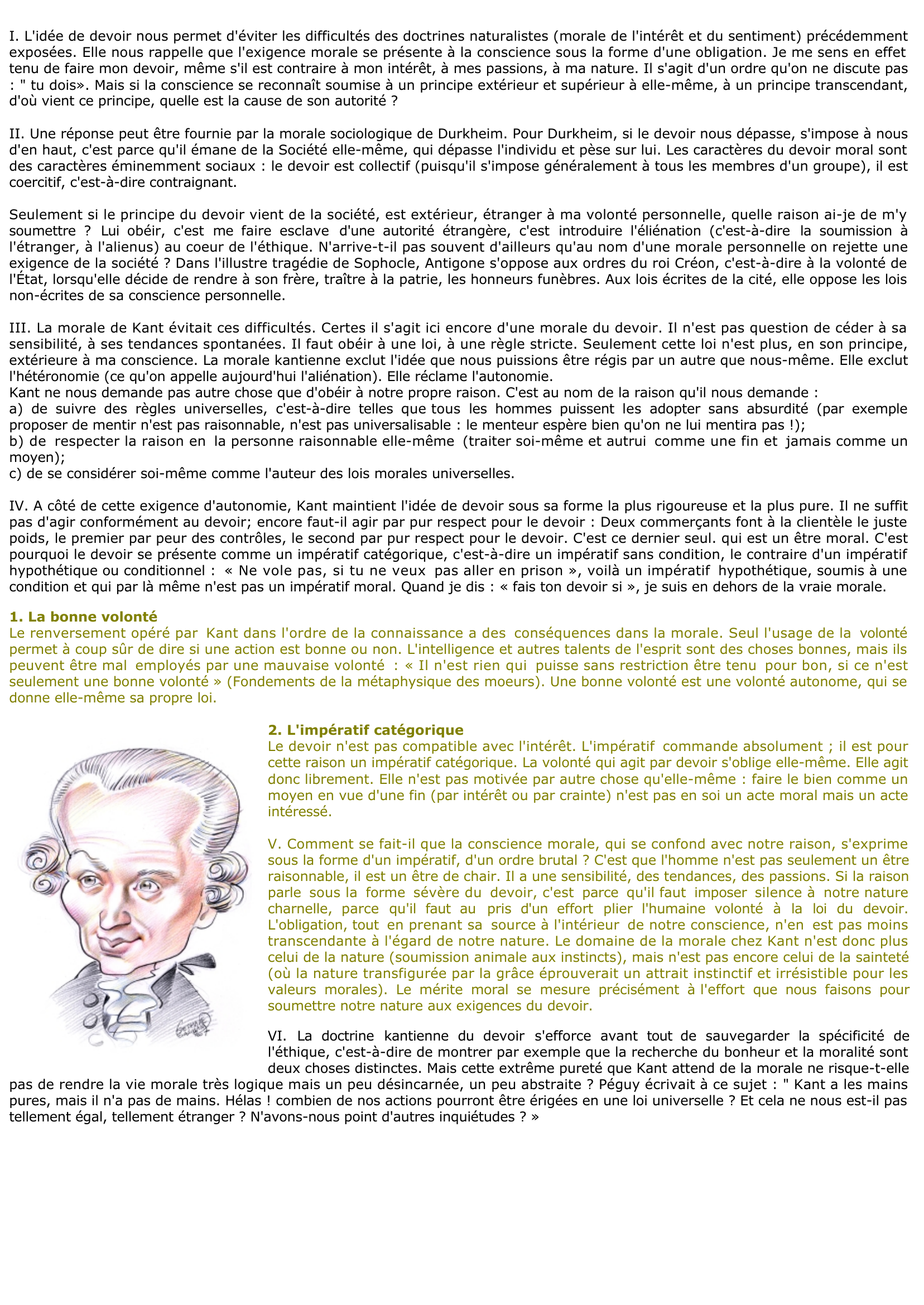Les morales du devoir
Extrait du document
«
I.
L'idée de devoir nous permet d'éviter les difficultés des doctrines naturalistes (morale de l'intérêt et du sentiment) précédemment
exposées.
Elle nous rappelle que l'exigence morale se présente à la conscience sous la forme d'une obligation.
Je me sens en effet
tenu de faire mon devoir, même s'il est contraire à mon intérêt, à mes passions, à ma nature.
Il s'agit d'un ordre qu'on ne discute pas
: " tu dois».
Mais si la conscience se reconnaît soumise à un principe extérieur et supérieur à elle-même, à un principe transcendant,
d'où vient ce principe, quelle est la cause de son autorité ?
II.
Une réponse peut être fournie par la morale sociologique de Durkheim.
Pour Durkheim, si le devoir nous dépasse, s'impose à nous
d'en haut, c'est parce qu'il émane de la Société elle-même, qui dépasse l'individu et pèse sur lui.
Les caractères du devoir moral sont
des caractères éminemment sociaux : le devoir est collectif (puisqu'il s'impose généralement à tous les membres d'un groupe), il est
coercitif, c'est-à-dire contraignant.
Seulement si le principe du devoir vient de la société, est extérieur, étranger à ma volonté personnelle, quelle raison ai-je de m'y
soumettre ? Lui obéir, c'est me faire esclave d'une autorité étrangère, c'est introduire l'éliénation (c'est-à-dire la soumission à
l'étranger, à l'alienus) au coeur de l'éthique.
N'arrive-t-il pas souvent d'ailleurs qu'au nom d'une morale personnelle on rejette une
exigence de la société ? Dans l'illustre tragédie de Sophocle, Antigone s'oppose aux ordres du roi Créon, c'est-à-dire à la volonté de
l'État, lorsqu'elle décide de rendre à son frère, traître à la patrie, les honneurs funèbres.
Aux lois écrites de la cité, elle oppose les lois
non-écrites de sa conscience personnelle.
III.
La morale de Kant évitait ces difficultés.
Certes il s'agit ici encore d'une morale du devoir.
Il n'est pas question de céder à sa
sensibilité, à ses tendances spontanées.
Il faut obéir à une loi, à une règle stricte.
Seulement cette loi n'est plus, en son principe,
extérieure à ma conscience.
La morale kantienne exclut l'idée que nous puissions être régis par un autre que nous-même.
Elle exclut
l'hétéronomie (ce qu'on appelle aujourd'hui l'aliénation).
Elle réclame l'autonomie.
Kant ne nous demande pas autre chose que d'obéir à notre propre raison.
C'est au nom de la raison qu'il nous demande :
a) de suivre des règles universelles, c'est-à-dire telles que tous les hommes puissent les adopter sans absurdité (par exemple
proposer de mentir n'est pas raisonnable, n'est pas universalisable : le menteur espère bien qu'on ne lui mentira pas !);
b) de respecter la raison en la personne raisonnable elle-même (traiter soi-même et autrui comme une fin et jamais comme un
moyen);
c) de se considérer soi-même comme l'auteur des lois morales universelles.
IV.
A côté de cette exigence d'autonomie, Kant maintient l'idée de devoir sous sa forme la plus rigoureuse et la plus pure.
Il ne suffit
pas d'agir conformément au devoir; encore faut-il agir par pur respect pour le devoir : Deux commerçants font à la clientèle le juste
poids, le premier par peur des contrôles, le second par pur respect pour le devoir.
C'est ce dernier seul.
qui est un être moral.
C'est
pourquoi le devoir se présente comme un impératif catégorique, c'est-à-dire un impératif sans condition, le contraire d'un impératif
hypothétique ou conditionnel : « Ne vole pas, si tu ne veux pas aller en prison », voilà un impératif hypothétique, soumis à une
condition et qui par là même n'est pas un impératif moral.
Quand je dis : « fais ton devoir si », je suis en dehors de la vraie morale.
1.
La bonne volonté
Le renversement opéré par Kant dans l'ordre de la connaissance a des conséquences dans la morale.
Seul l'usage de la volonté
permet à coup sûr de dire si une action est bonne ou non.
L'intelligence et autres talents de l'esprit sont des choses bonnes, mais ils
peuvent être mal employés par une mauvaise volonté : « Il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est
seulement une bonne volonté » (Fondements de la métaphysique des moeurs).
Une bonne volonté est une volonté autonome, qui se
donne elle-même sa propre loi.
2.
L'impératif catégorique
Le devoir n'est pas compatible avec l'intérêt.
L'impératif commande absolument ; il est pour
cette raison un impératif catégorique.
La volonté qui agit par devoir s'oblige elle-même.
Elle agit
donc librement.
Elle n'est pas motivée par autre chose qu'elle-même : faire le bien comme un
moyen en vue d'une fin (par intérêt ou par crainte) n'est pas en soi un acte moral mais un acte
intéressé.
V.
Comment se fait-il que la conscience morale, qui se confond avec notre raison, s'exprime
sous la forme d'un impératif, d'un ordre brutal ? C'est que l'homme n'est pas seulement un être
raisonnable, il est un être de chair.
Il a une sensibilité, des tendances, des passions.
Si la raison
parle sous la forme sévère du devoir, c'est parce qu'il faut imposer silence à notre nature
charnelle, parce qu'il faut au pris d'un effort plier l'humaine volonté à la loi du devoir.
L'obligation, tout en prenant sa source à l'intérieur de notre conscience, n'en est pas moins
transcendante à l'égard de notre nature.
Le domaine de la morale chez Kant n'est donc plus
celui de la nature (soumission animale aux instincts), mais n'est pas encore celui de la sainteté
(où la nature transfigurée par la grâce éprouverait un attrait instinctif et irrésistible pour les
valeurs morales).
Le mérite moral se mesure précisément à l'effort que nous faisons pour
soumettre notre nature aux exigences du devoir.
VI.
La doctrine kantienne du devoir s'efforce avant tout de sauvegarder la spécificité de
l'éthique, c'est-à-dire de montrer par exemple que la recherche du bonheur et la moralité sont
deux choses distinctes.
Mais cette extrême pureté que Kant attend de la morale ne risque-t-elle
pas de rendre la vie morale très logique mais un peu désincarnée, un peu abstraite ? Péguy écrivait à ce sujet : " Kant a les mains
pures, mais il n'a pas de mains.
Hélas ! combien de nos actions pourront être érigées en une loi universelle ? Et cela ne nous est-il pas
tellement égal, tellement étranger ? N'avons-nous point d'autres inquiétudes ? ».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le devoir (cours de philo)
- Devoir sur l'étranger de Camus
- devoir sur l'Esthétique
- est ce un devoir de s'aimer
- devoir philo Pascal: Ne sommes-nous qu’un ensemble de qualités ?