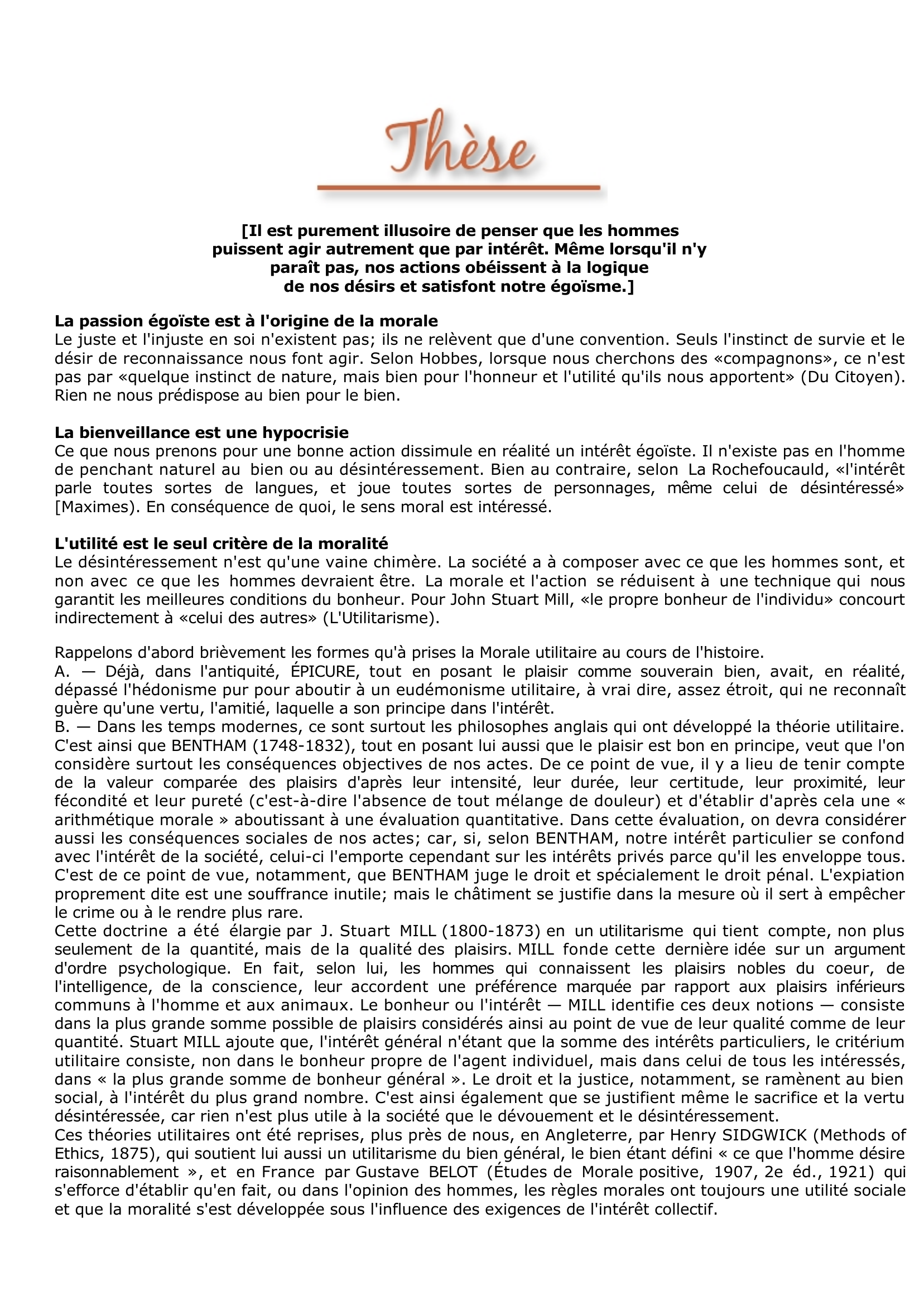Les hommes n'agissent-ils que par intérêts ?
Extrait du document
«
[Il est purement illusoire de penser que les hommes
puissent agir autrement que par intérêt.
Même lorsqu'il n'y
paraît pas, nos actions obéissent à la logique
de nos désirs et satisfont notre égoïsme.]
La passion égoïste est à l'origine de la morale
Le juste et l'injuste en soi n'existent pas; ils ne relèvent que d'une convention.
Seuls l'instinct de survie et le
désir de reconnaissance nous font agir.
Selon Hobbes, lorsque nous cherchons des «compagnons», ce n'est
pas par «quelque instinct de nature, mais bien pour l'honneur et l'utilité qu'ils nous apportent» (Du Citoyen).
Rien ne nous prédispose au bien pour le bien.
La bienveillance est une hypocrisie
Ce que nous prenons pour une bonne action dissimule en réalité un intérêt égoïste.
Il n'existe pas en l'homme
de penchant naturel au bien ou au désintéressement.
Bien au contraire, selon La Rochefoucauld, «l'intérêt
parle toutes sortes de langues, et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé»
[Maximes).
En conséquence de quoi, le sens moral est intéressé.
L'utilité est le seul critère de la moralité
Le désintéressement n'est qu'une vaine chimère.
La société a à composer avec ce que les hommes sont, et
non avec ce que les hommes devraient être.
La morale et l'action se réduisent à une technique qui nous
garantit les meilleures conditions du bonheur.
Pour John Stuart Mill, «le propre bonheur de l'individu» concourt
indirectement à «celui des autres» (L'Utilitarisme).
Rappelons d'abord brièvement les formes qu'à prises la Morale utilitaire au cours de l'histoire.
A.
— Déjà, dans l'antiquité, ÉPICURE, tout en posant le plaisir comme souverain bien, avait, en réalité,
dépassé l'hédonisme pur pour aboutir à un eudémonisme utilitaire, à vrai dire, assez étroit, qui ne reconnaît
guère qu'une vertu, l'amitié, laquelle a son principe dans l'intérêt.
B.
— Dans les temps modernes, ce sont surtout les philosophes anglais qui ont développé la théorie utilitaire.
C'est ainsi que BENTHAM (1748-1832), tout en posant lui aussi que le plaisir est bon en principe, veut que l'on
considère surtout les conséquences objectives de nos actes.
De ce point de vue, il y a lieu de tenir compte
de la valeur comparée des plaisirs d'après leur intensité, leur durée, leur certitude, leur proximité, leur
fécondité et leur pureté (c'est-à-dire l'absence de tout mélange de douleur) et d'établir d'après cela une «
arithmétique morale » aboutissant à une évaluation quantitative.
Dans cette évaluation, on devra considérer
aussi les conséquences sociales de nos actes; car, si, selon BENTHAM, notre intérêt particulier se confond
avec l'intérêt de la société, celui-ci l'emporte cependant sur les intérêts privés parce qu'il les enveloppe tous.
C'est de ce point de vue, notamment, que BENTHAM juge le droit et spécialement le droit pénal.
L'expiation
proprement dite est une souffrance inutile; mais le châtiment se justifie dans la mesure où il sert à empêcher
le crime ou à le rendre plus rare.
Cette doctrine a été élargie par J.
Stuart MILL (1800-1873) en un utilitarisme qui tient compte, non plus
seulement de la quantité, mais de la qualité des plaisirs.
MILL fonde cette dernière idée sur un argument
d'ordre psychologique.
En fait, selon lui, les hommes qui connaissent les plaisirs nobles du coeur, de
l'intelligence, de la conscience, leur accordent une préférence marquée par rapport aux plaisirs inférieurs
communs à l'homme et aux animaux.
Le bonheur ou l'intérêt — MILL identifie ces deux notions — consiste
dans la plus grande somme possible de plaisirs considérés ainsi au point de vue de leur qualité comme de leur
quantité.
Stuart MILL ajoute que, l'intérêt général n'étant que la somme des intérêts particuliers, le critérium
utilitaire consiste, non dans le bonheur propre de l'agent individuel, mais dans celui de tous les intéressés,
dans « la plus grande somme de bonheur général ».
Le droit et la justice, notamment, se ramènent au bien
social, à l'intérêt du plus grand nombre.
C'est ainsi également que se justifient même le sacrifice et la vertu
désintéressée, car rien n'est plus utile à la société que le dévouement et le désintéressement.
Ces théories utilitaires ont été reprises, plus près de nous, en Angleterre, par Henry SIDGWICK (Methods of
Ethics, 1875), qui soutient lui aussi un utilitarisme du bien général, le bien étant défini « ce que l'homme désire
raisonnablement », et en France par Gustave BELOT (Études de Morale positive, 1907, 2e éd., 1921) qui
s'efforce d'établir qu'en fait, ou dans l'opinion des hommes, les règles morales ont toujours une utilité sociale
et que la moralité s'est développée sous l'influence des exigences de l'intérêt collectif..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les hommes n'agissent-ils que par intérêt ?
- Les rapports entre les hommes sont-ils déterminés par leurs intérêts?
- L'espoir fait-il vivre les hommes ?
- EC2 : Caractérisez la mobilité sociale des hommes par rapport à leur père.
- Tant que les hommes massacreront les bêtes, ils s'entre-tueront (Pythagore)