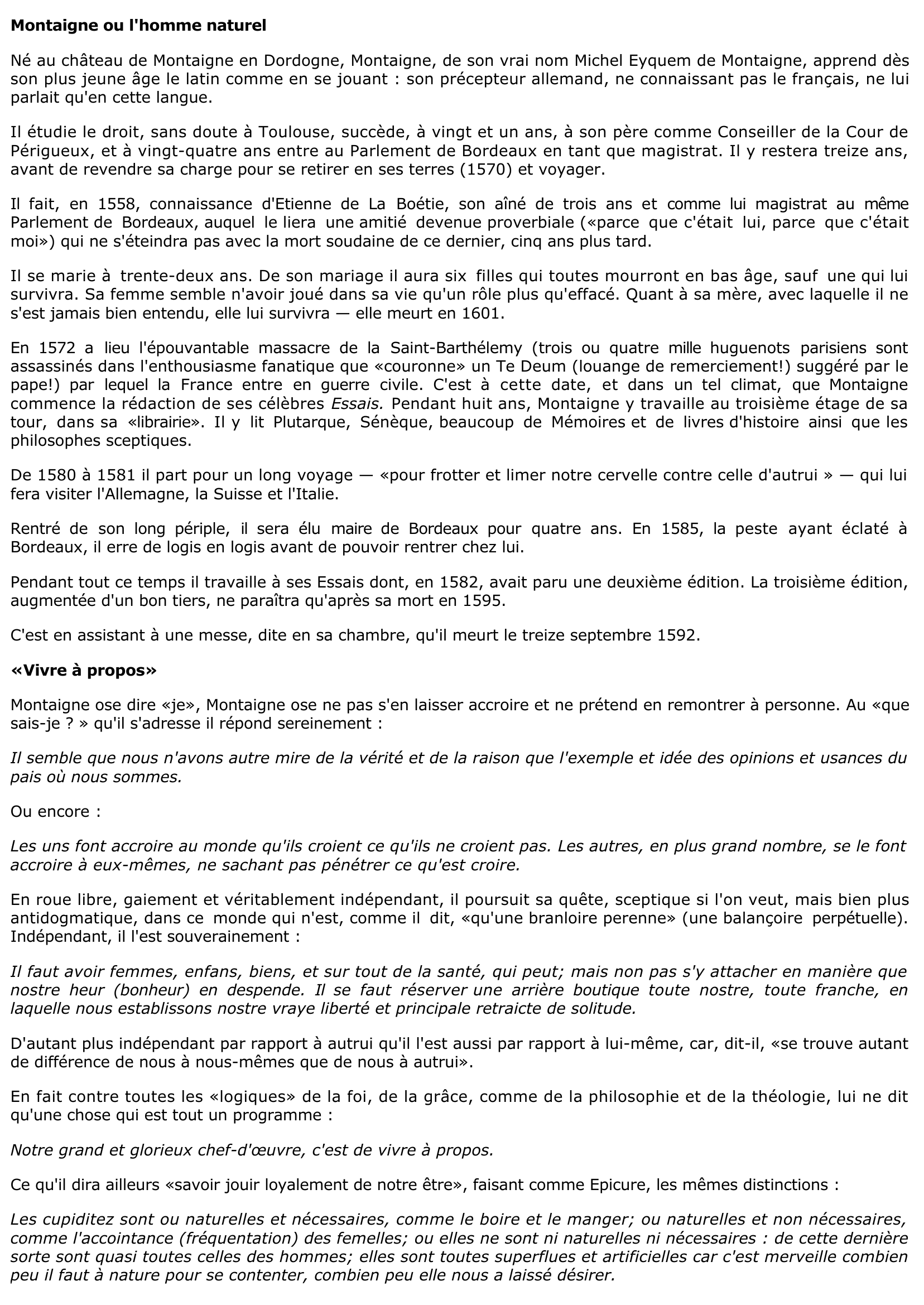Le «Vivre à propos» de Montaigne.
Extrait du document
«
Montaigne ou l'homme naturel
Né au château de Montaigne en Dordogne, Montaigne, de son vrai nom Michel Eyquem de Montaigne, apprend dès
son plus jeune âge le latin comme en se jouant : son précepteur allemand, ne connaissant pas le français, ne lui
parlait qu'en cette langue.
Il étudie le droit, sans doute à Toulouse, succède, à vingt et un ans, à son père comme Conseiller de la Cour de
Périgueux, et à vingt-quatre ans entre au Parlement de Bordeaux en tant que magistrat.
Il y restera treize ans,
avant de revendre sa charge pour se retirer en ses terres (1570) et voyager.
Il fait, en 1558, connaissance d'Etienne de La Boétie, son aîné de trois ans et comme lui magistrat au même
Parlement de Bordeaux, auquel le liera une amitié devenue proverbiale («parce que c'était lui, parce que c'était
moi») qui ne s'éteindra pas avec la mort soudaine de ce dernier, cinq ans plus tard.
Il se marie à trente-deux ans.
De son mariage il aura six filles qui toutes mourront en bas âge, sauf une qui lui
survivra.
Sa femme semble n'avoir joué dans sa vie qu'un rôle plus qu'effacé.
Quant à sa mère, avec laquelle il ne
s'est jamais bien entendu, elle lui survivra — elle meurt en 1601.
En 1572 a lieu l'épouvantable massacre de la Saint-Barthélemy (trois ou quatre mille huguenots parisiens sont
assassinés dans l'enthousiasme fanatique que «couronne» un Te Deum (louange de remerciement!) suggéré par le
pape!) par lequel la France entre en guerre civile.
C'est à cette date, et dans un tel climat, que Montaigne
commence la rédaction de ses célèbres Essais.
Pendant huit ans, Montaigne y travaille au troisième étage de sa
tour, dans sa «librairie».
Il y lit Plutarque, Sénèque, beaucoup de Mémoires et de livres d'histoire ainsi que les
philosophes sceptiques.
De 1580 à 1581 il part pour un long voyage — «pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui » — qui lui
fera visiter l'Allemagne, la Suisse et l'Italie.
Rentré de son long périple, il sera élu maire de Bordeaux pour quatre ans.
En 1585, la peste ayant éclaté à
Bordeaux, il erre de logis en logis avant de pouvoir rentrer chez lui.
Pendant tout ce temps il travaille à ses Essais dont, en 1582, avait paru une deuxième édition.
La troisième édition,
augmentée d'un bon tiers, ne paraîtra qu'après sa mort en 1595.
C'est en assistant à une messe, dite en sa chambre, qu'il meurt le treize septembre 1592.
«Vivre à propos»
Montaigne ose dire «je», Montaigne ose ne pas s'en laisser accroire et ne prétend en remontrer à personne.
Au «que
sais-je ? » qu'il s'adresse il répond sereinement :
Il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du
pais où nous sommes.
Ou encore :
Les uns font accroire au monde qu'ils croient ce qu'ils ne croient pas.
Les autres, en plus grand nombre, se le font
accroire à eux-mêmes, ne sachant pas pénétrer ce qu'est croire.
En roue libre, gaiement et véritablement indépendant, il poursuit sa quête, sceptique si l'on veut, mais bien plus
antidogmatique, dans ce monde qui n'est, comme il dit, «qu'une branloire perenne» (une balançoire perpétuelle).
Indépendant, il l'est souverainement :
Il faut avoir femmes, enfans, biens, et sur tout de la santé, qui peut; mais non pas s'y attacher en manière que
nostre heur (bonheur) en despende.
Il se faut réserver une arrière boutique toute nostre, toute franche, en
laquelle nous establissons nostre vraye liberté et principale retraicte de solitude.
D'autant plus indépendant par rapport à autrui qu'il l'est aussi par rapport à lui-même, car, dit-il, «se trouve autant
de différence de nous à nous-mêmes que de nous à autrui».
En fait contre toutes les «logiques» de la foi, de la grâce, comme de la philosophie et de la théologie, lui ne dit
qu'une chose qui est tout un programme :
Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos.
Ce qu'il dira ailleurs «savoir jouir loyalement de notre être», faisant comme Epicure, les mêmes distinctions :
Les cupiditez sont ou naturelles et nécessaires, comme le boire et le manger; ou naturelles et non nécessaires,
comme l'accointance (fréquentation) des femelles; ou elles ne sont ni naturelles ni nécessaires : de cette dernière
sorte sont quasi toutes celles des hommes; elles sont toutes superflues et artificielles car c'est merveille combien
peu il faut à nature pour se contenter, combien peu elle nous a laissé désirer..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'espoir fait-il vivre les hommes ?
- Tout ce qui peut être fait un autre jour le peut être aujourd'hui. Montaigne
- « Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours» Gandhi
- Lecture analytique sur Victor Hugo, Les Contemplations, A propos d’Horace Poème Vers 173 à 201
- Montaigne - Commentaires sur l'institution des enfants