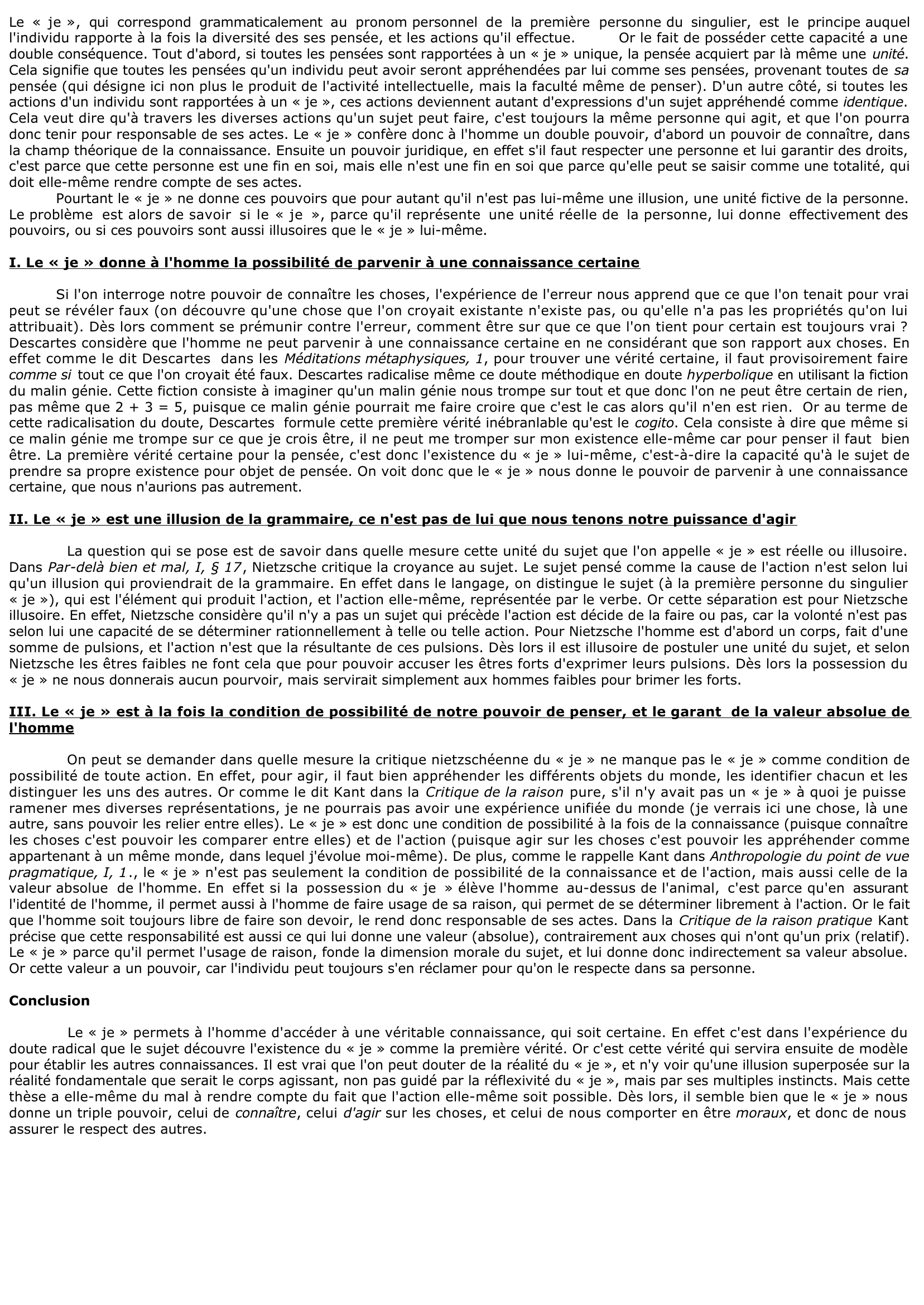Le fait de posséder le "je" nous confère-t-il un certain pouvoir ?
Extrait du document
«
Le « je », qui correspond grammaticalement au pronom personnel de la première personne du singulier, est le principe auquel
l'individu rapporte à la fois la diversité des ses pensée, et les actions qu'il effectue.
Or le fait de posséder cette capacité a une
double conséquence.
Tout d'abord, si toutes les pensées sont rapportées à un « je » unique, la pensée acquiert par là même une unité.
Cela signifie que toutes les pensées qu'un individu peut avoir seront appréhendées par lui comme ses pensées, provenant toutes de sa
pensée (qui désigne ici non plus le produit de l'activité intellectuelle, mais la faculté même de penser).
D'un autre côté, si toutes les
actions d'un individu sont rapportées à un « je », ces actions deviennent autant d'expressions d'un sujet appréhendé comme identique.
Cela veut dire qu'à travers les diverses actions qu'un sujet peut faire, c'est toujours la même personne qui agit, et que l'on pourra
donc tenir pour responsable de ses actes.
Le « je » confère donc à l'homme un double pouvoir, d'abord un pouvoir de connaître, dans
la champ théorique de la connaissance.
Ensuite un pouvoir juridique, en effet s'il faut respecter une personne et lui garantir des droits,
c'est parce que cette personne est une fin en soi, mais elle n'est une fin en soi que parce qu'elle peut se saisir comme une totalité, qui
doit elle-même rendre compte de ses actes.
Pourtant le « je » ne donne ces pouvoirs que pour autant qu'il n'est pas lui-même une illusion, une unité fictive de la personne.
Le problème est alors de savoir si le « je », parce qu'il représente une unité réelle de la personne, lui donne effectivement des
pouvoirs, ou si ces pouvoirs sont aussi illusoires que le « je » lui-même.
I.
Le « je » donne à l'homme la possibilité de parvenir à une connaissance certaine
Si l'on interroge notre pouvoir de connaître les choses, l'expérience de l'erreur nous apprend que ce que l'on tenait pour vrai
peut se révéler faux (on découvre qu'une chose que l'on croyait existante n'existe pas, ou qu'elle n'a pas les propriétés qu'on lui
attribuait).
Dès lors comment se prémunir contre l'erreur, comment être sur que ce que l'on tient pour certain est toujours vrai ?
Descartes considère que l'homme ne peut parvenir à une connaissance certaine en ne considérant que son rapport aux choses.
En
effet comme le dit Descartes dans les Méditations métaphysiques, 1, pour trouver une vérité certaine, il faut provisoirement faire
comme si tout ce que l'on croyait été faux.
Descartes radicalise même ce doute méthodique en doute hyperbolique en utilisant la fiction
du malin génie.
Cette fiction consiste à imaginer qu'un malin génie nous trompe sur tout et que donc l'on ne peut être certain de rien,
pas même que 2 + 3 = 5, puisque ce malin génie pourrait me faire croire que c'est le cas alors qu'il n'en est rien.
Or au terme de
cette radicalisation du doute, Descartes formule cette première vérité inébranlable qu'est le cogito.
Cela consiste à dire que même si
ce malin génie me trompe sur ce que je crois être, il ne peut me tromper sur mon existence elle-même car pour penser il faut bien
être.
La première vérité certaine pour la pensée, c'est donc l'existence du « je » lui-même, c'est-à-dire la capacité qu'à le sujet de
prendre sa propre existence pour objet de pensée.
On voit donc que le « je » nous donne le pouvoir de parvenir à une connaissance
certaine, que nous n'aurions pas autrement.
II.
Le « je » est une illusion de la grammaire, ce n'est pas de lui que nous tenons notre puissance d'agir
La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure cette unité du sujet que l'on appelle « je » est réelle ou illusoire.
Dans Par-delà bien et mal, I, § 17, Nietzsche critique la croyance au sujet.
Le sujet pensé comme la cause de l'action n'est selon lui
qu'un illusion qui proviendrait de la grammaire.
En effet dans le langage, on distingue le sujet (à la première personne du singulier
« je »), qui est l'élément qui produit l'action, et l'action elle-même, représentée par le verbe.
Or cette séparation est pour Nietzsche
illusoire.
En effet, Nietzsche considère qu'il n'y a pas un sujet qui précède l'action est décide de la faire ou pas, car la volonté n'est pas
selon lui une capacité de se déterminer rationnellement à telle ou telle action.
Pour Nietzsche l'homme est d'abord un corps, fait d'une
somme de pulsions, et l'action n'est que la résultante de ces pulsions.
Dès lors il est illusoire de postuler une unité du sujet, et selon
Nietzsche les êtres faibles ne font cela que pour pouvoir accuser les êtres forts d'exprimer leurs pulsions.
Dès lors la possession du
« je » ne nous donnerais aucun pourvoir, mais servirait simplement aux hommes faibles pour brimer les forts.
III.
Le « je » est à la fois la condition de possibilité de notre pouvoir de penser, et le garant de la valeur absolue de
l'homme
On peut se demander dans quelle mesure la critique nietzschéenne du « je » ne manque pas le « je » comme condition de
possibilité de toute action.
En effet, pour agir, il faut bien appréhender les différents objets du monde, les identifier chacun et les
distinguer les uns des autres.
Or comme le dit Kant dans la Critique de la raison pure, s'il n'y avait pas un « je » à quoi je puisse
ramener mes diverses représentations, je ne pourrais pas avoir une expérience unifiée du monde (je verrais ici une chose, là une
autre, sans pouvoir les relier entre elles).
Le « je » est donc une condition de possibilité à la fois de la connaissance (puisque connaître
les choses c'est pouvoir les comparer entre elles) et de l'action (puisque agir sur les choses c'est pouvoir les appréhender comme
appartenant à un même monde, dans lequel j'évolue moi-même).
De plus, comme le rappelle Kant dans Anthropologie du point de vue
pragmatique, I, 1., le « je » n'est pas seulement la condition de possibilité de la connaissance et de l'action, mais aussi celle de la
valeur absolue de l'homme.
En effet si la possession du « je » élève l'homme au-dessus de l'animal, c'est parce qu'en assurant
l'identité de l'homme, il permet aussi à l'homme de faire usage de sa raison, qui permet de se déterminer librement à l'action.
Or le fait
que l'homme soit toujours libre de faire son devoir, le rend donc responsable de ses actes.
Dans la Critique de la raison pratique Kant
précise que cette responsabilité est aussi ce qui lui donne une valeur (absolue), contrairement aux choses qui n'ont qu'un prix (relatif).
Le « je » parce qu'il permet l'usage de raison, fonde la dimension morale du sujet, et lui donne donc indirectement sa valeur absolue.
Or cette valeur a un pouvoir, car l'individu peut toujours s'en réclamer pour qu'on le respecte dans sa personne.
Conclusion
Le « je » permets à l'homme d'accéder à une véritable connaissance, qui soit certaine.
En effet c'est dans l'expérience du
doute radical que le sujet découvre l'existence du « je » comme la première vérité.
Or c'est cette vérité qui servira ensuite de modèle
pour établir les autres connaissances.
Il est vrai que l'on peut douter de la réalité du « je », et n'y voir qu'une illusion superposée sur la
réalité fondamentale que serait le corps agissant, non pas guidé par la réflexivité du « je », mais par ses multiples instincts.
Mais cette
thèse a elle-même du mal à rendre compte du fait que l'action elle-même soit possible.
Dès lors, il semble bien que le « je » nous
donne un triple pouvoir, celui de connaître, celui d'agir sur les choses, et celui de nous comporter en être moraux, et donc de nous
assurer le respect des autres..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Quel savoir doit posséder l'homme au pouvoir ?
- Dissertation: Toute politique n'est-elle qu'une lutte pour le pouvoir ?
- Le pouvoir produit du savoir; pouvoir et savoir s'impliquent directement l'un l'autre. Michel Foucault
- dissertation faut-il regretter de ne pas pouvoir revenir en arrière
- La démocratie représentative prive t-elle le peuple du pouvoir ?