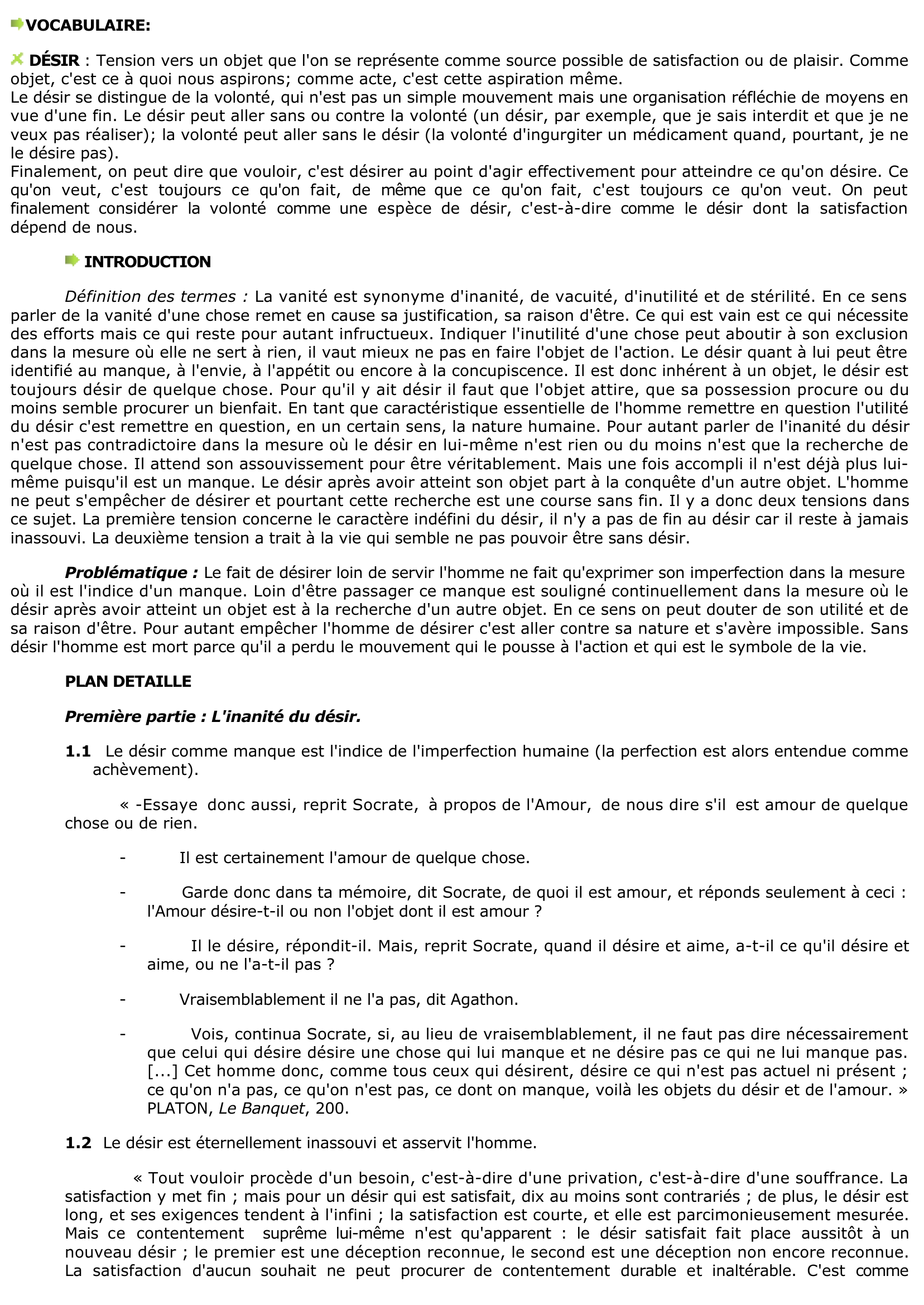Est-il vain de désirer ?
Extrait du document
«
VOCABULAIRE:
DÉSIR : Tension vers un objet que l'on se représente comme source possible de satisfaction ou de plaisir.
Comme
objet, c'est ce à quoi nous aspirons; comme acte, c'est cette aspiration même.
Le désir se distingue de la volonté, qui n'est pas un simple mouvement mais une organisation réfléchie de moyens en
vue d'une fin.
Le désir peut aller sans ou contre la volonté (un désir, par exemple, que je sais interdit et que je ne
veux pas réaliser); la volonté peut aller sans le désir (la volonté d'ingurgiter un médicament quand, pourtant, je ne
le désire pas).
Finalement, on peut dire que vouloir, c'est désirer au point d'agir effectivement pour atteindre ce qu'on désire.
Ce
qu'on veut, c'est toujours ce qu'on fait, de même que ce qu'on fait, c'est toujours ce qu'on veut.
On peut
finalement considérer la volonté comme une espèce de désir, c'est-à-dire comme le désir dont la satisfaction
dépend de nous.
INTRODUCTION
Définition des termes : La vanité est synonyme d'inanité, de vacuité, d'inutilité et de stérilité.
En ce sens
parler de la vanité d'une chose remet en cause sa justification, sa raison d'être.
Ce qui est vain est ce qui nécessite
des efforts mais ce qui reste pour autant infructueux.
Indiquer l'inutilité d'une chose peut aboutir à son exclusion
dans la mesure où elle ne sert à rien, il vaut mieux ne pas en faire l'objet de l'action.
Le désir quant à lui peut être
identifié au manque, à l'envie, à l'appétit ou encore à la concupiscence.
Il est donc inhérent à un objet, le désir est
toujours désir de quelque chose.
Pour qu'il y ait désir il faut que l'objet attire, que sa possession procure ou du
moins semble procurer un bienfait.
En tant que caractéristique essentielle de l'homme remettre en question l'utilité
du désir c'est remettre en question, en un certain sens, la nature humaine.
Pour autant parler de l'inanité du désir
n'est pas contradictoire dans la mesure où le désir en lui-même n'est rien ou du moins n'est que la recherche de
quelque chose.
Il attend son assouvissement pour être véritablement.
Mais une fois accompli il n'est déjà plus luimême puisqu'il est un manque.
Le désir après avoir atteint son objet part à la conquête d'un autre objet.
L'homme
ne peut s'empêcher de désirer et pourtant cette recherche est une course sans fin.
Il y a donc deux tensions dans
ce sujet.
La première tension concerne le caractère indéfini du désir, il n'y a pas de fin au désir car il reste à jamais
inassouvi.
La deuxième tension a trait à la vie qui semble ne pas pouvoir être sans désir.
Problématique : Le fait de désirer loin de servir l'homme ne fait qu'exprimer son imperfection dans la mesure
où il est l'indice d'un manque.
Loin d'être passager ce manque est souligné continuellement dans la mesure où le
désir après avoir atteint un objet est à la recherche d'un autre objet.
En ce sens on peut douter de son utilité et de
sa raison d'être.
Pour autant empêcher l'homme de désirer c'est aller contre sa nature et s'avère impossible.
Sans
désir l'homme est mort parce qu'il a perdu le mouvement qui le pousse à l'action et qui est le symbole de la vie.
PLAN DETAILLE
Première partie : L'inanité du désir.
1.1 Le désir comme manque est l'indice de l'imperfection humaine (la perfection est alors entendue comme
achèvement).
« -Essaye donc aussi, reprit Socrate, à propos de l'Amour, de nous dire s'il est amour de quelque
chose ou de rien.
-
Il est certainement l'amour de quelque chose.
-
Garde donc dans ta mémoire, dit Socrate, de quoi il est amour, et réponds seulement à ceci :
l'Amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amour ?
-
Il le désire, répondit-il.
Mais, reprit Socrate, quand il désire et aime, a-t-il ce qu'il désire et
aime, ou ne l'a-t-il pas ?
-
Vraisemblablement il ne l'a pas, dit Agathon.
Vois, continua Socrate, si, au lieu de vraisemblablement, il ne faut pas dire nécessairement
que celui qui désire désire une chose qui lui manque et ne désire pas ce qui ne lui manque pas.
[...] Cet homme donc, comme tous ceux qui désirent, désire ce qui n'est pas actuel ni présent ;
ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour.
»
PLATON, Le Banquet, 200.
1.2 Le désir est éternellement inassouvi et asservit l'homme.
« Tout vouloir procède d'un besoin, c'est-à-dire d'une privation, c'est-à-dire d'une souffrance.
La
satisfaction y met fin ; mais pour un désir qui est satisfait, dix au moins sont contrariés ; de plus, le désir est
long, et ses exigences tendent à l'infini ; la satisfaction est courte, et elle est parcimonieusement mesurée.
Mais ce contentement suprême lui-même n'est qu'apparent : le désir satisfait fait place aussitôt à un
nouveau désir ; le premier est une déception reconnue, le second est une déception non encore reconnue.
La satisfaction d'aucun souhait ne peut procurer de contentement durable et inaltérable.
C'est comme.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- RoussEAu: «Malheur à qui n'a plus rien à désirer.»
- Y a-t-il un sens à désirer ce qui est impossible ?
- Peut-on désirer sans responsabilité ?
- Désirer me rend-il heureux ?
- Peut-on désirer être insensible ?