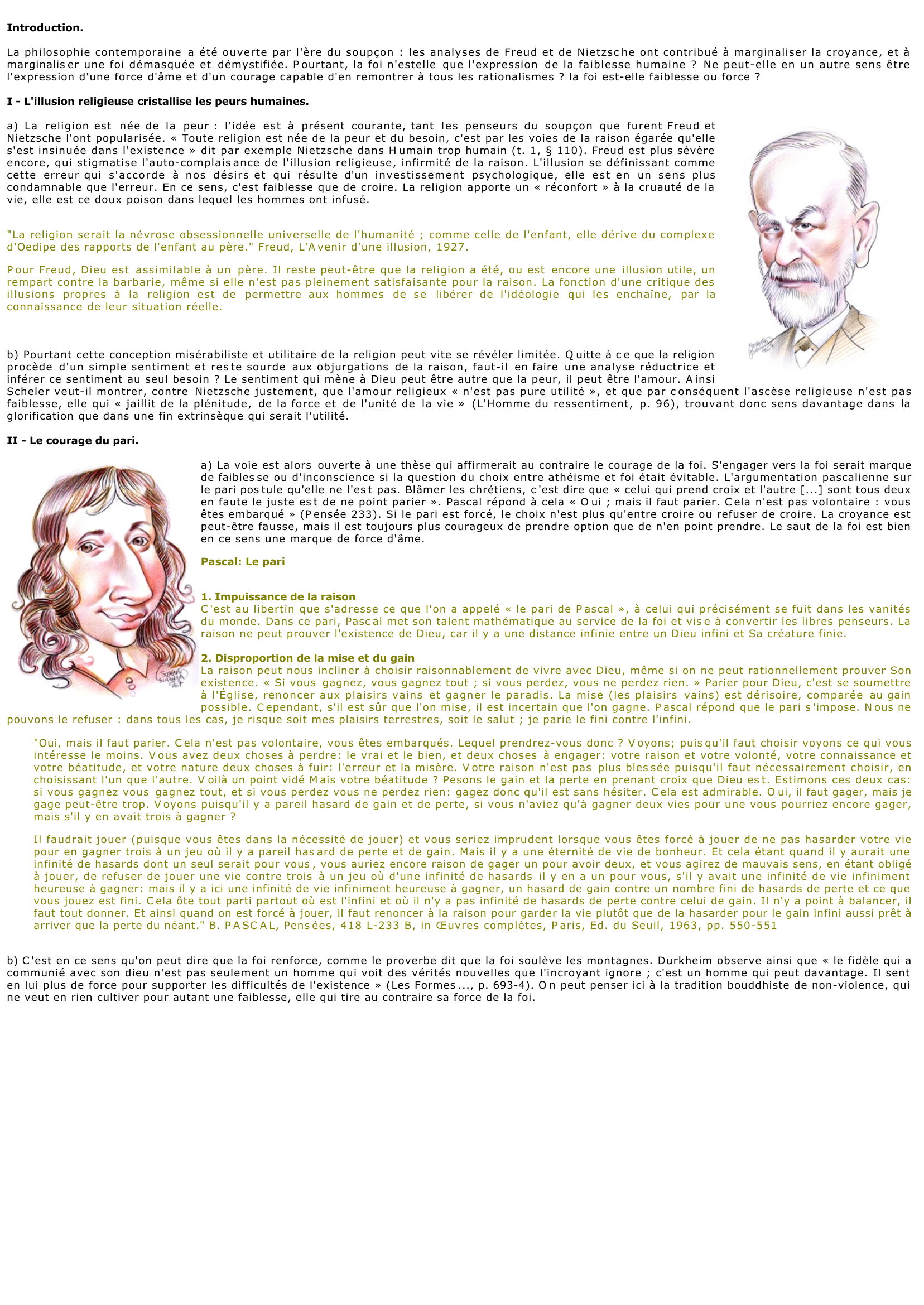Est-ce faiblesse que de croire ?
Extrait du document
«
Introduction.
La philosophie contemporaine a été ouverte par l'ère du soupçon : les analyses de Freud et de Nietzsc he ont contribué à marginaliser la croyance, et à
marginalis er une foi démasquée et démystifiée.
P ourtant, la foi n'estelle que l'expression de la faiblesse humaine ? Ne peut-elle en un autre sens être
l'expression d'une force d'âme et d'un courage capable d'en remontrer à tous les rationalismes ? la foi est-elle faiblesse ou force ?
I - L'illusion religieuse cristallise les peurs humaines.
a) La religion est née de la peur : l'idée est à présent courante, tant l e s penseurs du soupçon que furent Freud et
Nietzsche l'ont popularisée.
« Toute religion est née de la peur et du besoin, c'est par les voies de la raison égarée qu'elle
s'est insinuée dans l'existence » dit par exemple Nietzsche dans H umain trop humain (t.
1, § 110).
Freud est plus sévère
encore, qui stigmatise l'auto-complais ance de l'illusion religieuse, infirmité de la raison.
L'illusion se définissant comme
cette erreur qui s'accorde à nos désirs et qui résulte d'un investissement psychologique, elle e s t e n un s e n s plus
condamnable que l'erreur.
En ce sens, c'est faiblesse que de croire.
La religion apporte un « réconfort » à la cruauté de la
vie, elle est ce doux poison dans lequel les hommes ont infusé.
"La religion serait la névrose obsessionnelle universelle de l'humanité ; comme celle de l'enfant, elle dérive du complexe
d'Oedipe des rapports de l'enfant au père." Freud, L'A venir d'une illusion, 1927.
P our Freud, Dieu est assimilable à un père.
Il reste peut-être que la religion a été, ou est encore une illusion utile, un
rempart contre la barbarie, même si elle n'est pas pleinement satisfaisante pour la raison.
La fonction d'une critique des
illusions propres à la religion est de permettre aux hommes de s e libérer de l'idéologie qui les enchaîne, par la
connaissance de leur situation réelle.
b) Pourtant cette conception misérabiliste et utilitaire de la religion peut vite se révéler limitée.
Q uitte à c e que la religion
procède d'un simple sentiment et res te sourde aux objurgations de la raison, faut-il en faire une analyse réductrice et
inférer ce sentiment au seul besoin ? Le sentiment qui mène à Dieu peut être autre que la peur, il peut être l'amour.
A insi
Scheler veut-il montrer, contre Nietzsche justement, que l'amour religieux « n'est pas pure utilité », et que par c onséquent l'ascèse religieuse n'est pas
faiblesse, elle qui « jaillit de la plénitude, de la force et de l'unité de la vie » (L'Homme du ressentiment, p.
96), trouvant donc sens davantage dans la
glorification que dans une fin extrinsèque qui serait l'utilité.
II - Le courage du pari.
a) La voie est alors ouverte à une thèse qui affirmerait au contraire le courage de la foi.
S'engager vers la foi serait marque
de faibles se ou d'inconscience si la question du choix entre athéisme et foi était évitable.
L'argumentation pascalienne sur
le pari pos tule qu'elle ne l'es t pas.
Blâmer les chrétiens, c 'est dire que « celui qui prend croix et l'autre [...] sont tous deux
en faute le juste es t de ne point parier ».
Pascal répond à cela « O ui ; mais il faut parier.
C ela n'est pas volontaire : vous
êtes embarqué » (P ensée 233).
Si le pari est forcé, le choix n'est plus qu'entre croire ou refuser de croire.
La croyance est
peut-être fausse, mais il est toujours plus courageux de prendre option que de n'en point prendre.
Le saut de la foi est bien
en ce sens une marque de force d'âme.
Pascal: Le pari
1.
Impuissance de la raison
C 'est au libertin que s'adresse ce que l'on a appelé « le pari de P ascal », à celui qui précisément se fuit dans les vanités
du monde.
Dans ce pari, Pasc al met son talent mathématique au service de la foi et vis e à convertir les libres penseurs.
La
raison ne peut prouver l'existence de Dieu, car il y a une distance infinie entre un Dieu infini et Sa créature finie.
2.
Disproportion de la mise et du gain
La raison peut nous incliner à choisir raisonnablement de vivre avec Dieu, même si on ne peut rationnellement prouver Son
existence.
« Si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien.
» Parier pour Dieu, c'est se soumettre
à l'Église, renoncer aux plaisirs vains et gagner le paradis.
La mise (les plaisirs vains) est dérisoire, comparée au gain
possible.
C ependant, s'il est sûr que l'on mise, il est incertain que l'on gagne.
P ascal répond que le pari s 'impose.
N ous ne
pouvons le refuser : dans tous les cas, je risque soit mes plaisirs terrestres, soit le salut ; je parie le fini contre l'infini.
"Oui, mais il faut parier.
C ela n'est pas volontaire, vous êtes embarqués.
Lequel prendrez-vous donc ? V oyons; puis qu'il faut choisir voyons ce qui vous
intéresse le moins.
V ous avez deux choses à perdre: le vrai et le bien, et deux choses à engager: votre raison et votre volonté, votre connaissance et
votre béatitude, et votre nature deux choses à fuir: l'erreur et la misère.
V otre raison n'est pas plus bles sée puisqu'il faut nécessairement choisir, en
choisissant l'un que l'autre.
V oilà un point vidé M ais votre béatitude ? Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu es t.
Estimons ces deux cas:
si vous gagnez vous gagnez tout, et si vous perdez vous ne perdez rien: gagez donc qu'il est sans hésiter.
C ela est admirable.
O ui, il faut gager, mais je
gage peut-être trop.
V oyons puisqu'il y a pareil hasard de gain et de perte, si vous n'aviez qu'à gagner deux vies pour une vous pourriez encore gager,
mais s'il y en avait trois à gagner ?
Il faudrait jouer (puisque vous êtes dans la nécessité de jouer) et vous seriez imprudent lorsque vous êtes forcé à jouer de ne pas hasarder votre vie
pour en gagner trois à un jeu où il y a pareil has ard de perte et de gain.
Mais il y a une éternité de vie de bonheur.
Et cela étant quand il y aurait une
infinité de hasards dont un seul serait pour vous , vous auriez encore raison de gager un pour avoir deux, et vous agirez de mauvais sens, en étant obligé
à jouer, de refuser de jouer une vie contre trois à un jeu où d'une infinité de hasards il y en a un pour vous, s'il y avait une infinité de vie infiniment
heureuse à gagner: mais il y a ici une infinité de vie infiniment heureuse à gagner, un hasard de gain contre un nombre fini de hasards de perte et ce que
vous jouez est fini.
C ela ôte tout parti partout où est l'infini et où il n'y a pas infinité de hasards de perte contre celui de gain.
Il n'y a point à balancer, il
faut tout donner.
Et ainsi quand on est forcé à jouer, il faut renoncer à la raison pour garder la vie plutôt que de la hasarder pour le gain infini aussi prêt à
arriver que la perte du néant." B.
P A SC A L, Pens ées, 418 L-233 B, in Œuvres complètes, P aris, Ed.
du Seuil, 1963, pp.
550-551
b) C 'est en ce sens qu'on peut dire que la foi renforce, comme le proverbe dit que la foi soulève les montagnes.
Durkheim observe ainsi que « le fidèle qui a
communié avec son dieu n'est pas seulement un homme qui voit des vérités nouvelles que l'incroyant ignore ; c'est un homme qui peut davantage.
Il sent
en lui plus de force pour supporter les difficultés de l'existence » (Les Formes ..., p.
693-4).
O n peut penser ici à la tradition bouddhiste de non-violence, qui
ne veut en rien cultiver pour autant une faiblesse, elle qui tire au contraire sa force de la foi..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Est-ce faiblesse que de croire?
- Savoir est-ce cesser de croire ?
- Hume: Connaître, est-ce cesser de croire ?
- Douter est-ce signe de force ou de faiblesse ?
- Croire et raisonner