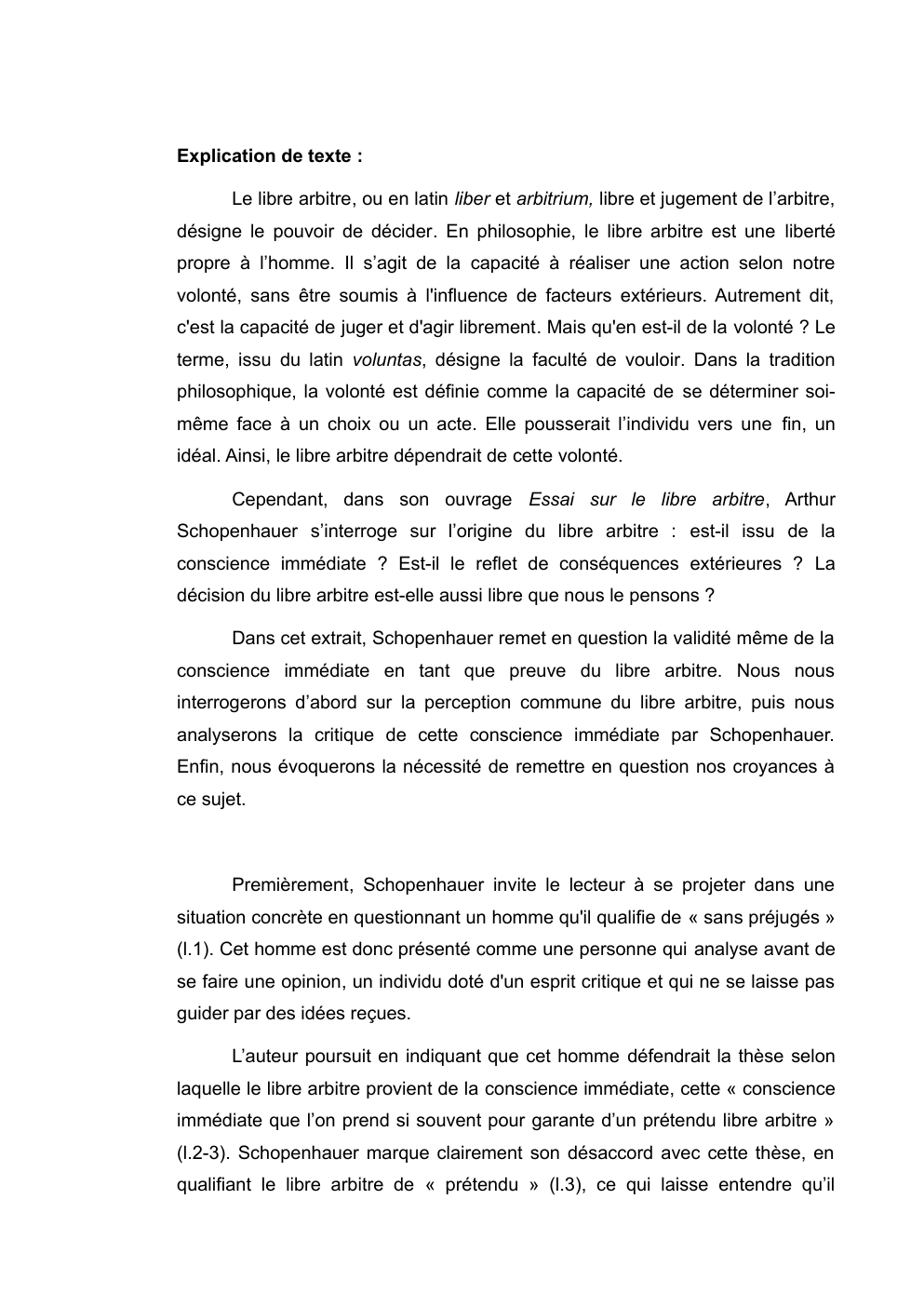Disserte Essai sur le libre arbitre
Publié le 08/05/2025
Extrait du document
«
Explication de texte :
Le libre arbitre, ou en latin liber et arbitrium, libre et jugement de l’arbitre,
désigne le pouvoir de décider.
En philosophie, le libre arbitre est une liberté
propre à l’homme.
Il s’agit de la capacité à réaliser une action selon notre
volonté, sans être soumis à l'influence de facteurs extérieurs.
Autrement dit,
c'est la capacité de juger et d'agir librement.
Mais qu'en est-il de la volonté ? Le
terme, issu du latin voluntas, désigne la faculté de vouloir.
Dans la tradition
philosophique, la volonté est définie comme la capacité de se déterminer soimême face à un choix ou un acte.
Elle pousserait l’individu vers une fin, un
idéal.
Ainsi, le libre arbitre dépendrait de cette volonté.
Cependant, dans son ouvrage Essai sur le libre arbitre, Arthur
Schopenhauer s’interroge sur l’origine du libre arbitre : est-il issu de la
conscience immédiate ? Est-il le reflet de conséquences extérieures ? La
décision du libre arbitre est-elle aussi libre que nous le pensons ?
Dans cet extrait, Schopenhauer remet en question la validité même de la
conscience immédiate en tant que preuve du libre arbitre.
Nous nous
interrogerons d’abord sur la perception commune du libre arbitre, puis nous
analyserons la critique de cette conscience immédiate par Schopenhauer.
Enfin, nous évoquerons la nécessité de remettre en question nos croyances à
ce sujet.
Premièrement, Schopenhauer invite le lecteur à se projeter dans une
situation concrète en questionnant un homme qu'il qualifie de « sans préjugés »
(l.1).
Cet homme est donc présenté comme une personne qui analyse avant de
se faire une opinion, un individu doté d'un esprit critique et qui ne se laisse pas
guider par des idées reçues.
L’auteur poursuit en indiquant que cet homme défendrait la thèse selon
laquelle le libre arbitre provient de la conscience immédiate, cette « conscience
immédiate que l’on prend si souvent pour garante d’un prétendu libre arbitre »
(l.2-3).
Schopenhauer marque clairement son désaccord avec cette thèse, en
qualifiant le libre arbitre de « prétendu » (l.3), ce qui laisse entendre qu’il
considère cette notion comme une illusion.
L’expression « si souvent » (l.2)
montre également que cette croyance, selon laquelle la liberté découle de la
conscience immédiate, est courante et largement partagée.
Cette idée
s’apparente à la conception de la liberté chez certains philosophes, comme
Descartes, qui voit la liberté comme la capacité de se déterminer soi-même.
Dans sa Lettre au père Mesland du 9 février 1645, Descartes écrit : « Au point
que, même lorsqu'une raison fort évidente nous pousse vers un parti, quoique,
moralement parlant, il soit difficile de faire le contraire, parlant néanmoins
absolument, nous le pouvons.
» On retrouve ici l'idée que la liberté réside dans
la possibilité de choisir autrement, même contre la raison ou la morale.
Cependant, Schopenhauer critique cette idée, car il pense que cette liberté
apparente repose sur une illusion : nos choix ne sont pas vraiment libres, car ils
sont toujours déterminés par des causes profondes et inconscientes.
Ensuite, Schopenhauer illustre son propos par un exemple concret, celui
de la réponse qu'un homme « sans préjugés » pourrait donner : « Je peux faire
ce que je veux.
Si je veux aller à gauche, je vais à gauche ; si je veux aller à
droite, je vais à droite.
Cela dépend uniquement de mon bon vouloir : je suis
donc libre » (l.3-5).
Cet exemple met en lumière l’illusion de la liberté immédiate
: l’individu croit que ses choix sont le fruit de sa seule volonté, sans reconnaître
l’influence d’autres facteurs.
Schopenhauer semble suggérer que cette
perception du libre arbitre, bien que légitime dans le ressenti, est insuffisante
pour prouver une véritable liberté.
Pour Schopenhauer, ce que l’homme perçoit
comme une décision « libre » (l.5) est en réalité déterminé par des facteurs
inconscients qui échappent à sa perception immédiate.
C’est cette illusion de
liberté que l’auteur interroge dans cet extrait.
Schopenhauer ne contredit pas les faits avancés par l’homme ordinaire,
affirmant que « un tel témoignage est certainement juste et véridique » (l.5-6),
puisqu’il ne remet pas en question les actions effectivement réalisées par
l’homme, mais plutôt ce que ces actions sont supposées prouver.
En effet,
l’auteur montre que le témoignage de l’homme ne démontre pas le fondement
du libre arbitre.
L’homme « présuppose la liberté de la volonté et admet
implicitement que la décision est déjà prise » (l.6-7), ce qui fait que « la liberté
de la décision elle-même ne peut donc nullement être établie par cette
affirmation » (l.7-8).
Autrement dit, si l’homme choisit d’aller à droite et va
effectivement à droite, cela ne prouve pas que sa décision a été prise librement,
car cela sous-entend que la décision était déjà prise avant l’action.
Son
témoignage ne montre donc pas les forces et les déterminations qui ont agi
avant qu’il prenne la décision, c’est-à-dire la manière dont ses choix peuvent
être influencés par des facteurs inconscients ou externes.
Le philosophe poursuit en présentant deux formes différentes de la
volonté que l’homme, pour rendre son témoignage plus pertinent, aurait dû
mentionner : la « dépendance » (l.9) de la volonté et l’« indépendance » (l.9) de
la volonté au moment où elle se manifeste.
Cependant, si la volonté était
dépendante, le libre arbitre n'existerait pas, car les actes seraient alors
déterminés par une nécessité externe ou interne, et il ne pourrait être question
de liberté réelle.
Dans le second cas, si la volonté était totalement
indépendante, cela pourrait permettre de concevoir un libre arbitre.
Toutefois,
même dans ce cas, Schopenhauer montrerait que l’indépendance de la volonté
n’impliquerait pas une liberté absolue, car nos décisions seraient toujours
influencées par des causes internes inconscientes ou des désirs qui échappent
à notre conscience immédiate.
Le philosophe ne fait pas explicitement
référence à cette indépendance dans cet extrait, mais il suggère que la
véritable liberté ne réside pas dans une volonté totalement indépendante, mais
dans la compréhension des causes profondes qui déterminent nos actes.
Enfin, Schopenhauer explique que seules les « conséquences de cet
acte » (l.10) sont exposées, ce qui montre que l’objectif est présenté « une fois
qu’il est accompli » (l.10), et non pas ce qui conduit à son accomplissement.
Il
continue ainsi de discréditer la thèse avancée au début du texte, en soulignant
qu’aucune preuve ne vient établir que le libre arbitre se fonde sur la conscience
immédiate.
Schopenhauer met en lumière le fait que cette conscience
immédiate ne nous montre que les effets de l’action, le fait d’aller à gauche ou à
droite, mais pas les causes profondes qui ont....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication d'un extrait d'Essai sur le libre arbitre de Schopenhauer
- Nietzsche et le libre arbitre
- Quels sont les problèmes moraux, métaphysiques et psychologiques engagés dans la question de la liberté ou libre arbitre et du déterminisme ?
- LEIBNIZ: Libre(arbitre et indifférence
- La thèse du libre arbitre est-elle indispensable à la morale?