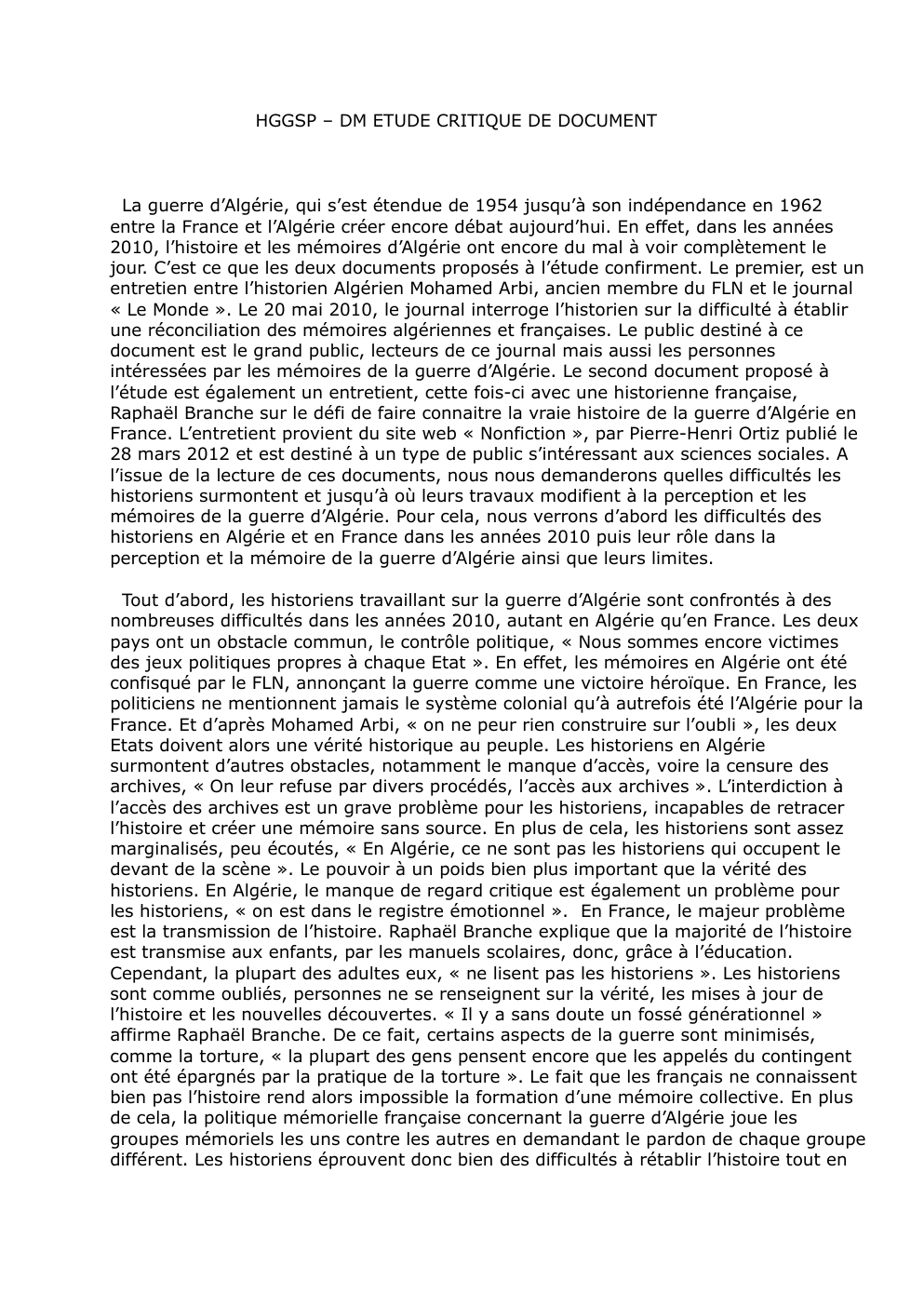étude critique de document - HGGSP - histoire et mémoire - la guerre d'Algérie
Publié le 29/10/2025
Extrait du document
«
HGGSP – DM ETUDE CRITIQUE DE DOCUMENT
La guerre d’Algérie, qui s’est étendue de 1954 jusqu’à son indépendance en 1962
entre la France et l’Algérie créer encore débat aujourd’hui.
En effet, dans les années
2010, l’histoire et les mémoires d’Algérie ont encore du mal à voir complètement le
jour.
C’est ce que les deux documents proposés à l’étude confirment.
Le premier, est un
entretien entre l’historien Algérien Mohamed Arbi, ancien membre du FLN et le journal
« Le Monde ».
Le 20 mai 2010, le journal interroge l’historien sur la difficulté à établir
une réconciliation des mémoires algériennes et françaises.
Le public destiné à ce
document est le grand public, lecteurs de ce journal mais aussi les personnes
intéressées par les mémoires de la guerre d’Algérie.
Le second document proposé à
l’étude est également un entretient, cette fois-ci avec une historienne française,
Raphaël Branche sur le défi de faire connaitre la vraie histoire de la guerre d’Algérie en
France.
L’entretient provient du site web « Nonfiction », par Pierre-Henri Ortiz publié le
28 mars 2012 et est destiné à un type de public s’intéressant aux sciences sociales.
A
l’issue de la lecture de ces documents, nous nous demanderons quelles difficultés les
historiens surmontent et jusqu’à où leurs travaux modifient à la perception et les
mémoires de la guerre d’Algérie.
Pour cela, nous verrons d’abord les difficultés des
historiens en Algérie et en France dans les années 2010 puis leur rôle dans la
perception et la mémoire de la guerre d’Algérie ainsi que leurs limites.
Tout d’abord, les historiens travaillant sur la guerre d’Algérie sont confrontés à des
nombreuses difficultés dans les années 2010, autant en Algérie qu’en France.
Les deux
pays ont un obstacle commun, le contrôle politique, « Nous sommes encore victimes
des jeux politiques propres à chaque Etat ».
En effet, les mémoires en Algérie ont été
confisqué par le FLN, annonçant la guerre comme une victoire héroïque.
En France, les
politiciens ne mentionnent jamais le système colonial qu’à autrefois été l’Algérie pour la
France.
Et d’après Mohamed Arbi, « on ne peur rien construire sur l’oubli », les deux
Etats doivent alors une vérité historique au peuple.
Les historiens en Algérie
surmontent d’autres obstacles, notamment le manque d’accès, voire la censure des
archives, « On leur refuse par divers procédés, l’accès aux archives ».
L’interdiction à
l’accès des archives est un grave problème pour les historiens, incapables de retracer
l’histoire et créer une mémoire sans source.
En plus de cela, les historiens sont assez
marginalisés, peu écoutés, « En Algérie, ce ne sont pas les historiens qui occupent le
devant de la scène ».
Le pouvoir à un poids bien plus important que la vérité des
historiens.
En Algérie, le manque de regard critique est également un problème pour
les historiens, « on est dans le registre émotionnel ».
En France, le majeur problème
est la transmission de l’histoire.
Raphaël Branche explique que la majorité de l’histoire
est transmise aux enfants, par les manuels scolaires, donc, grâce à l’éducation.
Cependant, la plupart des adultes eux, « ne lisent pas les historiens ».
Les historiens
sont comme oubliés, personnes ne se renseignent sur la vérité, les mises à jour de
l’histoire et les nouvelles découvertes.
« Il y a sans doute un fossé générationnel »
affirme Raphaël Branche.
De ce fait, certains aspects de la guerre sont minimisés,
comme la torture, « la plupart des gens pensent encore que les appelés du contingent
ont été épargnés par la pratique de la torture ».
Le fait que les français ne connaissent
bien pas....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HGGSP: Étude Critique de Documents - l’histoire et les mémoires du génocide
- ÉTUDE CRITIQUE DE DOCUMENT | BLOG Sujet : « La haute mer, un espace de liberté à réglementer et à protéger »
- histoire et mémoire dissertation
- Thème 2 HGGSP Thème 2 : Faire la guerre, faire la paix
- « L'étude de l'histoire littéraire est destinée à remplacer en grande partie la lecture directe des Oeuvres de l'esprit humain. » A cette affirmation de Renan, Lanson répond dans l'avant-propos de son Histoire de la Littérature française : « Je voudrais