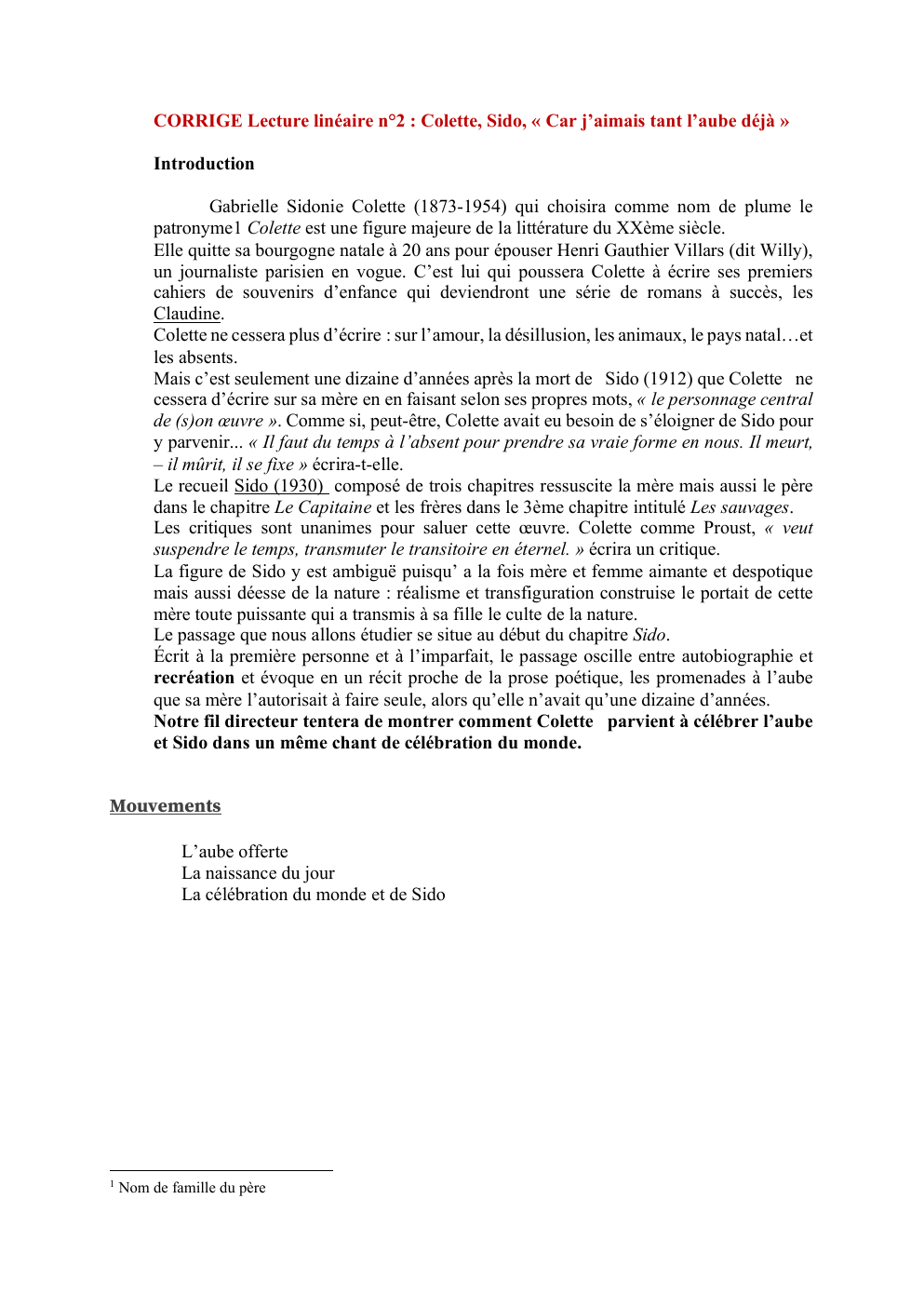CORRIGE Lecture linéaire n°2 : Colette, Sido, « Car j’aimais tant l’aube déjà »
Publié le 08/11/2025
Extrait du document
«
CORRIGE Lecture linéaire n°2 : Colette, Sido, « Car j’aimais tant l’aube déjà »
Introduction
Gabrielle Sidonie Colette (1873-1954) qui choisira comme nom de plume le
patronyme1 Colette est une figure majeure de la littérature du XXème siècle.
Elle quitte sa bourgogne natale à 20 ans pour épouser Henri Gauthier Villars (dit Willy),
un journaliste parisien en vogue.
C’est lui qui poussera Colette à écrire ses premiers
cahiers de souvenirs d’enfance qui deviendront une série de romans à succès, les
Claudine.
Colette ne cessera plus d’écrire : sur l’amour, la désillusion, les animaux, le pays natal…et
les absents.
Mais c’est seulement une dizaine d’années après la mort de Sido (1912) que Colette ne
cessera d’écrire sur sa mère en en faisant selon ses propres mots, « le personnage central
de (s)on œuvre ».
Comme si, peut-être, Colette avait eu besoin de s’éloigner de Sido pour
y parvenir...
« Il faut du temps à l’absent pour prendre sa vraie forme en nous.
Il meurt,
– il mûrit, il se fixe » écrira-t-elle.
Le recueil Sido (1930) composé de trois chapitres ressuscite la mère mais aussi le père
dans le chapitre Le Capitaine et les frères dans le 3ème chapitre intitulé Les sauvages.
Les critiques sont unanimes pour saluer cette œuvre.
Colette comme Proust, « veut
suspendre le temps, transmuter le transitoire en éternel.
» écrira un critique.
La figure de Sido y est ambiguë puisqu’ a la fois mère et femme aimante et despotique
mais aussi déesse de la nature : réalisme et transfiguration construise le portait de cette
mère toute puissante qui a transmis à sa fille le culte de la nature.
Le passage que nous allons étudier se situe au début du chapitre Sido.
Écrit à la première personne et à l’imparfait, le passage oscille entre autobiographie et
recréation et évoque en un récit proche de la prose poétique, les promenades à l’aube
que sa mère l’autorisait à faire seule, alors qu’elle n’avait qu’une dizaine d’années.
Notre fil directeur tentera de montrer comment Colette parvient à célébrer l’aube
et Sido dans un même chant de célébration du monde.
Mouvements
L’aube offerte
La naissance du jour
La célébration du monde et de Sido
1
Nom de famille du père
Étés réverbérés par le gravier jaune et chaud, étés traversant le jonc tressé de mes
grands chapeaux, étés presque sans nuits…
Le passage s’ouvre sur une phrase sans verbe, au rythme ternaire : le ton se fait
incantatoire.
Le terme « Etés » repris 3 fois au pluriel évoque une expérience plusieurs fois vécues
(mais toujours unique),
Le participe passé « réverbérés » insiste sur la lumière, l’éblouissement.
Aussitôt viennent d’autres sensations « gravier jaune et chaud » qui renvoie à la sensation
visuel et tactile de chaleur
La narratrice n’est présente que par la métonymie « mes grands chapeaux »
On sait qu’on est au cœur de l’été « étés presque sans nuits » mais il ne s’agit pas ici de
donner au lecteur un cadre spatio-temporel précis mais plutôt de retrouver les sensations,
les émotions de l’enfance dans cet instant de grâce qu’est l’aube.
Suggère également la
durée des journées en été, amplifiant ainsi la perception de la vie intense et lumineuse
« réverbérés », « jaune ».
Les points de suspension contribuent à la dimension mystérieuse du paysage.
Car j’aimais tant l’aube, déjà, que ma mère me l’accordait en récompense.
Courte phrase qui met en parallèle la célébration de l’aube et de la mère
L’emploi de l’imparfait d’habitude « j’aimais », de l’adverbe « déjà » accompagné de
l’adverbe d’intensité « tant » montre une fascination qui n’a pas cessé.
Il y a filiation,
continuité entre le « je » de l’enfance et le « je » de l’adulte au moment de l’écriture.
Quant à la mère elle apparait ici comme une sorte de divinité offrant « l’aube », donc la
naissance du monde à sa fille : « ma mère me l’accordait en récompense ».
On peut donc
voir ici célébration du monde mais aussi de la mère.
J’obtenais qu’elle m’éveillât à trois heures et demie, et je m’en allais, un panier vide
à chaque bras, vers des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la
rivière, vers les fraises, les cassis et les groseilles barbues.
L’indication « trois heures et demie, » marque le début du récit.
Mais donne aussi une
indication sur une éducation atypique, inhabituelle.
Le verbe d’action « je m’en allais » à l’imparfait à valeur d’habitude marque la
détermination et symboliquement la recherche d’une nourriture pas seulement
terrestre :« un panier vide à chaque bras » peut suggérer la recherche de choses
inconnues, ignorées qu’on ramènera avec soi de cette « expédition ».Une expérience
existentielle.
La nature est personnifiée « des terres maraîchères qui se réfugiaient » comme si elle
voulait se protéger des hommes.
La quête pour « les fraises, les cassis et les groseilles barbues » nous ramène aux sens,
« barbues » suggérant ici une sensation gustative.
Elle donne aussi l’image d’une nature
bienveillante et nourricière.
Et celle du conte aussi ( image du petit chaperon rouge)
Il y a donc dans cette ouverture un lien très fort qui se manifeste entre la figure
maternelle et la nature.
(2° mouvement)
À trois heures et demie, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus, et
quand je descendais le chemin de sable, le brouillard retenu par son poids baignait
d’abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait, atteignait mes lèvres, mes oreilles
et mes narines plus sensibles que tout le reste de mon corps…
« À trois heures et demie » cette précision temporelle produit un effet de réalité mais
aussitôt dementi par la suite de la phrase : « tout dormait dans un bleu originel, humide et
confus » :les 3 adjectifs magnifient la description de la naissance du jour (pour employer
le titre d’une œuvre de Colette) et lui donnent une dimension mythique .
En effet, on est avant même l’éclosion du jour « tout dormait » , c’est le monde
« originel », la source..
Le « bleu originel » suggère renforce cette impressio et donne une sensation de calme,
de sérénité.
C’est paysage onirique (rêve) ;« confus », « brouillard » suggèrent aussi un
certain mystère
Et cette longue phrase constituée de propositions indépendantes constitue autant d’étapes
qui associent la naissance du jour à la naissance de la narratrice qui se dessine peu à peu
sous nos yeux « d’abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait, atteignait mes lèvres,
mes oreilles et mes narines ».
Tous les sens sont convoqués à travers les parties du corps : le toucher par « jambes » et
« torse »,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LECTURE LINÉAIRE 12 « Mémoires d’une âme » « Melancholia », Les Contemplations, (1856), Victor Hugo
- Argument lecture linéaire sur la princesse de clèves - scène d'aveu et caractère exceptionnel des personnages
- Lecture Linéaire N°11 Charles Baudelaire, Fleurs du Mal, Texte Intégral, « Tableaux parisiens » « Le Soleil »
- Lecture linéaire Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil : La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle
- lecture de l'incipit de Bouvard et Pécuchet de Flaubert