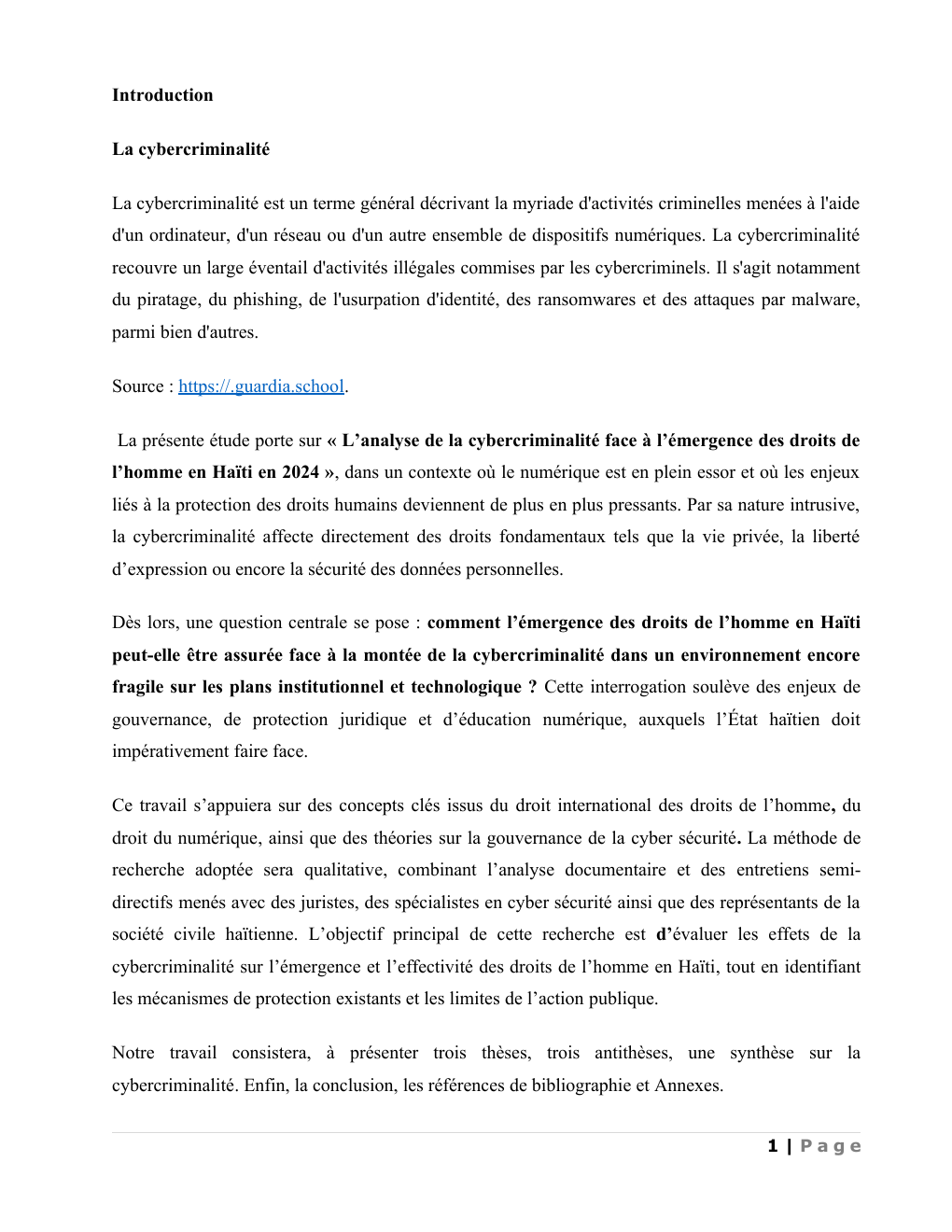Devoir de recherche: La cybercriminalité
Publié le 20/06/2025
Extrait du document
«
Introduction
La cybercriminalité
La cybercriminalité est un terme général décrivant la myriade d'activités criminelles menées à l'aide
d'un ordinateur, d'un réseau ou d'un autre ensemble de dispositifs numériques.
La cybercriminalité
recouvre un large éventail d'activités illégales commises par les cybercriminels.
Il s'agit notamment
du piratage, du phishing, de l'usurpation d'identité, des ransomwares et des attaques par malware,
parmi bien d'autres.
Source : https://.guardia.school.
La présente étude porte sur « L’analyse de la cybercriminalité face à l’émergence des droits de
l’homme en Haïti en 2024 », dans un contexte où le numérique est en plein essor et où les enjeux
liés à la protection des droits humains deviennent de plus en plus pressants.
Par sa nature intrusive,
la cybercriminalité affecte directement des droits fondamentaux tels que la vie privée, la liberté
d’expression ou encore la sécurité des données personnelles.
Dès lors, une question centrale se pose : comment l’émergence des droits de l’homme en Haïti
peut-elle être assurée face à la montée de la cybercriminalité dans un environnement encore
fragile sur les plans institutionnel et technologique ? Cette interrogation soulève des enjeux de
gouvernance, de protection juridique et d’éducation numérique, auxquels l’État haïtien doit
impérativement faire face.
Ce travail s’appuiera sur des concepts clés issus du droit international des droits de l’homme, du
droit du numérique, ainsi que des théories sur la gouvernance de la cyber sécurité.
La méthode de
recherche adoptée sera qualitative, combinant l’analyse documentaire et des entretiens semidirectifs menés avec des juristes, des spécialistes en cyber sécurité ainsi que des représentants de la
société civile haïtienne.
L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer les effets de la
cybercriminalité sur l’émergence et l’effectivité des droits de l’homme en Haïti, tout en identifiant
les mécanismes de protection existants et les limites de l’action publique.
Notre travail consistera, à présenter trois thèses, trois antithèses, une synthèse sur la
cybercriminalité.
Enfin, la conclusion, les références de bibliographie et Annexes.
1|Page
Développement
A) Thèses sur la cybercriminalité
L’absence de cadre juridique clair en Haïti face à la cybercriminalité menace directement les droits
fondamentaux des citoyens, notamment la vie privée et la liberté d’expression.
L’absence de
législation sur la protection des données permet des intrusions abusives (surveillance non encadrée,
atteintes à la vie privée).
Dans son article intitulé la cybercriminalité, le crime comme moyen de contrôle du cyberespace
commercial, Léman-Langlois (2006) dit que la cybercriminalité est utilisée comme un levier pour
instaurer un certain ordre dans l’espace numérique, en particulier dans les environnements
commerciaux.
En l'absence d'une politique numérique inclusive, la lutte contre la cybercriminalité en Haïti risque
de renforcer les inégalités sociales et d'exclure les groupes marginalisés de l’exercice de leurs
droits.
« La cybercriminalité peut alors se définir comme toute action illégale dont l'objet est de perpétrer
des infractions pénales sur ou au moyen d'un système informatique interconnecté à un réseau de
télécommunication.
Elle vise soit des infractions spécifiques à Internet, pour lesquelles les
technologies de l’information et de la communication sont l'objet même du délit, soit des infractions
de droit commun pour lesquelles Internet est le moyen de développer des infractions préexistantes.
Dès lors, on peut affirmer que la notion de cybercriminalité vise deux types d’infractions »
(Romain, 2016, p.
28).
La cybercriminalité croissante en Haïti met en évidence la nécessité urgente d'un cadre de droits
numériques pour garantir la sécurité, la dignité et la souveraineté numérique des citoyens (UNODC,
2013).
B) Antithèses sur la cybercriminalité
L’absence d’infrastructures numériques fiables en Haïti rend la lutte contre la cybercriminalité
inefficace et secondaire par rapport aux besoins fondamentaux liés aux droits humains (ITU, 2023).
Dans ouvrage intitulé The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new
frontier of power.
Public Affairs, Zuboff (2019) montre que les véritables menaces pour les droits
numériques ne viennent pas seulement des cybercriminels, mais aussi du capitalisme de
surveillance, souvent légal, mais plus dangereux.
« Cette amplification médiatique du phénomène n’est pas neutre : elle participe à la construction
d’une « culture de la peur » dans laquelle les citoyens, inquiets pour leur sécurité numérique,
deviennent plus enclins à accepter des mesures de surveillance, de restriction des libertés
numériques, voire de censure, qui auraient été inacceptables dans un contexte normal.
Il montre que
2|Page
cette peur fabriquée légitime souvent des lois répressives et une croissance de l’appareil sécuritaire,
au nom de la lutte contre une menace parfois mal définie » (Wall, 2008, p.
865).
C) Synthèse sur la cybercriminalité
La cybercriminalité en Haïti soulève de vives préoccupations quant aux droits humains.
L’absence
de lois claires sur la protection des données expose les citoyens à des violations de leur vie privée et
de leur liberté d’expression (Leman-Langlois, 2006 ; Boos, 2016).
Dans ce contexte, plusieurs
auteurs appellent à la création urgente d’un cadre juridique fondé sur les droits numériques
(UNODC, 2013).
Cependant, d’autres....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'obéissance au devoir peut-elle s'accompagner de la recherche du bonheur ?
- Le devoir (cours de philo)
- À LA RECHERCHE D·UN NOUVEL ORDRE MONDIAL DEPUIS LES ANNÉES 1970
- Devoir sur l'étranger de Camus
- devoir sur l'Esthétique