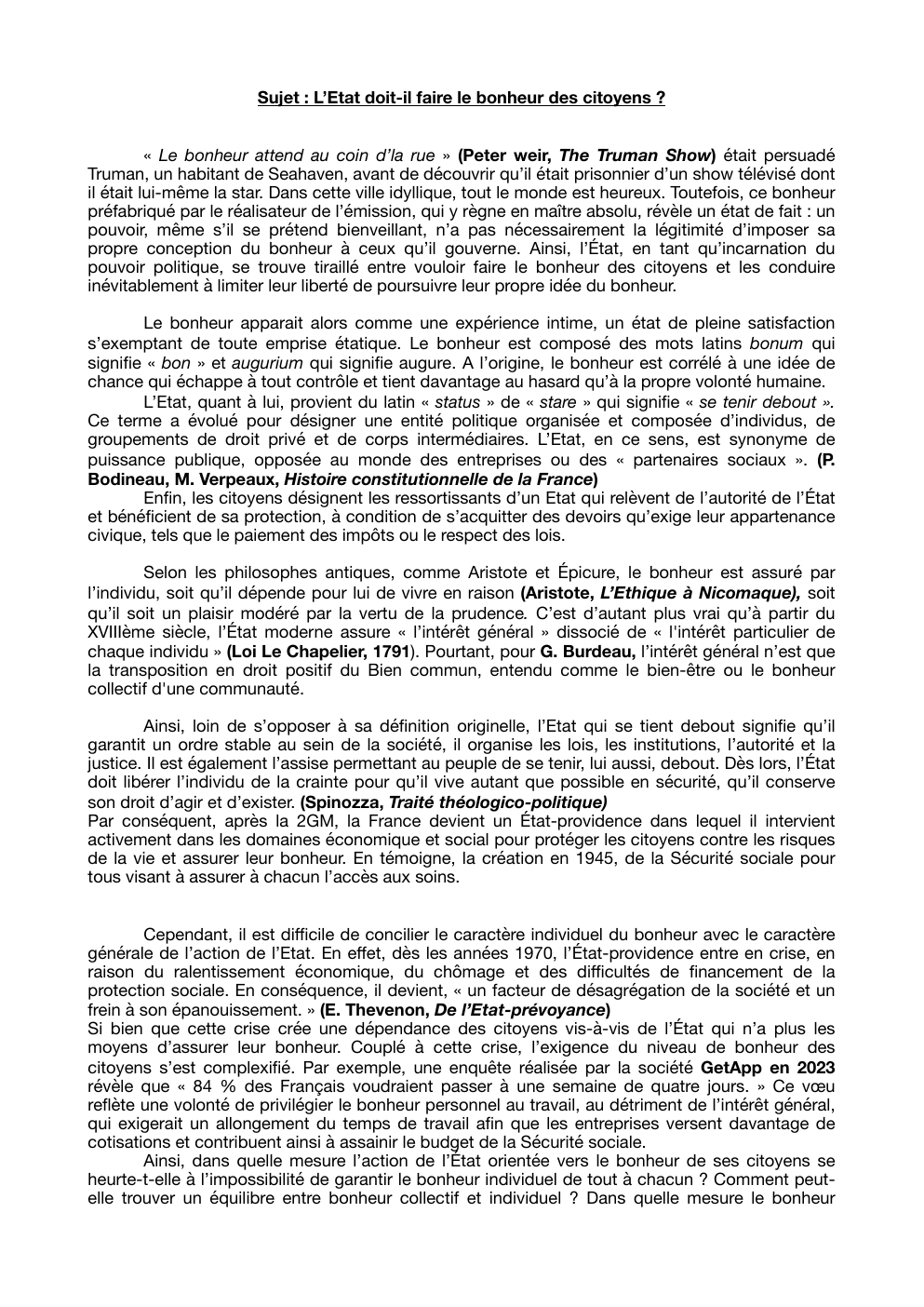L'Etat doit-il faire le bonheur des citoyens ?
Publié le 29/10/2025
Extrait du document
«
Sujet : L’Etat doit-il faire le bonheur des citoyens ?
« Le bonheur attend au coin d’la rue » (Peter weir, The Truman Show) était persuadé
Truman, un habitant de Seahaven, avant de découvrir qu’il était prisonnier d’un show télévisé dont
il était lui-même la star.
Dans cette ville idyllique, tout le monde est heureux.
Toutefois, ce bonheur
préfabriqué par le réalisateur de l’émission, qui y règne en maître absolu, révèle un état de fait : un
pouvoir, même s’il se prétend bienveillant, n’a pas nécessairement la légitimité d’imposer sa
propre conception du bonheur à ceux qu’il gouverne.
Ainsi, l’État, en tant qu’incarnation du
pouvoir politique, se trouve tiraillé entre vouloir faire le bonheur des citoyens et les conduire
inévitablement à limiter leur liberté de poursuivre leur propre idée du bonheur.
Le bonheur apparait alors comme une expérience intime, un état de pleine satisfaction
s’exemptant de toute emprise étatique.
Le bonheur est composé des mots latins bonum qui
signi e « bon » et augurium qui signi e augure.
A l’origine, le bonheur est corrélé à une idée de
chance qui échappe à tout contrôle et tient davantage au hasard qu’à la propre volonté humaine.
L’Etat, quant à lui, provient du latin « status » de « stare » qui signi e « se tenir debout ».
Ce terme a évolué pour désigner une entité politique organisée et composée d’individus, de
groupements de droit privé et de corps intermédiaires.
L’Etat, en ce sens, est synonyme de
puissance publique, opposée au monde des entreprises ou des « partenaires sociaux ».
(P.
Bodineau, M.
Verpeaux, Histoire constitutionnelle de la France)
En n, les citoyens désignent les ressortissants d’un Etat qui relèvent de l’autorité de l’État
et béné cient de sa protection, à condition de s’acquitter des devoirs qu’exige leur appartenance
civique, tels que le paiement des impôts ou le respect des lois.
Selon les philosophes antiques, comme Aristote et Épicure, le bonheur est assuré par
l’individu, soit qu’il dépende pour lui de vivre en raison (Aristote, L’Ethique à Nicomaque), soit
qu’il soit un plaisir modéré par la vertu de la prudence.
C’est d’autant plus vrai qu’à partir du
XVIIIème siècle, l’État moderne assure « l’intérêt général » dissocié de « l'intérêt particulier de
chaque individu » (Loi Le Chapelier, 1791).
Pourtant, pour G.
Burdeau, l’intérêt général n’est que
la transposition en droit positif du Bien commun, entendu comme le bien-être ou le bonheur
collectif d'une communauté.
Ainsi, loin de s’opposer à sa dé nition originelle, l’Etat qui se tient debout signi e qu’il
garantit un ordre stable au sein de la société, il organise les lois, les institutions, l’autorité et la
justice.
Il est également l’assise permettant au peuple de se tenir, lui aussi, debout.
Dès lors, l’État
doit libérer l’individu de la crainte pour qu’il vive autant que possible en sécurité, qu’il conserve
son droit d’agir et d’exister.
(Spinozza, Traité théologico-politique)
Par conséquent, après la 2GM, la France devient un État-providence dans lequel il intervient
activement dans les domaines économique et social pour protéger les citoyens contre les risques
de la vie et assurer leur bonheur.
En témoigne, la création en 1945, de la Sécurité sociale pour
tous visant à assurer à chacun l’accès aux soins.
fi
fi
fi
ffi
fi
fi
fi
ff
ffi
fi
fi
fi
fi
fl
Cependant, il est di cile de concilier le caractère individuel du bonheur avec le caractère
générale de l’action de l’Etat.
En e et, dès les années 1970, l’État-providence entre en crise, en
raison du ralentissement économique, du chômage et des di cultés de nancement de la
protection sociale.
En conséquence, il devient, « un facteur de désagrégation de la société et un
frein à son épanouissement.
» (E.
Thevenon, De l’Etat-prévoyance)
Si bien que cette crise crée une dépendance des citoyens vis-à-vis de l’État qui n’a plus les
moyens d’assurer leur bonheur.
Couplé à cette crise, l’exigence du niveau de bonheur des
citoyens s’est complexi é.
Par exemple, une enquête réalisée par la société GetApp en 2023
révèle que « 84 % des Français voudraient passer à une semaine de quatre jours.
» Ce vœu
re ète une volonté de privilégier le bonheur personnel au travail, au détriment de l’intérêt général,
qui exigerait un allongement du temps de travail a n que les entreprises versent davantage de
cotisations et contribuent ainsi à assainir le budget de la Sécurité sociale.
Ainsi, dans quelle mesure l’action de l’État orientée vers le bonheur de ses citoyens se
heurte-t-elle à l’impossibilité de garantir le bonheur individuel de tout à chacun ? Comment peutelle trouver un équilibre entre bonheur collectif et individuel ? Dans quelle mesure le bonheur
peut-il relever d’un droit dont l’État serait le garant, et non plus seulement d’une quête individuelle
?
I- La nécessité de l’Etat de garantir un bonheur citoyen se heurte au bonheur individuel
A) L’Etat, vecteur originel du bonheur de ses citoyens
1.
Le bonheur ne relève pas d’une volonté individuelle, il se construit dans la solidarité collective
L’état de satisfaction complet relève de l’ensemble des citoyens :
• Hors de la cité en e et, il n’y a pas d'homme, mais soit une bête, soit un dieu, car nous ne
pouvons y rencontrer les conditions qui réalisent l'humanité (mettre en commun nos idées de
juste et d'injuste, de bien et de mal).
Si nous ne vivons pas en cité, avec d'autres hommes,
alors, nous manquons nalement de tout.
Ex : Tru aut, L’enfant sauvage est un lm qui relate l'histoire d'un enfant, capturé comme un
animal en 1800 dans l'Aveyron par des paysans.
Elevé par des animaux sauvages, il est sourd et
muet lorsqu’il est recueilli par le docteur Itard qui va l’élever et lui apprendre le langage, il devient
heureux lorsqu’il apprend à socialiser
2.
L’État tire sa légitimité démocratique de son engagement envers le bien commun :
La question du bonheur des citoyens est devenu une question de politique centrale puisque :
Le citoyen dispose de droits, il peut faire valoir des prérogatives contre l’État a n d’assurer
l’e ectivité desdits droits :
• Devoirs d'abstention imposés à l’État, celui-ci doit laisser faire quelque chose à leur titulaire
ou ne pas agir contre eux.
Il s'agit typiquement des libertés : les libertés préservent notre
liberté d'agir, de penser et de nous exprimer.
Or, selon le philosophe Alain, le bonheur ne
peut s'exprimer que dans la liberté.
(Ex : La loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité
(LASLP) entrée en vigueur au 1er janvier 2025)
• Les modalités d'action imposées à l'État : dans le cadre de son activité, l'État doit avoir un
comportement qui respecte les intérêts fondamentaux.
C'est le cas par exemple des garanties
de procédure ou d'égalité de traitement.
B) Les di cultés rencontrées par l’Etat pour assurer un bonheur individuel
1.
Le bonheur est une quête individuelle échappant à une emprise étatique
Le bonheur est une quête personnelle, intérieure, qui échappe en grande partie à la sphère
politique ou collective véhiculée par Etat :
fi
fi
fi
ff
fi
ff
ffi
ff
ff
- Pour Épicure, le bonheur réside dans l’ataraxie (paix de l’âme), qu’on ne peut pas imposer de
l’extérieur
- Marguerite Yourcenar, Alexis ou le traité du Vain combat : Alexis renonce au bonheur
conjugal et décide de quitter sa femme car il est homosexuel et ne peut être heureux
qu’individuellement.
- Est écrit durant l’entre-deux-guerres : période de contractualisation du mariage a n
d’augmenter le nb de mariages et augmenter natalité (en 1922, on réduit le délai de viduité est
un délai imposé par le droit aux femmes veuves ou divorcées avant de pouvoir contracter un
nouveau mariage)
- Même si sa décision fait sou rir Monique, il estime qu’aucun bonheur partagé ne peut reposer
sur le mensonge
—> Bonheur ne peut pas être dicté par les normes collectives ou les attentes familiales
- L’État peut créer des conditions favorables, mais ne peut garantir un état subjectif aussi intime
que le bonheur
2.
La gouvernementalité basé sur la di usion du bonheur, les possibles dérives autoritaristes
• Gouvernementalité (Michel Foucault) met l’accent sur le fait de gouverner la conduite des
personnes par le biais de moyens positifs plutôt que par le pouvoir souverain de formuler la loi
Désigne la manière de diriger la conduite d’individus ou de groupes via des des normes et....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- la conscience peut-elle faire obstacle au bonheur ?
- Le bonheur doit-il etre une affaire privée ou d'Etat ?
- Qu'est-ce que faire le bonheur d'autrui ?
- Peut-on faire son bonheur tout seul ?
- Peut-on faire le bonheur des autres malgré eux ?