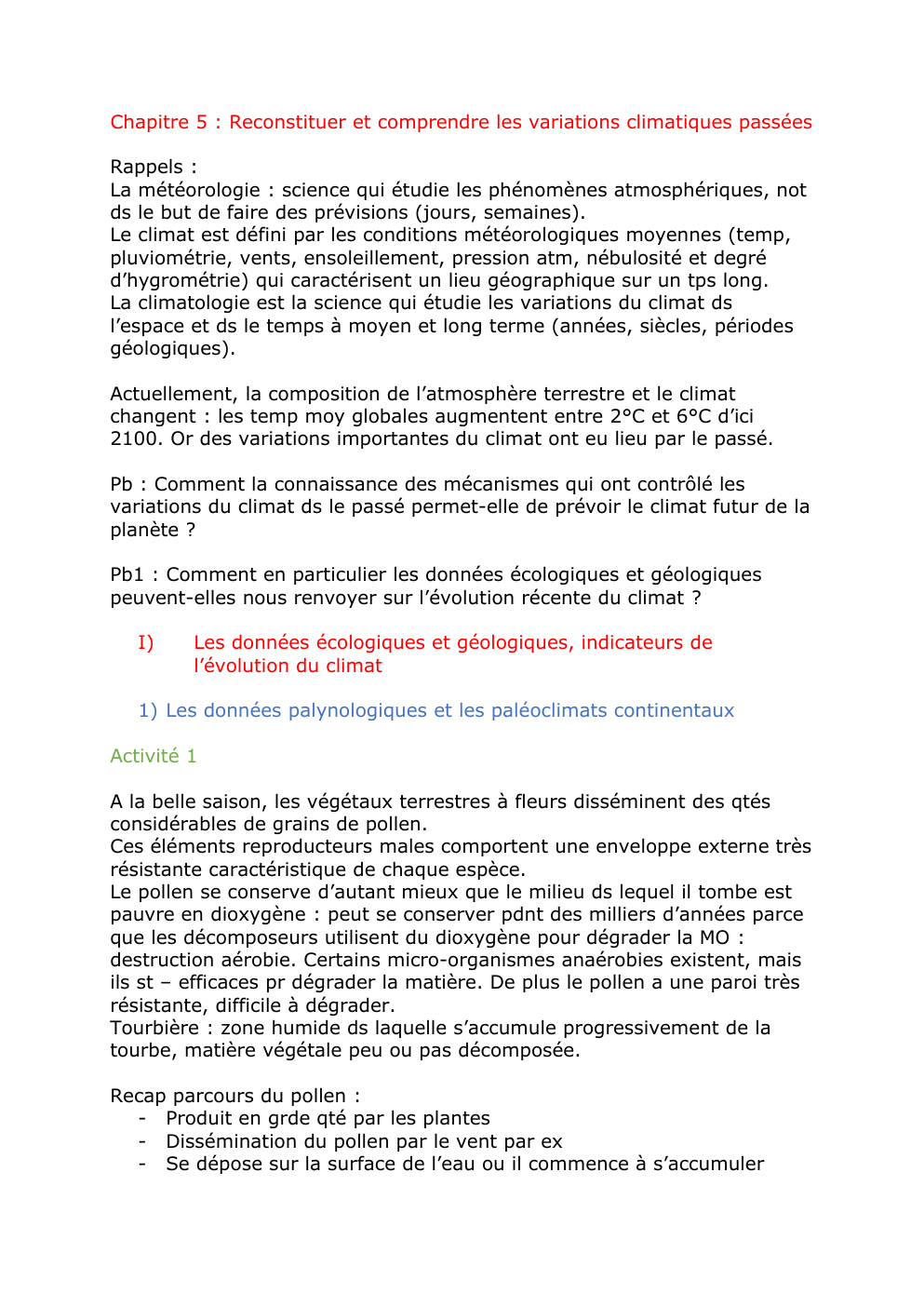SVT: datation absolue et datation relative
Publié le 29/04/2025
Extrait du document
«
Chapitre 5 : Reconstituer et comprendre les variations climatiques passées
Rappels :
La météorologie : science qui étudie les phénomènes atmosphériques, not
ds le but de faire des prévisions (jours, semaines).
Le climat est défini par les conditions météorologiques moyennes (temp,
pluviométrie, vents, ensoleillement, pression atm, nébulosité et degré
d’hygrométrie) qui caractérisent un lieu géographique sur un tps long.
La climatologie est la science qui étudie les variations du climat ds
l’espace et ds le temps à moyen et long terme (années, siècles, périodes
géologiques).
Actuellement, la composition de l’atmosphère terrestre et le climat
changent : les temp moy globales augmentent entre 2°C et 6°C d’ici
2100.
Or des variations importantes du climat ont eu lieu par le passé.
Pb : Comment la connaissance des mécanismes qui ont contrôlé les
variations du climat ds le passé permet-elle de prévoir le climat futur de la
planète ?
Pb1 : Comment en particulier les données écologiques et géologiques
peuvent-elles nous renvoyer sur l’évolution récente du climat ?
I)
Les données écologiques et géologiques, indicateurs de
l’évolution du climat
1) Les données palynologiques et les paléoclimats continentaux
Activité 1
A la belle saison, les végétaux terrestres à fleurs disséminent des qtés
considérables de grains de pollen.
Ces éléments reproducteurs males comportent une enveloppe externe très
résistante caractéristique de chaque espèce.
Le pollen se conserve d’autant mieux que le milieu ds lequel il tombe est
pauvre en dioxygène : peut se conserver pdnt des milliers d’années parce
que les décomposeurs utilisent du dioxygène pour dégrader la MO :
destruction aérobie.
Certains micro-organismes anaérobies existent, mais
ils st – efficaces pr dégrader la matière.
De plus le pollen a une paroi très
résistante, difficile à dégrader.
Tourbière : zone humide ds laquelle s’accumule progressivement de la
tourbe, matière végétale peu ou pas décomposée.
Recap parcours du pollen :
- Produit en grde qté par les plantes
- Dissémination du pollen par le vent par ex
- Se dépose sur la surface de l’eau ou il commence à s’accumuler
-
Avec le tps il se mélange avec d’autres MO (tourbe)
Ces couches successives de sédiments recouvrent le pollen,
l’enfouissant progressivement
Milieu pauvre en dioxygène : activité des décomposeurs limitée
Le pollen se conserve dc particulièrement bien, protégé par sa paroi
résistante
La tourbière est un milieu ou des plantes spécifiques poussent et meurent.
Les plantes mortes tombent ds l’eau stagnante et commencent à
s’accumuler.
A cause du manque d’oxygène et de l’humidité, les restes de
plante se décomposent lentement (pas totalement).
Les couches
successives s’accumulent et se compriment avec le poids, formant de la
tourbe.
La tourbe conserve les pollens et en étudiant les couches de la
tourbe, on peut comprendre les climats, écosystèmes passés.
Carottage de sédiments accumulés permet de réaliser des analyses
polliniques à différents niveaux.
Il faut déjà dater ces niveaux au carbone 14.
Puis
- On extrait le pollen
- On l’observe au MO
- On l’identifie : ainsi on détermine les proportions de chaque type de
pollen ds l’échantillon
Dans un niveau donné (correspond à une période donnée), les proportions
de grains de pollen de différentes espèces permettent de réaliser un
spectre pollinique.
L’ensemble des spectres des différents niveaux aboutit à la construction
d’un diagramme pollinique.
Celui-ci permet d’étudier l’évolution de la végétation en un site donné
pdnt une période + ou – étendue et témoigne des climats successifs si on
considère que les espèces végétales passées avaient les mêmes exigences
que les espèces actuelles (principe d’actualisme).
Ainsi, reconnaitre et dénombrer des pollens piégés ds un échantillon de
tourbe (témoin d’une époque précise) nous indique que durant cette
période des espèces végétales (productrices de ces pollens déposés)
étaient présentes en + ou – grde qté.
A partir des espèces rencontrées, on peut aussi déduire les cond
climatiques qui régnaient à cette époque.
Ceci nécessite d’utiliser le
principe d’actualisme, qui considère que les exigences écologiques d’une
espèce végétale passée st les mêmes que celles de la même espèce vivant
actuellement.
Ds une carotte de tourbe, + la tourbe est située en profondeur, + elle est
ancienne (principe de superposition).
La datation des pollens au 14C,
permet d’élaborer une échelle de tps.
Une datation des strates grace au carbone 14 aurait pu nous renseigner
sur l’age des pollens en fonction de la profondeur.
Ex de raisonnement :
Entre 6 000 et 5 000 cm de profondeur on observe une diminution rapide
des graminées.
Apparaissent alors progressivement des pollens de chene.
(on parle d’abondance).
Durant cette période il y a donc passage d’un
cliamt de très grd froid à un climat relativement chaud.
A partir de 3 000
cm de profondeur, il y a augmentation brutale de l’abondance de pollen de
Hetre.
Il y aussi diminution progressive de Chene.
Cela témoigne d’un
léger refroidissement de climat et d’une augmentation de l’hygrométrie au
sein de cet écosystème.
2) Les sédiments océaniques, archives des variations climatiques
passés et ds la glace : les paléo-thermomètres isotopiques : le ∂18O
et le ∂D (indicateurs des climats passés
Act 2 :
Variations du ∂18O ds les sédiments calcaires océaniques
Act 3 :
Variations du ∂18O ds les carottes de glace recueillies au Groenland et à
Vostok pr retrouver les variations climatiques depuis -400 000 ans.
Le principe des thermomètres isotopiques repose sur l’analyse des
isotopes d’éléments chimiques présents ds les matériaux
naturels : glaces, coquilles, sédiments, etc.
ces isotopes
permettent de reconstituer les temp passées, car leur répartition
varie en fonction des conditions climatiques, not la temp.
L’oxygène a 2 isotopes principaux :
16O (léger)
18O (lourd)
Ce sont des isotopes stables (ni radioactifs, ni radiogéniques) ce sont des
traceurs de processus naturels
Les isotopes légers et lourds ne se comportent pas exactement de la
mm manière lorsqu’ils sont impliqués ds des processus physiques
comme par ex un chgt de phase
Les isotopes légers s’évaporent + facilement
Les isotopes lourds se condensent + facilement
Donc le comportement de l’eau dépend de sa
masse, dc de l’isotope de l’oxygène qu’elle
contient.
Ce phénomène, appelé fractionnement isotopique, est influencé par la
température.
Séparation des isotopes légers et lourds d’un élément pdnt des processus
comme l’évaporation et la condensation
Dans un climat froid :
o L’évaporation océanique a lieu essentiellement au niv de
l’équateur.
Les masses d’air se déplaçant vers les poles se
refroidissent, ce qui est à l’origine des précipitations.
Une
grande partie de l’eau évaporée est transportée vers les poles,
ou elle forme de la neige et de la glace : glace appauvrie en
18O car cet isotope lourd est tombé ss forme de pluie avant
d’atteindre les régions froides.
o Resultat : la neige ou la glace des calottes polaires contient
moins de 180 (car isotopes lourds précipitent avant d’atteindre
les poles) et l’eau océanique restante est plus riche en 18O.
Dans un climat chaud :
o Moins de fractionnement car les temp + élevées réduisent les
différences entre isotopes lourds et légers ds les processus
d’évaporation et précipitation
o Résultat : glace contient plus du 18O et océans moins enrichis
en 180
Cette unité a pour objectif de montrer comment les thermomètres
isotopiques (d18O et dD)
permettent de reconstituer les paléotempératures globales (à la différence
des indices vus
précédemment qui sont des indices locaux).
Le document 1 présente le principe du fractionnement isotopique et
permet de comprendre
pourquoi d18O et dD peuvent servir de paléothermomètres.
Le document
B montre que les
précipitations, lorsqu’elles se déplacent des basses vers les hautes
latitudes, sont de plus
en plus pauvres en 18O (ou en D).
En période glaciaire, le fractionnement
isotopique entre les basses et les hautes latitudes est plus important qu’en
période interglaciaire, car le gradient de température entre l’équateur et
les pôles est alors plus marqué.
Le document C montre qu’il existe une
relation linéaire entre la température et le d18O ou le dD.
Le document 2 propose des données isotopiques obtenues en Antarctique.
Enfin, il peut être intéressant de remarquer que les réchauffements sont
très rapides et les refroidissements plus lents.
L’analyse du document C montre que plus il fait froid, plus le rapport
isotopique est faible
que ce soit pour le d18O ou le dD.
La relation linéaire permet de faire un
lien direct entre
la température du lieu et la valeur du rapport isotopique mesuré.
En
période glaciaire, on
s’attend donc à mesurer dans la glace un d18O ou un dD plus faible (plus
négatif) qu’en
période interglaciaire.
Ceci est lié au fait qu’en période glaciaire, le
gradient de température
entre les hautes et les basses latitudes est plus élevé.
Le fractionnement
isotopique est alors
plus intense.
En période glaciaire, d’après le document 1C, le rapport isotopique δ18O
ou δD mesuré dans
la glace est faible.
En revanche, le d18O des foraminifères, qui reflète le
δ18O de l’eau de mer au moment de la formation du test est plutôt élevé.
En effet, le 16O est alors « stocké » dans la glace des pôles qui est
épaisse et riche en 16O du fait des faibles températures.
De....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SVT DEBAT Les pesticides
- Synthèse svt météo
- carte mentale réchauffement climatique svt
- La Restauration (1815-1848) marque t’elle le retour de la monarchie absolue
- exposer svt: L’énergie nucléaire , avantages et inconvénients