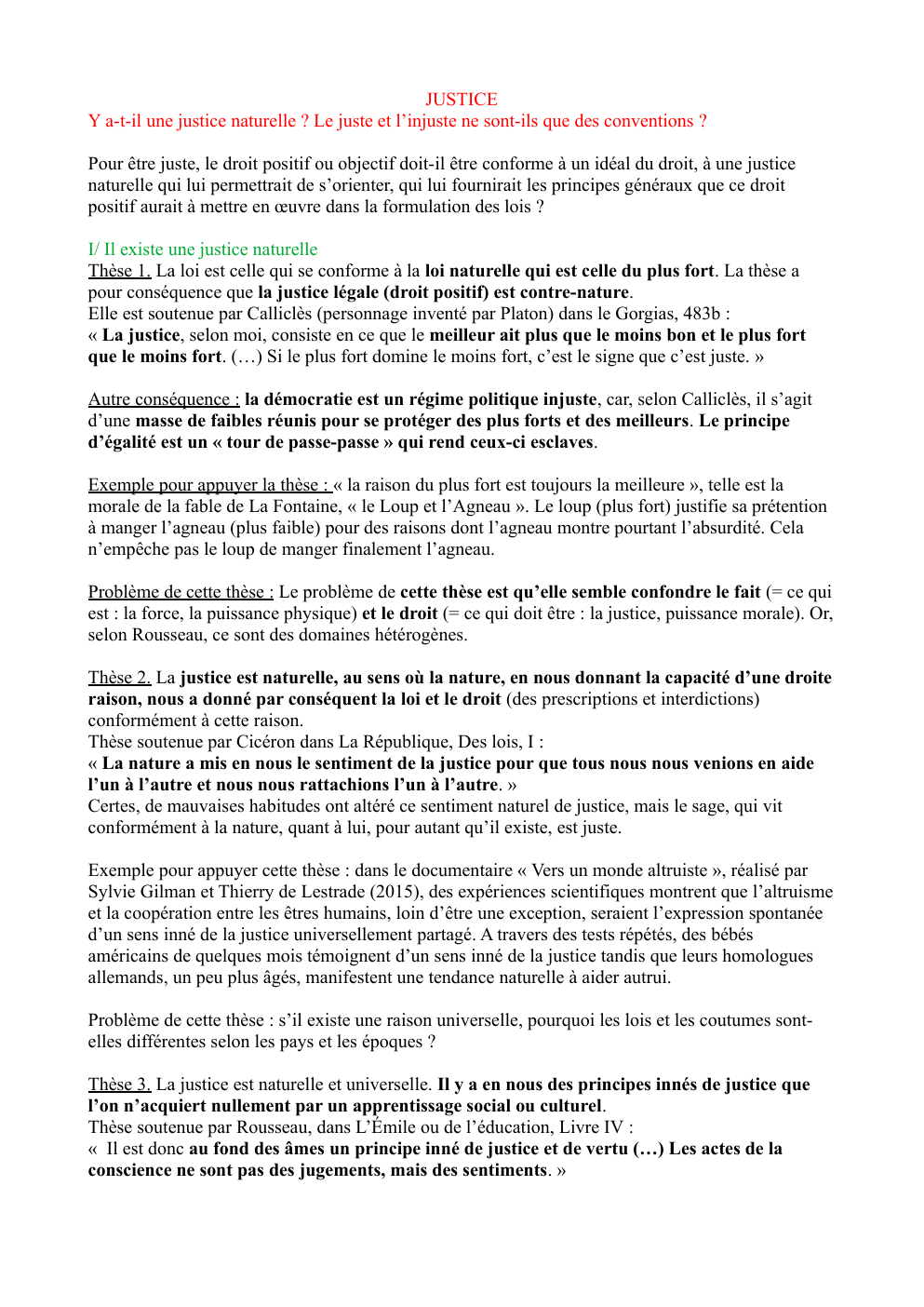Y a-t-il une justice naturelle ?
Publié le 21/09/2025
Extrait du document
«
JUSTICE
Y a-t-il une justice naturelle ? Le juste et l’injuste ne sont-ils que des conventions ?
Pour être juste, le droit positif ou objectif doit-il être conforme à un idéal du droit, à une justice
naturelle qui lui permettrait de s’orienter, qui lui fournirait les principes généraux que ce droit
positif aurait à mettre en œuvre dans la formulation des lois ?
I/ Il existe une justice naturelle
Thèse 1.
La loi est celle qui se conforme à la loi naturelle qui est celle du plus fort.
La thèse a
pour conséquence que la justice légale (droit positif) est contre-nature.
Elle est soutenue par Calliclès (personnage inventé par Platon) dans le Gorgias, 483b :
« La justice, selon moi, consiste en ce que le meilleur ait plus que le moins bon et le plus fort
que le moins fort.
(…) Si le plus fort domine le moins fort, c’est le signe que c’est juste.
»
Autre conséquence : la démocratie est un régime politique injuste, car, selon Calliclès, il s’agit
d’une masse de faibles réunis pour se protéger des plus forts et des meilleurs.
Le principe
d’égalité est un « tour de passe-passe » qui rend ceux-ci esclaves.
Exemple pour appuyer la thèse : « la raison du plus fort est toujours la meilleure », telle est la
morale de la fable de La Fontaine, « le Loup et l’Agneau ».
Le loup (plus fort) justifie sa prétention
à manger l’agneau (plus faible) pour des raisons dont l’agneau montre pourtant l’absurdité.
Cela
n’empêche pas le loup de manger finalement l’agneau.
Problème de cette thèse : Le problème de cette thèse est qu’elle semble confondre le fait (= ce qui
est : la force, la puissance physique) et le droit (= ce qui doit être : la justice, puissance morale).
Or,
selon Rousseau, ce sont des domaines hétérogènes.
Thèse 2.
La justice est naturelle, au sens où la nature, en nous donnant la capacité d’une droite
raison, nous a donné par conséquent la loi et le droit (des prescriptions et interdictions)
conformément à cette raison.
Thèse soutenue par Cicéron dans La République, Des lois, I :
« La nature a mis en nous le sentiment de la justice pour que tous nous nous venions en aide
l’un à l’autre et nous nous rattachions l’un à l’autre.
»
Certes, de mauvaises habitudes ont altéré ce sentiment naturel de justice, mais le sage, qui vit
conformément à la nature, quant à lui, pour autant qu’il existe, est juste.
Exemple pour appuyer cette thèse : dans le documentaire « Vers un monde altruiste », réalisé par
Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade (2015), des expériences scientifiques montrent que l’altruisme
et la coopération entre les êtres humains, loin d’être une exception, seraient l’expression spontanée
d’un sens inné de la justice universellement partagé.
A travers des tests répétés, des bébés
américains de quelques mois témoignent d’un sens inné de la justice tandis que leurs homologues
allemands, un peu plus âgés, manifestent une tendance naturelle à aider autrui.
Problème de cette thèse : s’il existe une raison universelle, pourquoi les lois et les coutumes sontelles différentes selon les pays et les époques ?
Thèse 3.
La justice est naturelle et universelle.
Il y a en nous des principes innés de justice que
l’on n’acquiert nullement par un apprentissage social ou culturel.
Thèse soutenue par Rousseau, dans L’Émile ou de l’éducation, Livre IV :
« Il est donc au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu (…) Les actes de la
conscience ne sont pas des jugements, mais des sentiments.
»
Rousseau affirme juste avant l’antériorité du sentir sur la connaissance, vouloir notre bien et fuir
notre mal ne s’apprend pas et de même l’amour du bon et de soi, la haine du mal sont naturels.
Selon Rousseau, nous n’entendons plus cette « céleste voix » (=conscience) qui juge sans erreur
du bien et du mal car les vices, qui se sont multipliés au cours de l’histoire humaine nous ont
rendus sourds, ils ont étouffé cette voix.
Le problème que pose cette thèse : dès lors que cette voix est étouffée, peut-on se fier à sa
conscience pour déterminer ce qui est juste/injuste ?
exemple: les droits formulés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948
correspondent à cette idée de droits naturels = base pour contester certains aspects du droit positif/
juger ces crimes contre l’humanité.
II/ Il n’y a pas de justice naturelle
Thèse 1 : Il n’y a pas de justice naturelle.
La justice humaine est conventionnelle.
Elle naît de la
rareté des biens qu’il faut partager et de la nature humaine.
Les biens rares sont en matière
de partage, soit source de conflit, soit source d’accord, selon la nature des relations entre les
individus.
En effet, il faut prendre l’homme comme il est : privilégié de ses proches (amis, famille)
et il partage volontiers avec eux mais ce n’est pas le cas avec les autres.
Pour cette raison, la justice
humaine est nécessaire.
Thèse soutenue par Hume (1711-1776) dans son Traité de la nature humaine (1739) :
«c’est uniquement de l’égoïsme de l’homme et de sa générosité limitée, ajoutée à la parcimonie
de la nature quand elle a pourvu ses besoins, que la justice tire son origine.
»
exemple pour appuyer cette thèse : dans « Pourquoi pas le socialisme ? » (2009), le philosophe
politique anglais Gerald Cohen, compare l’organisation de l’État à celle des vacances entre amis en
camping.
Il n’y a alors pas de rapport hiérarchique puisque l’objectif est que chacun prenne du bon
temps.
Même si chacun apporte un accessoire dont il est propriétaire, tous ces objets sont mis en
commun.
Il y a coopération dans l’organisation des tâches en fonction des goûts de chacun.
Un
excursion basée sur les principes de marché et de la propriété privée, de l’achat et de la vente, ne
plairait à personne.
Problème que pose cette thèse : le juste et l’injuste ne sont-ils que des conventions ?
Thèse 2 : Le juste, c’est légal.
Il s’identifie au droit positif.
Pas de juste transcendant à la légalité
civile.
Seule la loi civile fait le juste.
Le droit positif se fonde lui-même car il y a une garantie
d’objectivité et d’efficacité de ce droit : il ne renvoie pas à un autre droit (naturel).
Thèse de Thomas Hobbes sur le positivisme juridique, défendue dans Le Léviathan, II :
« C’est au souverain qu’appartient le soin de produire de bonnes lois.
Mais qu’est-ce qu’une
bonne loi ? Par bonne loi, je n’entends pas une loi juste, car aucune loi ne peut être injuste.
»
Une loi est bonne, et c’est ce qui importe, parce qu’elle est nécessaire au bien du peuple et non
parce qu’elle est juste.
Hobbes écarte l’idée qu’une loi est bonne parce qu’elle est juste.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- commentaire philo Leibniz Monadologie et la justice
- Chapitre 5 : Quelles inégalités sont compatibles avec les déférentes conceptions de la justice sociale ?
- Ch7 : Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale ?
- La Justice (cours complet)
- Un monde sans justice est il humain?