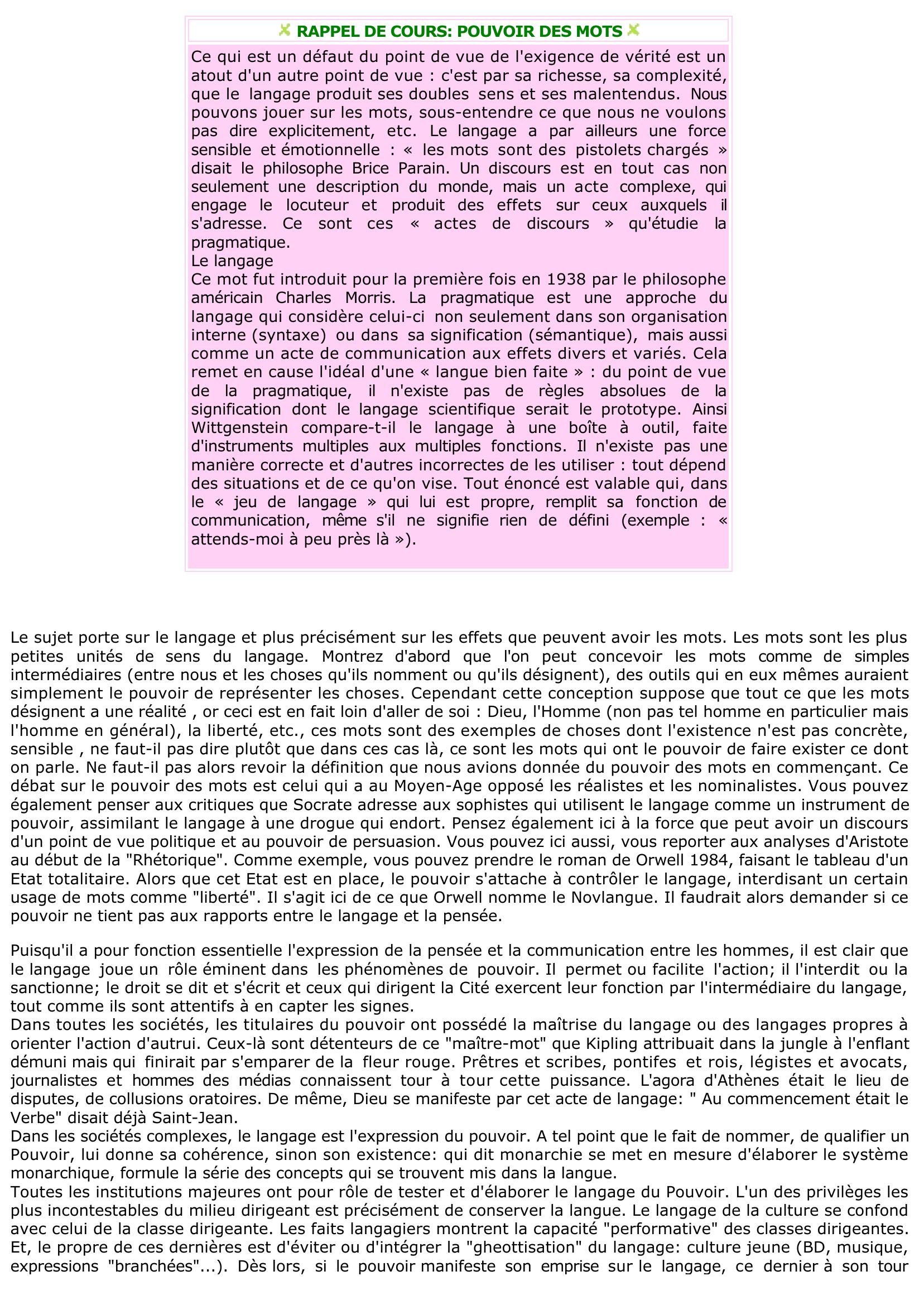Pouvoir des mots, mots du pouvoir
Extrait du document
«
RAPPEL DE COURS: POUVOIR DES MOTS
Ce qui est un défaut du point de vue de l'exigence de vérité est un
atout d'un autre point de vue : c'est par sa richesse, sa complexité,
que le langage produit ses doubles sens et ses malentendus.
Nous
pouvons jouer sur les mots, sous-entendre ce que nous ne voulons
pas dire explicitement, etc.
Le langage a par ailleurs une force
sensible et émotionnelle : « les mots sont des pistolets chargés »
disait le philosophe Brice Parain.
Un discours est en tout cas non
seulement une description du monde, mais un acte complexe, qui
engage le locuteur et produit des effets sur ceux auxquels il
s'adresse.
Ce sont ces « actes de discours » qu'étudie la
pragmatique.
Le langage
Ce mot fut introduit pour la première fois en 1938 par le philosophe
américain Charles Morris.
La pragmatique est une approche du
langage qui considère celui-ci non seulement dans son organisation
interne (syntaxe) ou dans sa signification (sémantique), mais aussi
comme un acte de communication aux effets divers et variés.
Cela
remet en cause l'idéal d'une « langue bien faite » : du point de vue
de la pragmatique, il n'existe pas de règles absolues de la
signification dont le langage scientifique serait le prototype.
Ainsi
Wittgenstein compare-t-il le langage à une boîte à outil, faite
d'instruments multiples aux multiples fonctions.
Il n'existe pas une
manière correcte et d'autres incorrectes de les utiliser : tout dépend
des situations et de ce qu'on vise.
Tout énoncé est valable qui, dans
le « jeu de langage » qui lui est propre, remplit sa fonction de
communication, même s'il ne signifie rien de défini (exemple : «
attends-moi à peu près là »).
Le sujet porte sur le langage et plus précisément sur les effets que peuvent avoir les mots.
Les mots sont les plus
petites unités de sens du langage.
Montrez d'abord que l'on peut concevoir les mots comme de simples
intermédiaires (entre nous et les choses qu'ils nomment ou qu'ils désignent), des outils qui en eux mêmes auraient
simplement le pouvoir de représenter les choses.
Cependant cette conception suppose que tout ce que les mots
désignent a une réalité , or ceci est en fait loin d'aller de soi : Dieu, l'Homme (non pas tel homme en particulier mais
l'homme en général), la liberté, etc., ces mots sont des exemples de choses dont l'existence n'est pas concrète,
sensible , ne faut-il pas dire plutôt que dans ces cas là, ce sont les mots qui ont le pouvoir de faire exister ce dont
on parle.
Ne faut-il pas alors revoir la définition que nous avions donnée du pouvoir des mots en commençant.
Ce
débat sur le pouvoir des mots est celui qui a au Moyen-Age opposé les réalistes et les nominalistes.
Vous pouvez
également penser aux critiques que Socrate adresse aux sophistes qui utilisent le langage comme un instrument de
pouvoir, assimilant le langage à une drogue qui endort.
Pensez également ici à la force que peut avoir un discours
d'un point de vue politique et au pouvoir de persuasion.
Vous pouvez ici aussi, vous reporter aux analyses d'Aristote
au début de la "Rhétorique".
Comme exemple, vous pouvez prendre le roman de Orwell 1984, faisant le tableau d'un
Etat totalitaire.
Alors que cet Etat est en place, le pouvoir s'attache à contrôler le langage, interdisant un certain
usage de mots comme "liberté".
Il s'agit ici de ce que Orwell nomme le Novlangue.
Il faudrait alors demander si ce
pouvoir ne tient pas aux rapports entre le langage et la pensée.
Puisqu'il a pour fonction essentielle l'expression de la pensée et la communication entre les hommes, il est clair que
le langage joue un rôle éminent dans les phénomènes de pouvoir.
Il permet ou facilite l'action; il l'interdit ou la
sanctionne; le droit se dit et s'écrit et ceux qui dirigent la Cité exercent leur fonction par l'intermédiaire du langage,
tout comme ils sont attentifs à en capter les signes.
Dans toutes les sociétés, les titulaires du pouvoir ont possédé la maîtrise du langage ou des langages propres à
orienter l'action d'autrui.
Ceux-là sont détenteurs de ce "maître-mot" que Kipling attribuait dans la jungle à l'enflant
démuni mais qui finirait par s'emparer de la fleur rouge.
Prêtres et scribes, pontifes et rois, légistes et avocats,
journalistes et hommes des médias connaissent tour à tour cette puissance.
L'agora d'Athènes était le lieu de
disputes, de collusions oratoires.
De même, Dieu se manifeste par cet acte de langage: " Au commencement était le
Verbe" disait déjà Saint-Jean.
Dans les sociétés complexes, le langage est l'expression du pouvoir.
A tel point que le fait de nommer, de qualifier un
Pouvoir, lui donne sa cohérence, sinon son existence: qui dit monarchie se met en mesure d'élaborer le système
monarchique, formule la série des concepts qui se trouvent mis dans la langue.
Toutes les institutions majeures ont pour rôle de tester et d'élaborer le langage du Pouvoir.
L'un des privilèges les
plus incontestables du milieu dirigeant est précisément de conserver la langue.
Le langage de la culture se confond
avec celui de la classe dirigeante.
Les faits langagiers montrent la capacité "performative" des classes dirigeantes.
Et, le propre de ces dernières est d'éviter ou d'intégrer la "gheottisation" du langage: culture jeune (BD, musique,
expressions "branchées"...).
Dès lors, si le pouvoir manifeste son emprise sur le langage, ce dernier à son tour.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le pouvoir des mots constitue-t-il seulement un abus de langage ?
- Le pouvoir des mots : mythe ou réalité ?
- Les mots sont-ils sans pouvoir contre la force ?
- A quoi tient le pouvoir des mots ?
- Quel est le pouvoir des mots ?