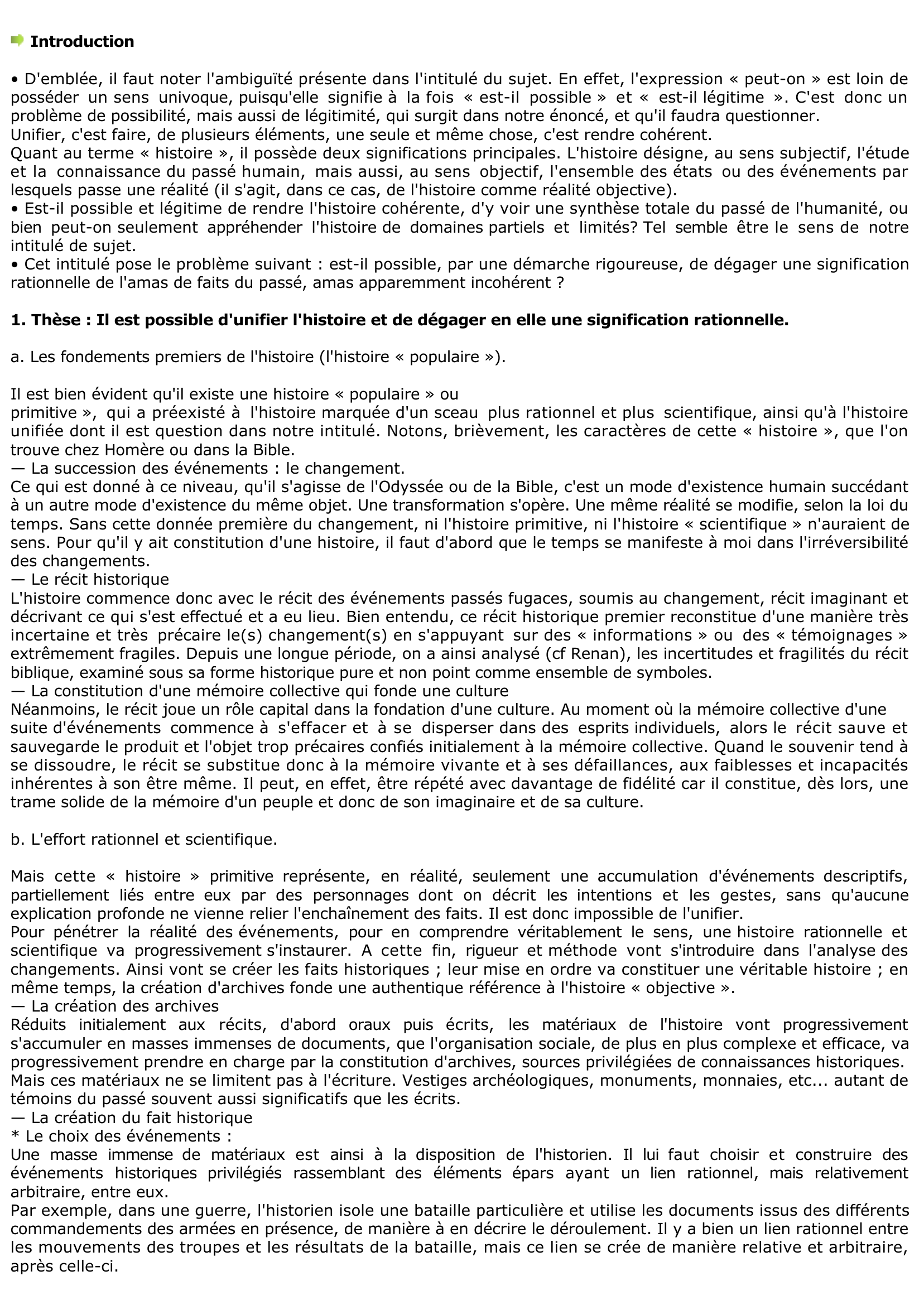Peut-on unifier l'histoire ?
Extrait du document
«
Introduction
• D'emblée, il faut noter l'ambiguïté présente dans l'intitulé du sujet.
En effet, l'expression « peut-on » est loin de
posséder un sens univoque, puisqu'elle signifie à la fois « est-il possible » et « est-il légitime ».
C'est donc un
problème de possibilité, mais aussi de légitimité, qui surgit dans notre énoncé, et qu'il faudra questionner.
Unifier, c'est faire, de plusieurs éléments, une seule et même chose, c'est rendre cohérent.
Quant au terme « histoire », il possède deux significations principales.
L'histoire désigne, au sens subjectif, l'étude
et la connaissance du passé humain, mais aussi, au sens objectif, l'ensemble des états ou des événements par
lesquels passe une réalité (il s'agit, dans ce cas, de l'histoire comme réalité objective).
• Est-il possible et légitime de rendre l'histoire cohérente, d'y voir une synthèse totale du passé de l'humanité, ou
bien peut-on seulement appréhender l'histoire de domaines partiels et limités? Tel semble être le sens de notre
intitulé de sujet.
• Cet intitulé pose le problème suivant : est-il possible, par une démarche rigoureuse, de dégager une signification
rationnelle de l'amas de faits du passé, amas apparemment incohérent ?
1.
Thèse : Il est possible d'unifier l'histoire et de dégager en elle une signification rationnelle.
a.
Les fondements premiers de l'histoire (l'histoire « populaire »).
Il est bien évident qu'il existe une histoire « populaire » ou
primitive », qui a préexisté à l'histoire marquée d'un sceau plus rationnel et plus scientifique, ainsi qu'à l'histoire
unifiée dont il est question dans notre intitulé.
Notons, brièvement, les caractères de cette « histoire », que l'on
trouve chez Homère ou dans la Bible.
— La succession des événements : le changement.
Ce qui est donné à ce niveau, qu'il s'agisse de l'Odyssée ou de la Bible, c'est un mode d'existence humain succédant
à un autre mode d'existence du même objet.
Une transformation s'opère.
Une même réalité se modifie, selon la loi du
temps.
Sans cette donnée première du changement, ni l'histoire primitive, ni l'histoire « scientifique » n'auraient de
sens.
Pour qu'il y ait constitution d'une histoire, il faut d'abord que le temps se manifeste à moi dans l'irréversibilité
des changements.
— Le récit historique
L'histoire commence donc avec le récit des événements passés fugaces, soumis au changement, récit imaginant et
décrivant ce qui s'est effectué et a eu lieu.
Bien entendu, ce récit historique premier reconstitue d'une manière très
incertaine et très précaire le(s) changement(s) en s'appuyant sur des « informations » ou des « témoignages »
extrêmement fragiles.
Depuis une longue période, on a ainsi analysé (cf Renan), les incertitudes et fragilités du récit
biblique, examiné sous sa forme historique pure et non point comme ensemble de symboles.
— La constitution d'une mémoire collective qui fonde une culture
Néanmoins, le récit joue un rôle capital dans la fondation d'une culture.
Au moment où la mémoire collective d'une
suite d'événements commence à s'effacer et à se disperser dans des esprits individuels, alors le récit sauve et
sauvegarde le produit et l'objet trop précaires confiés initialement à la mémoire collective.
Quand le souvenir tend à
se dissoudre, le récit se substitue donc à la mémoire vivante et à ses défaillances, aux faiblesses et incapacités
inhérentes à son être même.
Il peut, en effet, être répété avec davantage de fidélité car il constitue, dès lors, une
trame solide de la mémoire d'un peuple et donc de son imaginaire et de sa culture.
b.
L'effort rationnel et scientifique.
Mais cette « histoire » primitive représente, en réalité, seulement une accumulation d'événements descriptifs,
partiellement liés entre eux par des personnages dont on décrit les intentions et les gestes, sans qu'aucune
explication profonde ne vienne relier l'enchaînement des faits.
Il est donc impossible de l'unifier.
Pour pénétrer la réalité des événements, pour en comprendre véritablement le sens, une histoire rationnelle et
scientifique va progressivement s'instaurer.
A cette fin, rigueur et méthode vont s'introduire dans l'analyse des
changements.
Ainsi vont se créer les faits historiques ; leur mise en ordre va constituer une véritable histoire ; en
même temps, la création d'archives fonde une authentique référence à l'histoire « objective ».
— La création des archives
Réduits initialement aux récits, d'abord oraux puis écrits, les matériaux de l'histoire vont progressivement
s'accumuler en masses immenses de documents, que l'organisation sociale, de plus en plus complexe et efficace, va
progressivement prendre en charge par la constitution d'archives, sources privilégiées de connaissances historiques.
Mais ces matériaux ne se limitent pas à l'écriture.
Vestiges archéologiques, monuments, monnaies, etc...
autant de
témoins du passé souvent aussi significatifs que les écrits.
— La création du fait historique
* Le choix des événements :
Une masse immense de matériaux est ainsi à la disposition de l'historien.
Il lui faut choisir et construire des
événements historiques privilégiés rassemblant des éléments épars ayant un lien rationnel, mais relativement
arbitraire, entre eux.
Par exemple, dans une guerre, l'historien isole une bataille particulière et utilise les documents issus des différents
commandements des armées en présence, de manière à en décrire le déroulement.
Il y a bien un lien rationnel entre
les mouvements des troupes et les résultats de la bataille, mais ce lien se crée de manière relative et arbitraire,
après celle-ci..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'histoire est écrite par les vainqueurs. Robert Brasillach
- Georges lfrah, Histoire universelle des chiffres
- Histoire du droit
- Un débat historique : Histoire versus Structure
- Histoire et théories de l'anthropologie et le traitement de l'autre