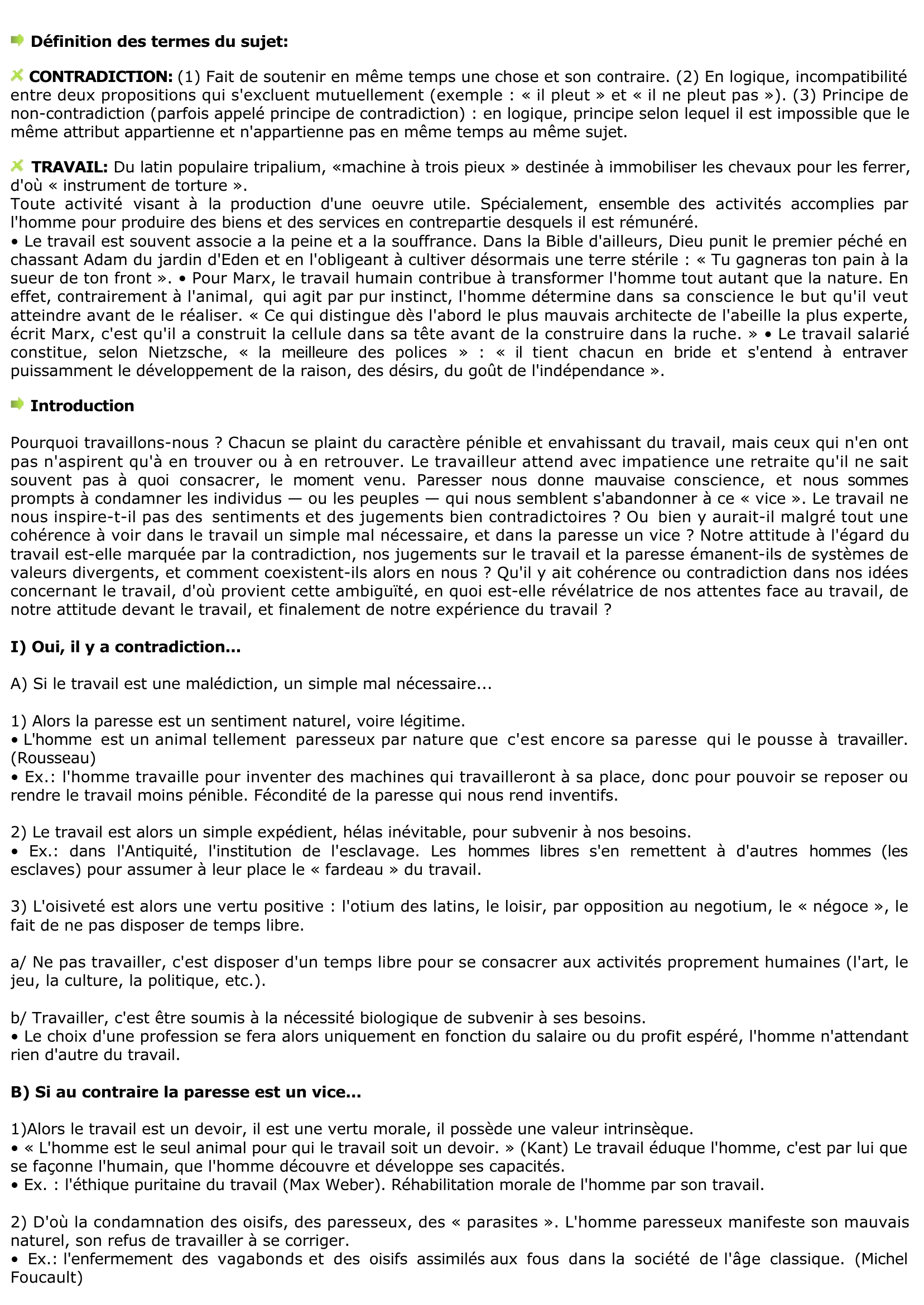On considère souvent le travail comme une malédiction et la paresse comme un vice: y a-t-il là une contradiction ?
Extrait du document
«
Définition des termes du sujet:
CONTRADICTION: (1) Fait de soutenir en même temps une chose et son contraire.
(2) En logique, incompatibilité
entre deux propositions qui s'excluent mutuellement (exemple : « il pleut » et « il ne pleut pas »).
(3) Principe de
non-contradiction (parfois appelé principe de contradiction) : en logique, principe selon lequel il est impossible que le
même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet.
TRAVAIL: Du latin populaire tripalium, «machine à trois pieux » destinée à immobiliser les chevaux pour les ferrer,
d'où « instrument de torture ».
Toute activité visant à la production d'une oeuvre utile.
Spécialement, ensemble des activités accomplies par
l'homme pour produire des biens et des services en contrepartie desquels il est rémunéré.
• Le travail est souvent associe a la peine et a la souffrance.
Dans la Bible d'ailleurs, Dieu punit le premier péché en
chassant Adam du jardin d'Eden et en l'obligeant à cultiver désormais une terre stérile : « Tu gagneras ton pain à la
sueur de ton front ».
• Pour Marx, le travail humain contribue à transformer l'homme tout autant que la nature.
En
effet, contrairement à l'animal, qui agit par pur instinct, l'homme détermine dans sa conscience le but qu'il veut
atteindre avant de le réaliser.
« Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte,
écrit Marx, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche.
» • Le travail salarié
constitue, selon Nietzsche, « la meilleure des polices » : « il tient chacun en bride et s'entend à entraver
puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance ».
Introduction
Pourquoi travaillons-nous ? Chacun se plaint du caractère pénible et envahissant du travail, mais ceux qui n'en ont
pas n'aspirent qu'à en trouver ou à en retrouver.
Le travailleur attend avec impatience une retraite qu'il ne sait
souvent pas à quoi consacrer, le moment venu.
Paresser nous donne mauvaise conscience, et nous sommes
prompts à condamner les individus — ou les peuples — qui nous semblent s'abandonner à ce « vice ».
Le travail ne
nous inspire-t-il pas des sentiments et des jugements bien contradictoires ? Ou bien y aurait-il malgré tout une
cohérence à voir dans le travail un simple mal nécessaire, et dans la paresse un vice ? Notre attitude à l'égard du
travail est-elle marquée par la contradiction, nos jugements sur le travail et la paresse émanent-ils de systèmes de
valeurs divergents, et comment coexistent-ils alors en nous ? Qu'il y ait cohérence ou contradiction dans nos idées
concernant le travail, d'où provient cette ambiguïté, en quoi est-elle révélatrice de nos attentes face au travail, de
notre attitude devant le travail, et finalement de notre expérience du travail ?
I) Oui, il y a contradiction...
A) Si le travail est une malédiction, un simple mal nécessaire...
1) Alors la paresse est un sentiment naturel, voire légitime.
• L'homme est un animal tellement paresseux par nature que c'est encore sa paresse qui le pousse à travailler.
(Rousseau)
• Ex.: l'homme travaille pour inventer des machines qui travailleront à sa place, donc pour pouvoir se reposer ou
rendre le travail moins pénible.
Fécondité de la paresse qui nous rend inventifs.
2) Le travail est alors un simple expédient, hélas inévitable, pour subvenir à nos besoins.
• Ex.: dans l'Antiquité, l'institution de l'esclavage.
Les hommes libres s'en remettent à d'autres hommes (les
esclaves) pour assumer à leur place le « fardeau » du travail.
3) L'oisiveté est alors une vertu positive : l'otium des latins, le loisir, par opposition au negotium, le « négoce », le
fait de ne pas disposer de temps libre.
a/ Ne pas travailler, c'est disposer d'un temps libre pour se consacrer aux activités proprement humaines (l'art, le
jeu, la culture, la politique, etc.).
b/ Travailler, c'est être soumis à la nécessité biologique de subvenir à ses besoins.
• Le choix d'une profession se fera alors uniquement en fonction du salaire ou du profit espéré, l'homme n'attendant
rien d'autre du travail.
B) Si au contraire la paresse est un vice...
1)Alors le travail est un devoir, il est une vertu morale, il possède une valeur intrinsèque.
• « L'homme est le seul animal pour qui le travail soit un devoir.
» (Kant) Le travail éduque l'homme, c'est par lui que
se façonne l'humain, que l'homme découvre et développe ses capacités.
• Ex.
: l'éthique puritaine du travail (Max Weber).
Réhabilitation morale de l'homme par son travail.
2) D'où la condamnation des oisifs, des paresseux, des « parasites ».
L'homme paresseux manifeste son mauvais
naturel, son refus de travailler à se corriger.
• Ex.: l'enfermement des vagabonds et des oisifs assimilés aux fous dans la société de l'âge classique.
(Michel
Foucault).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le travail est-il une malédiction ?
- Sujet : Le travail technique est-il une transformation de l’homme ?
- La paresse et la lâcheté - KANT, Réponse à la question: Qu'est-ce que les Lumières?
- Travail/Nature/technique: le travail est-il le propre de l'homme ?
- Le travail est il libérateur ?