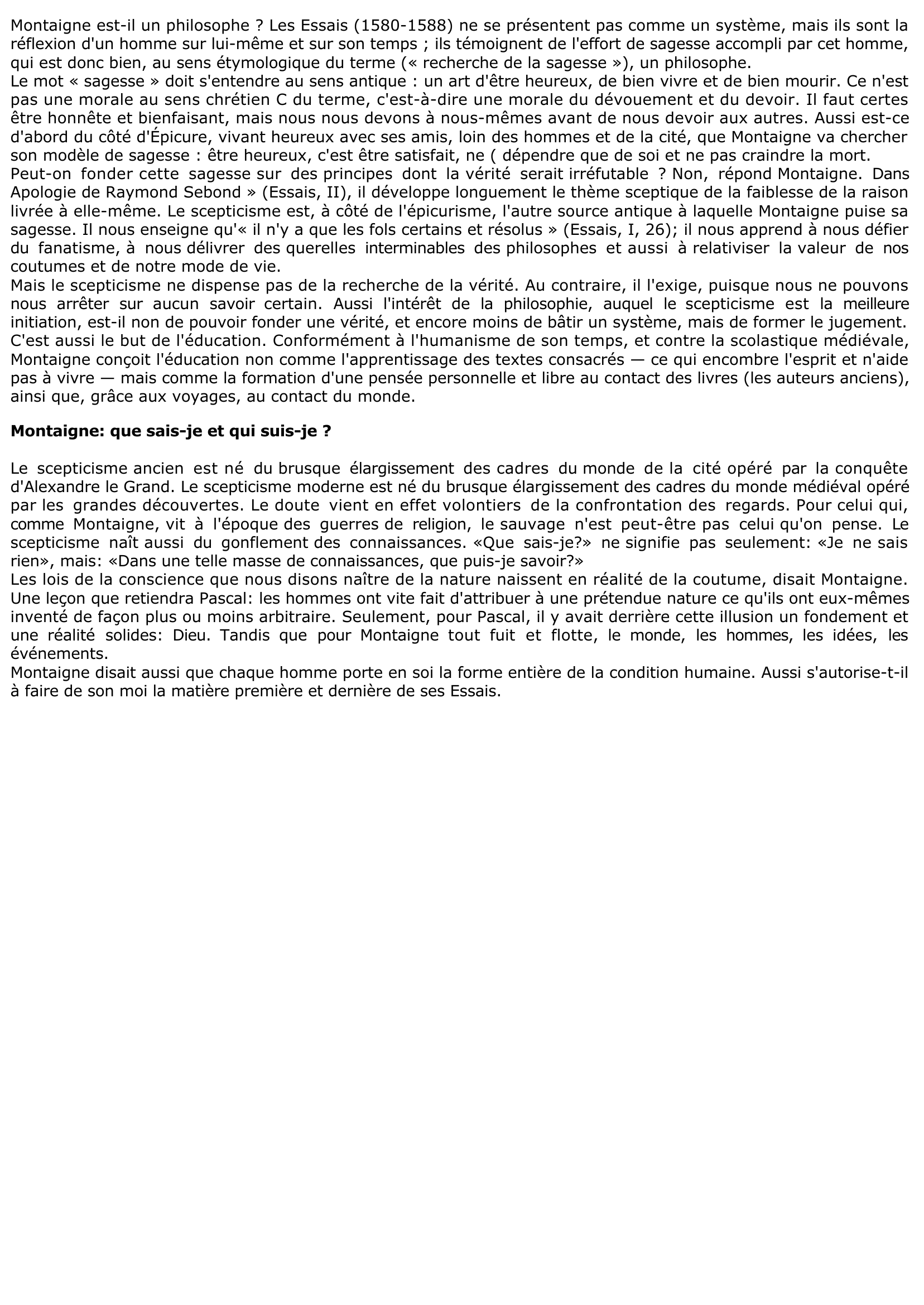Montaigne : scepticisme et sagesse
Extrait du document
«
Montaigne est-il un philosophe ? Les Essais (1580-1588) ne se présentent pas comme un système, mais ils sont la
réflexion d'un homme sur lui-même et sur son temps ; ils témoignent de l'effort de sagesse accompli par cet homme,
qui est donc bien, au sens étymologique du terme (« recherche de la sagesse »), un philosophe.
Le mot « sagesse » doit s'entendre au sens antique : un art d'être heureux, de bien vivre et de bien mourir.
Ce n'est
pas une morale au sens chrétien C du terme, c'est-à-dire une morale du dévouement et du devoir.
Il faut certes
être honnête et bienfaisant, mais nous nous devons à nous-mêmes avant de nous devoir aux autres.
Aussi est-ce
d'abord du côté d'Épicure, vivant heureux avec ses amis, loin des hommes et de la cité, que Montaigne va chercher
son modèle de sagesse : être heureux, c'est être satisfait, ne ( dépendre que de soi et ne pas craindre la mort.
Peut-on fonder cette sagesse sur des principes dont la vérité serait irréfutable ? Non, répond Montaigne.
Dans
Apologie de Raymond Sebond » (Essais, II), il développe longuement le thème sceptique de la faiblesse de la raison
livrée à elle-même.
Le scepticisme est, à côté de l'épicurisme, l'autre source antique à laquelle Montaigne puise sa
sagesse.
Il nous enseigne qu'« il n'y a que les fols certains et résolus » (Essais, I, 26); il nous apprend à nous défier
du fanatisme, à nous délivrer des querelles interminables des philosophes et aussi à relativiser la valeur de nos
coutumes et de notre mode de vie.
Mais le scepticisme ne dispense pas de la recherche de la vérité.
Au contraire, il l'exige, puisque nous ne pouvons
nous arrêter sur aucun savoir certain.
Aussi l'intérêt de la philosophie, auquel le scepticisme est la meilleure
initiation, est-il non de pouvoir fonder une vérité, et encore moins de bâtir un système, mais de former le jugement.
C'est aussi le but de l'éducation.
Conformément à l'humanisme de son temps, et contre la scolastique médiévale,
Montaigne conçoit l'éducation non comme l'apprentissage des textes consacrés — ce qui encombre l'esprit et n'aide
pas à vivre — mais comme la formation d'une pensée personnelle et libre au contact des livres (les auteurs anciens),
ainsi que, grâce aux voyages, au contact du monde.
Montaigne: que sais-je et qui suis-je ?
Le scepticisme ancien est né du brusque élargissement des cadres du monde de la cité opéré par la conquête
d'Alexandre le Grand.
Le scepticisme moderne est né du brusque élargissement des cadres du monde médiéval opéré
par les grandes découvertes.
Le doute vient en effet volontiers de la confrontation des regards.
Pour celui qui,
comme Montaigne, vit à l'époque des guerres de religion, le sauvage n'est peut-être pas celui qu'on pense.
Le
scepticisme naît aussi du gonflement des connaissances.
«Que sais-je?» ne signifie pas seulement: «Je ne sais
rien», mais: «Dans une telle masse de connaissances, que puis-je savoir?»
Les lois de la conscience que nous disons naître de la nature naissent en réalité de la coutume, disait Montaigne.
Une leçon que retiendra Pascal: les hommes ont vite fait d'attribuer à une prétendue nature ce qu'ils ont eux-mêmes
inventé de façon plus ou moins arbitraire.
Seulement, pour Pascal, il y avait derrière cette illusion un fondement et
une réalité solides: Dieu.
Tandis que pour Montaigne tout fuit et flotte, le monde, les hommes, les idées, les
événements.
Montaigne disait aussi que chaque homme porte en soi la forme entière de la condition humaine.
Aussi s'autorise-t-il
à faire de son moi la matière première et dernière de ses Essais..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Tout ce qui peut être fait un autre jour le peut être aujourd'hui. Montaigne
- Montaigne - Commentaires sur l'institution des enfants
- Montaigne et la mort
- LA SAGESSE MORALE selon EPICTÈTE
- Montaigne, Que savons-nous de l'intelligence des animaux ?