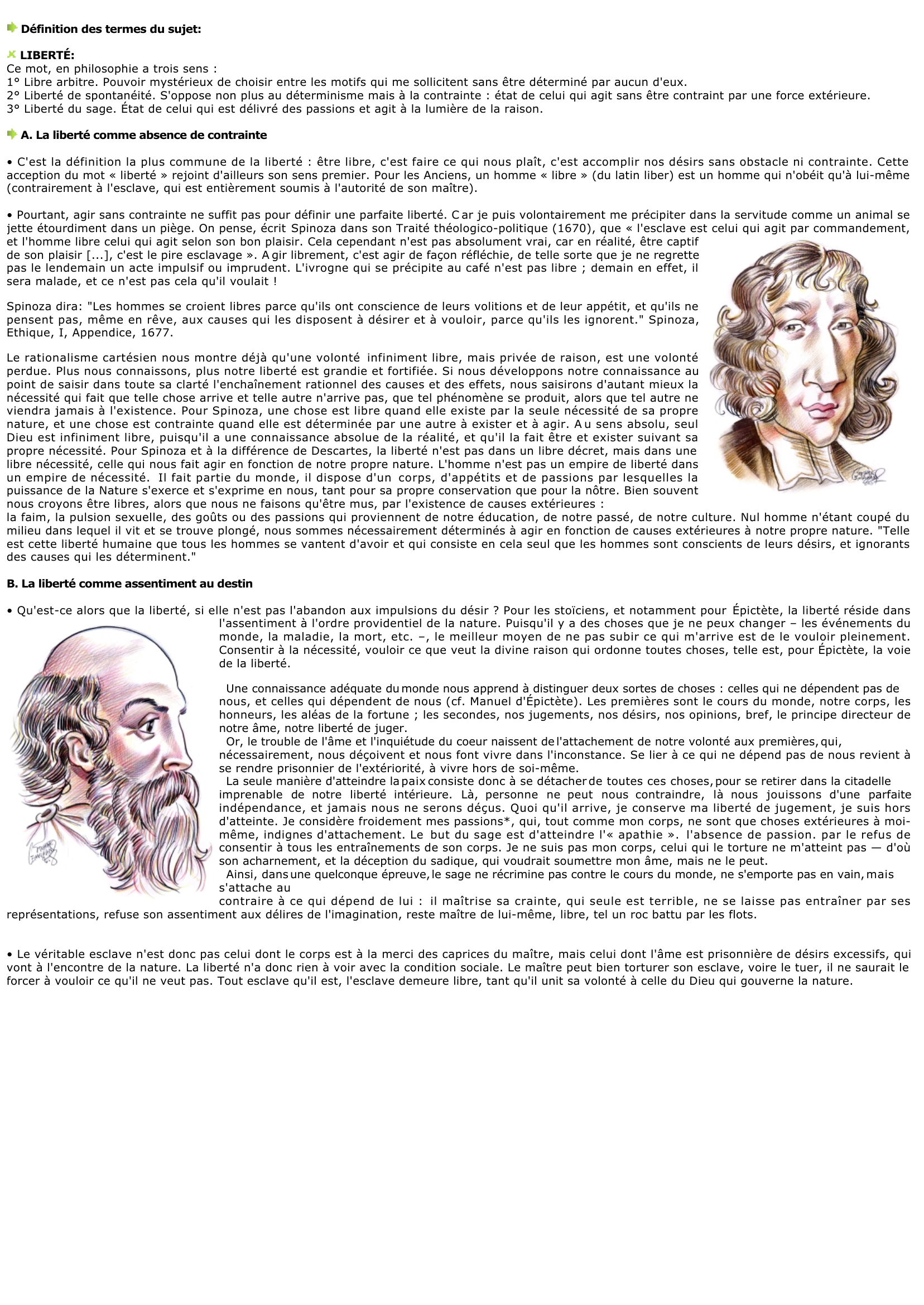Les différents sens du mot liberté
Extrait du document
«
Définition des termes du sujet:
LIBERTÉ:
Ce mot, en philosophie a trois sens :
1° Libre arbitre.
Pouvoir mystérieux de choisir entre les motifs qui me sollicitent sans être déterminé par aucun d'eux.
2° Liberté de spontanéité.
S'oppose non plus au déterminisme mais à la contrainte : état de celui qui agit sans être contraint par une force extérieure.
3° Liberté du sage.
État de celui qui est délivré des passions et agit à la lumière de la raison.
A.
La liberté comme absence de contrainte
• C'est la définition la plus commune de la liberté : être libre, c'est faire ce qui nous plaît, c'est accomplir nos désirs sans obstacle ni contrainte.
Cette
acception du mot « liberté » rejoint d'ailleurs son sens premier.
Pour les Anciens, un homme « libre » (du latin liber) est un homme qui n'obéit qu'à lui-même
(contrairement à l'esclave, qui est entièrement soumis à l'autorité de son maître).
• Pourtant, agir sans contrainte ne suffit pas pour définir une parfaite liberté.
C ar je puis volontairement me précipiter dans la servitude comme un animal se
jette étourdiment dans un piège.
On pense, écrit Spinoza dans son Traité théologico-politique (1670), que « l'esclave est celui qui agit par commandement,
et l'homme libre celui qui agit selon son bon plaisir.
Cela cependant n'est pas absolument vrai, car en réalité, être captif
de son plaisir [...], c'est le pire esclavage ».
A gir librement, c'est agir de façon réfléchie, de telle sorte que je ne regrette
pas le lendemain un acte impulsif ou imprudent.
L'ivrogne qui se précipite au café n'est pas libre ; demain en effet, il
sera malade, et ce n'est pas cela qu'il voulait !
Spinoza dira: "Les hommes se croient libres parce qu'ils ont conscience de leurs volitions et de leur appétit, et qu'ils ne
pensent pas, même en rêve, aux causes qui les disposent à désirer et à vouloir, parce qu'ils les ignorent." Spinoza,
Ethique, I, Appendice, 1677.
Le rationalisme cartésien nous montre déjà qu'une volonté infiniment libre, mais privée de raison, est une volonté
perdue.
Plus nous connaissons, plus notre liberté est grandie et fortifiée.
Si nous développons notre connaissance au
point de saisir dans toute sa clarté l'enchaînement rationnel des causes et des effets, nous saisirons d'autant mieux la
nécessité qui fait que telle chose arrive et telle autre n'arrive pas, que tel phénomène se produit, alors que tel autre ne
viendra jamais à l'existence.
Pour Spinoza, une chose est libre quand elle existe par la seule nécessité de sa propre
nature, et une chose est contrainte quand elle est déterminée par une autre à exister et à agir.
A u sens absolu, seul
Dieu est infiniment libre, puisqu'il a une connaissance absolue de la réalité, et qu'il la fait être et exister suivant sa
propre nécessité.
Pour Spinoza et à la différence de Descartes, la liberté n'est pas dans un libre décret, mais dans une
libre nécessité, celle qui nous fait agir en fonction de notre propre nature.
L'homme n'est pas un empire de liberté dans
un empire de nécessité.
Il fait partie du monde, il dispose d'un corps, d'appétits et de passions par lesquelles la
puissance de la Nature s'exerce et s'exprime en nous, tant pour sa propre conservation que pour la nôtre.
Bien souvent
nous croyons être libres, alors que nous ne faisons qu'être mus, par l'existence de causes extérieures :
la faim, la pulsion sexuelle, des goûts ou des passions qui proviennent de notre éducation, de notre passé, de notre culture.
Nul homme n'étant coupé du
milieu dans lequel il vit et se trouve plongé, nous sommes nécessairement déterminés à agir en fonction de causes extérieures à notre propre nature.
"Telle
est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs, et ignorants
des causes qui les déterminent."
B.
La liberté comme assentiment au destin
• Qu'est-ce alors que la liberté, si elle n'est pas l'abandon aux impulsions du désir ? Pour les stoïciens, et notamment pour Épictète, la liberté réside dans
l'assentiment à l'ordre providentiel de la nature.
Puisqu'il y a des choses que je ne peux changer – les événements du
monde, la maladie, la mort, etc.
–, le meilleur moyen de ne pas subir ce qui m'arrive est de le vouloir pleinement.
Consentir à la nécessité, vouloir ce que veut la divine raison qui ordonne toutes choses, telle est, pour Épictète, la voie
de la liberté.
Une connaissance adéquate du monde nous apprend à distinguer deux sortes de choses : celles qui ne dépendent pas de
nous, et celles qui dépendent de nous (cf.
Manuel d'Épictète).
Les premières sont le cours du monde, notre corps, les
honneurs, les aléas de la fortune ; les secondes, nos jugements, nos désirs, nos opinions, bref, le principe directeur de
notre âme, notre liberté de juger.
Or, le trouble de l'âme et l'inquiétude du coeur naissent de l'attachement de notre volonté aux premières, qui,
nécessairement, nous déçoivent et nous font vivre dans l'inconstance.
Se lier à ce qui ne dépend pas de nous revient à
se rendre prisonnier de l'extériorité, à vivre hors de soi-même.
La seule manière d'atteindre la paix consiste donc à se détacher de toutes ces choses, pour se retirer dans la citadelle
imprenable de notre liberté intérieure.
Là, personne ne peut nous contraindre, là nous jouissons d'une parfaite
indépendance, et jamais nous ne serons déçus.
Quoi qu'il arrive, je conserve ma liberté de jugement, je suis hors
d'atteinte.
Je considère froidement mes passions*, qui, tout comme mon corps, ne sont que choses extérieures à moimême, indignes d'attachement.
Le but du sage est d'atteindre l'« apathie ».
l'absence de passion.
par le refus de
consentir à tous les entraînements de son corps.
Je ne suis pas mon corps, celui qui le torture ne m'atteint pas — d'où
son acharnement, et la déception du sadique, qui voudrait soumettre mon âme, mais ne le peut.
Ainsi, dans une quelconque épreuve, le sage ne récrimine pas contre le cours du monde, ne s'emporte pas en vain, mais
s'attache au
contraire à ce qui dépend de lui : il maîtrise sa crainte, qui seule est terrible, ne se laisse pas entraîner par ses
représentations, refuse son assentiment aux délires de l'imagination, reste maître de lui-même, libre, tel un roc battu par les flots.
• Le véritable esclave n'est donc pas celui dont le corps est à la merci des caprices du maître, mais celui dont l'âme est prisonnière de désirs excessifs, qui
vont à l'encontre de la nature.
La liberté n'a donc rien à voir avec la condition sociale.
Le maître peut bien torturer son esclave, voire le tuer, il ne saurait le
forcer à vouloir ce qu'il ne veut pas.
Tout esclave qu'il est, l'esclave demeure libre, tant qu'il unit sa volonté à celle du Dieu qui gouverne la nature..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on dire que l'expression perdre sa liberté a un sens ?
- l'expression perdre sa liberté a-t-elle un sens ?
- L'idée d'une liberté totale a-t-elle un sens ?
- L'idée d'une liberté totale a-t-elle un sens ?
- L' idée d'une liberté sans limites a-t-elle un sens ?